Mercredi 21 janvier aura lieu la 3ème séance du Séminaire Ciel organisé conjointement par les départements de Lettres anciennes et de Philosophie de l'Université de Nantes, et leurs laboratoires, l'AMo et le Caphi. Nous accueillerons Christian Biet (Université de Paris Ouest Nanterre) qui nous parlera de la question de la "Matérialité du ciel dans le théâtre du XVIIe". Programme de l'année sur les sites de l'AMo et du Caphi
↧
Séminaire Ciel : "Matérialité du ciel dans le théâtre du XVIIe s." par Chr. Biet
↧
Conférence de D. Massonaud à la Maison de Balzac
CONFERENCE : Samedi 17 janvier 2015 à 16h30à la MAISON DE BALZAC, 47 rue Raynouard, 75016 Paris, Dominique MASSONNAUDprésentera son livre: Faire vrai, Balzac et l’invention de l’œuvre-monde (Droz, « Histoire des idées et critique littéraire», 2014) à l'invitation de la SOCIÉTÉ DES AMIS D’HONORÉ DE BALZACET DE LA MAISON DE BALZAC
↧
↧
Le travail contraint dans les Amériques avant l’abolition de l'esclavage : codifications juridiques, transferts et harmonisation des pratiques
Journée d'étude Le travail contraint dans les Amériques avant l’abolition de l'esclavage : codifications juridiques, transferts et harmonisation des pratiques Université de Poitiers vendredi 16 octobre 2015 *** La croissance démographique et économique des colonies nord-américaines et caribéennes est intimement liée à l'exploitation et à l'introduction, dès le XVIIe siècle, de travailleurs non libres. Après le relatif échec de l'asservissement des Amérindiens, la mise en place de l'engagement répond au besoin de pallier le manque de main-d 'œuvre , tout en assurant le peuplement des colonies. En outre, la politique de déportation d'enfants vagabonds dans le cadre d'apprentissages, de gens sans aveu et autres condamnés de droit commun permet de délivrer le Vieux Continent de populations jugées indésirables. L'augmentation de l'immigration européenne entraînée par la diminution des frais de traversée, provoque la baisse du coût de revient des travailleurs libres et conduit à la mutation progressive du système d'engagement vers le Redemptioner system . Au cours du XVIIIe siècle, le recours grandissant à l'esclavage noir précipite la disparition de la servitude des travailleurs blancs. L'adoption de nouvelles formes de travail non libre répond, avant tout, à des impératifs économiques, aussi bien en termes de profitabilité que de gestion de la population servile. Cependant, la substitution d’une forme de main-d 'œuvre contrainte par une autre ne se produit pas de façon brutale et ordonnée : ce passage se traduit par une période de transition, étape durant laquelle coexistent plusieurs conditions juridiques non libres. Cette journée d'étude se propose d'historiciser l'instauration et le développement des formes de travail non libres dans l'espace nord-américain et caribéen avant l’abolition de l'esclavage. En portant un intérêt particulier aux processus de codification juridique qui régissent les différentes formes de servitudes contraintes, elle souhaite mettre en évidence les continuités, les emprunts et les ruptures entre les législations mais également entre les pratiques. Qu'elle soit engagée, apprentie, condamnée ou asservie, la main-d 'œuvre contrainte recouvre une grande diversité d'expériences personnelles et collectives, selon les époques et les lieux. Aussi, outre l'examen de la construction d'un arsenal juridique destiné au contrôle et à la discipline des travailleurs non libres, l'une des ambitions de cette journée sera également d'évaluer, au travers d'études de cas, l'écart entre les discours et les pratiques, afin de mettre en évidence la part irréductible de tout être ou groupe social à s’affranchir des injonctions normatives. Les participants sont invités à s'interroger sur les pistes, non exhaustives, de réflexion suivantes :Une approche comparative entre les législations, les époques et les régionsLe rôle joué par l'appartenance raciale, l'origine géographique ou la confession religieuse dans l'intégration sociale et dans le traitement des travailleurs non libresLes enjeux sociaux, politiques et sécuritaires posés dans la gestion de la population non libre dans les périodes de coexistence entre plusieurs statuts de travailleurs non libresL'assignation à des tâches professionnelles spécifiques selon le type de main-d' œuvre non libre et son importance démographiqueL'écart entre la/les législation(s) et la/les pratique(s)Le renouveau historiographique que permet le développement de nouvelles technologies, notamment en matière de traitement des données et de reconstruction des trajectoires personnelles ou collectives Les langues de la journée d’étude sont l’anglais et le français. Les propositions de communication, d’environ300 mots, incluant un titre et le rattachement institutionnel, ainsi qu’une courte biographie d’une page maximum sont à envoyer à l'adresse suivante boundlabour2015@gmail avant le 15 avril 2015 . Les actes seront publiés. Comité d'organisation : Lawrence Aje (Université Paul - Valéry, Montpellier 3 - EMMA) Anne-Claire Faucquez (Université Panthéon - Assas - EA 1569 : Transferts critiques et dynamiques des savoirs, Université Paris VIII) Elodie Peyrol-Kleiber (Université de Poitiers - MIMMOC) _______ One-day conference Bound labor in the Americas before the abolition of slavery: legal codifications, transfers and the harmonization of the practices Poitiers University, France, Friday October 16 th , 2015 *** From the 17 th century onwards, the demographic and economic growth of the North American and Caribbean colonies was intricately linked to the introduction and subsequent exploitation of bound labor. The implementation of indentured servitude addressed the need to compensate for the scarcity of labor, after the relative failure of the enslavement of Native Americans, while also assuring the peopling of the colonies. By the same token, the deportation of vagrant children, of vagabonds and convicts also provided a means for the Old Continent to rid itself of its undesirable population. The rise in European immigration that resulted from the decrease of sea transportation costs made free labor more economically attractive and gradually transformed the indentured servitude system into the Redemptioner System. During the course of the 18 th century, the increasing reliance on black bonded labor led to the disappearance of white indentured servitude. Economic incentives - be they in terms of productivity or in the cost of controlling the laborers - motivated the adoption of new forms of bound labor. However, the substitution of one form of unfree labor for another did not occur in a sudden and orderly fashion: the change was characterized by a period of transition during which several types of bound labor coexisted. This one-day conference aims at historicizing the implementation and development of different forms of bound labor in North America and in the Caribbean before the abolition of slavery. By specifically focusing on the process of legal codification, it intends to underline the continuities, the transfers and the differences that existed between the legislations which applied to various forms of unfree labor, but also between practices. Bound labor took many forms (indentured servitude, apprenticeship, convict labor, slavery, etc.) and encompassed diverse personal and collective experiences, depending on the geographic location and the historical period. Besides examining the construction of a legal arsenal aimed at controlling and disciplining unfree laborers, this one-day conference will also endeavor to assess, through case studies, the disparities between rhetoric and reality, in order to highlight the indomitable propensity for individuals or social groups to emancipate themselves from normative injunctions. We welcome presentations based on a variety of topics such as:a comparative approach between different legislations, different time periods and different geographic locationsthe extent to which social and geographical origins, or religious confession, influenced unfree laborers’ social integration and treatmentthe social and political difficulties posed by the coexistence of various forms of bound laborthe specialization and assignment to professional tasks according to the type of bound labor forcethe gap between law and practice the historiographic progress which the development of new technologies allows, namely in the treatment of data and the reconstruction of personal or collective trajectories The languages of the one-day conference will be French and English. For consideration, please submit a paper proposal of 300 words and a 1 page CV by April 15, 2015 to boundlabor2015@gmail.com A selection of papers presented at the conference will be published. Conference organizers: Lawrence Aje (Université Paul -Valéry, Montpellier 3 - EMMA) Anne-Claire Fauquez (Université Panthéon - Assas - EA 1569: Transferts critiques et dynamiques des savoirs, Université Paris VIII) Elodie Peyrol-Kleiber (Université de Poitiers - MIMMOC)
↧
A. Honneth, Ce que social veut dire , t. 2 : Les pathologies de la raison
 Ce que social veut dire - Tome 2, Les pathologies de la raison Axel Honneth Pierre Rusch (Traducteur) Date de parution : 15/01/2015 Editeur : Gallimard (Editions) Collection : NRF Essais ISBN : 978-2-07-014343-6 EAN : 9782070143436 Présentation : Broché Nb. de pages : 400 p. Le tome I de Ce que social veut dire (2013), centré sur "Le déchirement du social", dégage, par le biais notamment d'une confrontation avec la tradition de la philosophie sociale (Sartre, Lévi-Strauss, Merleau-Ponty, Castoriadis, Bourdieu, Boltanski et Thévenot), le modèle du conflit mis en oeuvre par la théorie de la "lutte pour la reconnaissance". Mais se pose alors le problème de la justification normative de ce modèle. Deux possibilités s'offrent, qui ont longtemps paru s'exclure mutuellement : soit la valeur normative des luttes pour la reconnaissance est appréciée selon ce qu'elles apportent à la réalisation d'une "vie bonne" parmi les membres de la société ; soit leur rôle normatif se mesure à leur contribution à l'instauration de la «justice» sociale dans la société. Dans le premier cas, c'est la réalisation individuelle de soi qui constitue le critère normatif, et, dans le deuxième, la répartition équitable des libertés individuelles entre tous les membres de la société. Renouant avec la tradition de la Théorie critique, Honneth se confronte ici avec Adorno, Benjamin, Neumann, Mitscherlich, Wellmer, mais aussi la psychanalyse et la théorie de la justice ; il établit qu'à la différence d'autres terminologies morales qui peuvent être mobilisées pour juger de l'état normatif des sociétés - que ce soient les concepts "d'aliénation" ou de "réification" d'un côté, de "discrimination" ou "d'exploitation" de l'autre, mais qui ne relèvent que de la philosophie sociale ou de la philosophie politique -, la lutte pour la reconnaissance est à la fois l'indicateur d'une pathologie sociale et l'indice d'une injustice. Sommaire : PATHOLOGIES DE LA RAISON Une physionomie de la forme de vie capitaliste Une dialectique retitutive - l'introduction d'Adorno à la Dialectique négative Une critique reconstitutive de la société sous réserve généalogique LES CONSEQUENCES DE LA PSYCHANALYSE Le moi dans le nous - la reconnaissance comme force motrice du groupe Désarmer le réel - les formes profanes de la consolation S'approprier sa liberté - la conception freudienne de la relation individuelle à soi FACETTES DE LA JUSTICE Le tissu de la justice - sur les limites du procéduralisme contemporain La reconnaissance entre Etats - l'arrière plan moral des relations interétatiques Philosophe et sociologue, Axel Honneth est né en 1949. Il dirige depuis 2001 l'Institut de recherche sociale de l'université de Francfort où il a succédé à Jürgen Habermas. Il incarne ce que l'on appelle "la troisième génération de l'Ecole de Francfort". De lui, les Editions Gallimard ont déjà publié La réification. Petit traité de Théorie critique (NRF Essais, 2007), La lutte pour la reconnaissance (Folio essais n° 576), Ce que social veut dire, 1. Le déchirement du social (NRF Essais, 2013).
Ce que social veut dire - Tome 2, Les pathologies de la raison Axel Honneth Pierre Rusch (Traducteur) Date de parution : 15/01/2015 Editeur : Gallimard (Editions) Collection : NRF Essais ISBN : 978-2-07-014343-6 EAN : 9782070143436 Présentation : Broché Nb. de pages : 400 p. Le tome I de Ce que social veut dire (2013), centré sur "Le déchirement du social", dégage, par le biais notamment d'une confrontation avec la tradition de la philosophie sociale (Sartre, Lévi-Strauss, Merleau-Ponty, Castoriadis, Bourdieu, Boltanski et Thévenot), le modèle du conflit mis en oeuvre par la théorie de la "lutte pour la reconnaissance". Mais se pose alors le problème de la justification normative de ce modèle. Deux possibilités s'offrent, qui ont longtemps paru s'exclure mutuellement : soit la valeur normative des luttes pour la reconnaissance est appréciée selon ce qu'elles apportent à la réalisation d'une "vie bonne" parmi les membres de la société ; soit leur rôle normatif se mesure à leur contribution à l'instauration de la «justice» sociale dans la société. Dans le premier cas, c'est la réalisation individuelle de soi qui constitue le critère normatif, et, dans le deuxième, la répartition équitable des libertés individuelles entre tous les membres de la société. Renouant avec la tradition de la Théorie critique, Honneth se confronte ici avec Adorno, Benjamin, Neumann, Mitscherlich, Wellmer, mais aussi la psychanalyse et la théorie de la justice ; il établit qu'à la différence d'autres terminologies morales qui peuvent être mobilisées pour juger de l'état normatif des sociétés - que ce soient les concepts "d'aliénation" ou de "réification" d'un côté, de "discrimination" ou "d'exploitation" de l'autre, mais qui ne relèvent que de la philosophie sociale ou de la philosophie politique -, la lutte pour la reconnaissance est à la fois l'indicateur d'une pathologie sociale et l'indice d'une injustice. Sommaire : PATHOLOGIES DE LA RAISON Une physionomie de la forme de vie capitaliste Une dialectique retitutive - l'introduction d'Adorno à la Dialectique négative Une critique reconstitutive de la société sous réserve généalogique LES CONSEQUENCES DE LA PSYCHANALYSE Le moi dans le nous - la reconnaissance comme force motrice du groupe Désarmer le réel - les formes profanes de la consolation S'approprier sa liberté - la conception freudienne de la relation individuelle à soi FACETTES DE LA JUSTICE Le tissu de la justice - sur les limites du procéduralisme contemporain La reconnaissance entre Etats - l'arrière plan moral des relations interétatiques Philosophe et sociologue, Axel Honneth est né en 1949. Il dirige depuis 2001 l'Institut de recherche sociale de l'université de Francfort où il a succédé à Jürgen Habermas. Il incarne ce que l'on appelle "la troisième génération de l'Ecole de Francfort". De lui, les Editions Gallimard ont déjà publié La réification. Petit traité de Théorie critique (NRF Essais, 2007), La lutte pour la reconnaissance (Folio essais n° 576), Ce que social veut dire, 1. Le déchirement du social (NRF Essais, 2013).
↧
C. Froidevaux-Metterie, La révolution du féminin
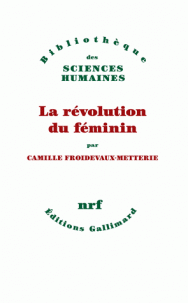 La révolution du féminin Camille Froidevaux-Metterie Date de parution : 08/01/2015 Editeur : Gallimard (Editions) Collection : Bibliothèque Sciences Humaine ISBN : 978-2-07-014752-6 EAN : 9782070147526 Présentation : Broché Nb. de pages : 384 p. Le mouvement féministe a produit bien plus qu'une dynamique d'égalisation des conditions féminine et masculine. Il a contribué, montre Camille Froidevaux-Metterie, à réorganiser en profondeur notre monde commun, à la faveur d'un processus toujours en cours qui voit les rôles familiaux et les fonctions sociales se désexualiser. Par-delà les obstacles qui empêchent de conclure à une rigoureuse égalité des sexes, il faut ainsi repérer que nous sommes en train de vivre une véritable mutation à l'échelle de l'histoire humaine. Plus d'attributions sexuées ni de partage hiérarchisée des tâches : dans nos sociétés occidentales, la convergence des genres est en marche. La similitude de destin des hommes et des femmes ne renvoie pourtant à aucune homogénéisation. Dans un monde devenu mixte de part en part, les individus se trouvent plus que jamais requis de se définir en tant qu'homme ou en tant que femme. Or ils ne peuvent le faire sans prendre en considération la sexuation des corps. S'évertuer à la nier, comme le fait un certain féminisme, c'est heurter de plein fouet cette donnée nouvelle qui veut que la maîtrise de sa singularité sexuée soit la marque même de la subjectivité. L'auteure entreprend ainsi de réévaluer la corporéité féminine pour en faire le vecteur d'une expérience inédite englobant l'impératif universaliste des droits individuels et l'irréductible incarnation de toute existence. Le sujet féminin contemporain se révèle alors être le modèle d'une nouvelle condition humaine. Sommaire: LA DESEXUALISATION DU VIVRE ENSEMBLE La hiérarchisation sexuée du monde L'âge masculin de l'autonomie La modernité sans les femmes GENEALOGIES DU FEMININ L'anthropologie, entre universalité de la domination et relativité des rôles La psychanalyse face à l'énigme du féminin La théorie féministe ou comment le sujet féminin à disparu L'EXPERIENCE DU FEMININ Phénoménologie du féminin Ce corps que les femmes habitent Camille Froidevaux-Metterie est professeure de science politique à l'université de Reims Champagne-Ardenne et membre de l'Institut universitaire de France.
La révolution du féminin Camille Froidevaux-Metterie Date de parution : 08/01/2015 Editeur : Gallimard (Editions) Collection : Bibliothèque Sciences Humaine ISBN : 978-2-07-014752-6 EAN : 9782070147526 Présentation : Broché Nb. de pages : 384 p. Le mouvement féministe a produit bien plus qu'une dynamique d'égalisation des conditions féminine et masculine. Il a contribué, montre Camille Froidevaux-Metterie, à réorganiser en profondeur notre monde commun, à la faveur d'un processus toujours en cours qui voit les rôles familiaux et les fonctions sociales se désexualiser. Par-delà les obstacles qui empêchent de conclure à une rigoureuse égalité des sexes, il faut ainsi repérer que nous sommes en train de vivre une véritable mutation à l'échelle de l'histoire humaine. Plus d'attributions sexuées ni de partage hiérarchisée des tâches : dans nos sociétés occidentales, la convergence des genres est en marche. La similitude de destin des hommes et des femmes ne renvoie pourtant à aucune homogénéisation. Dans un monde devenu mixte de part en part, les individus se trouvent plus que jamais requis de se définir en tant qu'homme ou en tant que femme. Or ils ne peuvent le faire sans prendre en considération la sexuation des corps. S'évertuer à la nier, comme le fait un certain féminisme, c'est heurter de plein fouet cette donnée nouvelle qui veut que la maîtrise de sa singularité sexuée soit la marque même de la subjectivité. L'auteure entreprend ainsi de réévaluer la corporéité féminine pour en faire le vecteur d'une expérience inédite englobant l'impératif universaliste des droits individuels et l'irréductible incarnation de toute existence. Le sujet féminin contemporain se révèle alors être le modèle d'une nouvelle condition humaine. Sommaire: LA DESEXUALISATION DU VIVRE ENSEMBLE La hiérarchisation sexuée du monde L'âge masculin de l'autonomie La modernité sans les femmes GENEALOGIES DU FEMININ L'anthropologie, entre universalité de la domination et relativité des rôles La psychanalyse face à l'énigme du féminin La théorie féministe ou comment le sujet féminin à disparu L'EXPERIENCE DU FEMININ Phénoménologie du féminin Ce corps que les femmes habitent Camille Froidevaux-Metterie est professeure de science politique à l'université de Reims Champagne-Ardenne et membre de l'Institut universitaire de France.
↧
↧
Thèse O. Gargano : "L'image de l'Albanie à partir des récits de voyage des XIXe et XX s., notamment à travers les œuvres d'Edith Durham, Alexandre Degrand, Ugo Ojetti"
UNIVERSITÉ NICE SOPHIA ANTIPOLIS C. T. E. L. Thèse de Doctorat en Cotutelle Internationale Discipline : Littérature Comparée L’image de l’Albanie à partir des récits de voyage des XIXe et XXe siècles, notamment à travers les œuvres de Mary Edith Durham (High Albania, 1909), Alexandre Degrand (Souvenirs de la Haute-Albanie, 1901), Ugo Ojetti (L’Albania, 1902) Candidat : Olimpia Gargano Directeur de thèse : Odile Gannier Codirecteur : Paolo Amalfitano Soutenance : 27 février 2015, 14h, Salle du Conseil, Université Nice Sophia Antipolis Jury Paolo Amalfitano Professeur de Littérature Anglaise, Università « L’Orientale », Naples Sylvie Ballestra-Puech Professeur de Littérature Comparée, Université Nice Sophia Antipolis Odile Gannier Professeur de Littérature Comparée, Université Nice Sophia Antipolis Monica Genesin Professeur de Langue et Littérature Albanaise, Università del Salento, Lecce (Rapporteur) Donatella Izzo Professeur de Littérature Nord-Américaine, Università « L’Orientale », Naples Philippe Marty Professeur de Littérature Comparée, Université Montpellier III (Rapporteur) Tout en étant au beau milieu de la mer Méditerranée, l’Albanie est demeurée longtemps l’un des pays européens les plus méconnus. Aux yeux des autres Européens, ce pays qui depuis la fin du XVe siècle était resté pendant presque cinq cents ans sous la domination ottomane était un mystérieux avant-poste de l’Islam au cœur de l’Europe. Ce fut seulement au tout début des années 1800 qu’on commença à l’inclure parmi les destinations du « Grand Tour ». Cette recherche a visé à dégager les typologies de la représentation par lesquelles des voyageurs, des écrivains et des artistes européens virent le pays, ses coutumes et ses gens, en en donnant celles qui allaient devenir les « images » par lesquelles l’Albanie était conçue par les étrangers. Les sources abordées vont du début du XIXe siècle (quand le pays fit son entrée dans le panthéon de la littérature européenne grâce au "Pèlerinage de Childe Harold" de Lord Byron) aux années 1940. À partir d’un corpus primaire comprenant les "Souvenirs de la Haute-Albanie" du consul français Alexandre Degrand, "L’Albania" de l’écrivain-journaliste italien Ugo Ojetti, et "High Albania" de l’Anglaise Mary Edith Durham, à qui en raison de son complexe travail ethno-anthropologique a été consacrée une attention particulière, le champ d’observation s’est élargi jusqu’à inclure un large éventail de textes allant des récits diplomatiques aux journaux de voyage, des œuvres fictionnelles aux articles de presse. En outre, dans la conviction que, dans le processus de la création de l’image de l’Autre, une place éminente revient au corpus iconologique, une attention particulière a été portée au côté proprement figuratif, constitué par des tableaux, des croquis, des illustrations et d’autres formes de la visualisation par lesquelles on représentait des thèmes albanais ; leur observation a constitué un outil essentiel aux fins de l’identification du réseau historico-conceptuel où prit forme l’image de l’Albanie. Enfin, une étude à part entière a été consacrée à un cas assez particulier de la représentation, consistant en des ouvrages se déroulant dans de pays fictionnels inspirés de l’Albanie ; rédigés entre la fin du XIXe et nos jours, ils montrent une concentration de clichés et de stéréotypes, constituant ainsi un test réactif pour détecter certaines des sources de l’image de l’Albanie dans le courant dominant contemporain.
↧
Th. A. Edison, Le Royaume de l'au-delà
 Référence bibliographique : Thomas A. Edison, Le Royaume de l'au-delà , Jérôme Millon, collection "Golgotha", 2015. EAN13 : 9782841373147. Le Royaume de l'au-delà Thomas Alva Edison Précédé de Machines nécrophoniques par Philippe Baudouin 176 pages — 17 € — Parution le 5 mars 2015 — « J'ai cherché à construire un appareil scientifique, permettant aux morts, si la chose est possible, d'entrer en relation avec nous ». Thomas Edison Après avoir déposé ses 1093 brevets dont la lampe à incandescence, la pile alcaline, la chaise électrique ou le phonographe, l'inventeur Thomas Edison (1847-1931) cherchait à mettre au point une machine à communiquer avec les morts. Alors que la plupart de ses biographes ont exploré les moindres détails de son œuvre, ils restent silencieux sur les expérimentations que mena Edison durant les 10 dernières années de sa vie autour des phénomènes occultes. Quel fut son projet inachevé de "nécrophone" ? Longtemps oublié et méconnu, Le Royaume de l'au-delà est l'unique texte de Thomas A. Edison rassemblant ses recherches dans le domaine des sciences psychiques. Les notes d’Edison, présentées sous 6 chapitres, sont précédées d’un essai intitulé Machine nécrophoniques , de Philippe Baudouin, chargé de réalisation à France Culture et philosophe. Ce texte nous renseigne sur le contexte historique, et analyse les enjeux et les portées du texte d’Edison, tout en nous éclairant sur sa place et son importance dans le parcours du célèbre inventeur.
Référence bibliographique : Thomas A. Edison, Le Royaume de l'au-delà , Jérôme Millon, collection "Golgotha", 2015. EAN13 : 9782841373147. Le Royaume de l'au-delà Thomas Alva Edison Précédé de Machines nécrophoniques par Philippe Baudouin 176 pages — 17 € — Parution le 5 mars 2015 — « J'ai cherché à construire un appareil scientifique, permettant aux morts, si la chose est possible, d'entrer en relation avec nous ». Thomas Edison Après avoir déposé ses 1093 brevets dont la lampe à incandescence, la pile alcaline, la chaise électrique ou le phonographe, l'inventeur Thomas Edison (1847-1931) cherchait à mettre au point une machine à communiquer avec les morts. Alors que la plupart de ses biographes ont exploré les moindres détails de son œuvre, ils restent silencieux sur les expérimentations que mena Edison durant les 10 dernières années de sa vie autour des phénomènes occultes. Quel fut son projet inachevé de "nécrophone" ? Longtemps oublié et méconnu, Le Royaume de l'au-delà est l'unique texte de Thomas A. Edison rassemblant ses recherches dans le domaine des sciences psychiques. Les notes d’Edison, présentées sous 6 chapitres, sont précédées d’un essai intitulé Machine nécrophoniques , de Philippe Baudouin, chargé de réalisation à France Culture et philosophe. Ce texte nous renseigne sur le contexte historique, et analyse les enjeux et les portées du texte d’Edison, tout en nous éclairant sur sa place et son importance dans le parcours du célèbre inventeur.
↧
Méthodes, pratiques & enjeux des études littéraires. Questions et regards de doctorant.es sur la discipline
Méthodes, pratiques et enjeux des études littéraires Questions et regards des doctorant·es sur la discipline Journée d'études des doctorant.es de Passages XX-XXI, en collaboration avec le CERCC et avec le soutien de l'Ecole Doctorale 3LA Vendredi 6 février 2015 Amphi Benveniste, MSH-Maison de l'Orient et de la Méditerranée. 7, rue Raulin (Lyon 7) Programme 10h Accueil des participant·es et présentation de la journée 10h30 Conférence d’ouverture par Jérôme DAVID (Professeur à l’Université de Genève) 11h-11h30 Gabrielle TREMBLAY (Université du Québec à Montréal) : Le scénario de cinéma, un objet littéraire ? 11h30-12h Hélène BISTER (Passages XX-XXI, Lyon 2) : Poétique(s) du rythme 12h-12h30 Discussion 14h30-15h Maxime TRIQUENAUX (LIRE, Lyon 2) : Dépasser le « bon voisinage » : histoire culturelle et dicipline littéraire 15h-15h30 Raphaël LUIS (CERCC, Lyon 3) : Un dilemme comparatiste : de la lecture idéale au « distant reading » 15h30-16h Hasnia ZADDAM (Passages XX-XXI, Lyon 2) : Sommes-nous libres de ce que nous écrivons ? 16h-17h Discussion et conclusion Journée organisée par Eléonore Devevey (Doctorante, Lyon 2, Passages XX-XXI), Chloé Jacquesson (Doctorante, Lyon 2, Passages XX-XXI), Raphaël Luis (Doctorant, Lyon 3, CERCC), Sibylle Orlandi (Doctorante, Lyon 2, Passages XX-XXI). Contacts : eleonore.devevey@gmail.com / chloe.jacquesson@univ-lyon2.fr
↧
P. Paré-Rey (dir.), L’Aparté dansle théâtre antique .Un procédé dramatique àredécouvrir
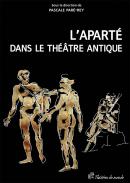 L’Aparté dansle théâtre antique .Un procédé dramatique àredécouvrir Sous la direction de Pascale Paré-Rey Saint-Denis : Presses Universitaires de Vincennes, coll. "Théâtres du monde", 2015. EAN 9782842924195. 360p. Prix 26EUR. Présentation de l'éditeur : L’aparté dans le théâtre antique existe-t-il ? Les manuscrits l’ignorent, les contraintes matérielles et les conventions de ce théâtre (de plein air, le plus souvent masqué) semblent proscrire son usage. Pourtant, certains passages exigent un jeu de l’acteur qui marque un tel décrochage énonciatif. Mais ce jeu étant mal connu, nous abordons les apartés en cherchant en priorité dans le texte les bornes, formes et fonctions de leurs occurrences possibles, sans nous interdire une réflexion sur leur mise en scène : l’épreuve du plateau fait l’objet d’un enregistrement présentant diverses solutions pour des extraits choisis. Une vidéo associée à ce livre est consultable à cette adresse : http://bit.ly/video-aparte. SOMMAIRE À la recherche de l’aparté dansle théâtre antique Pascale Paré-Rey I. Les conditionsd’émergence de l’aparté.Théorie classique et pratiques antiques L’aparté dans la poétique et le théâtreclassiques en France (XVII e siècle) Nathalie Fournier L’aparté existe-t-il dans le théâtregrec du V e siècle ? Christine Mauduit II. Apartés tragiques Les apartés dans le théâtre de Sénèque: mode de sélection et corpus Jean-Pierre Aygon Dramaturgie de l’aparté dans lestragédies de sénèque Pascale Paré-Rey III. Apartés comiques Usages de l’aparté dans quelquescomédies de Ménandre Christophe Cusset etNathalie Lhostis Les apartés chez Plaute : définitionet corpus critique Christina Filoche L’aparté chez Plaute, à proposd’un passage d’Amphitryon(v. 153-340) Isabelle David IV. L’aparté dans lescommentaires antiqueset les éditions modernes Hoc enim apud se : la conscience del’aparté et de ses potentialités comiqueschez Donat commentateur de térence Bruno Bureau et Christian Nicolas La notation des apartés dans les éditions modernes et contemporaines de Plaute :un piège herméneutique Pierre Letessier V. Du texte à la scène Les coulisses de l’aparté – mettre enscène les apartés du théâtre antique : problèmes et tentatives Estelle Baudou avec la collaboration des comédiens :Fanny Bloc, Maxime Peyron et BaptisteVérine VI. Bilan et perspectives L’aparté : un « petit écueil semésur la route théâtrale » ou un« laboratoire théâtral » ? Pascale Paré-Rey
L’Aparté dansle théâtre antique .Un procédé dramatique àredécouvrir Sous la direction de Pascale Paré-Rey Saint-Denis : Presses Universitaires de Vincennes, coll. "Théâtres du monde", 2015. EAN 9782842924195. 360p. Prix 26EUR. Présentation de l'éditeur : L’aparté dans le théâtre antique existe-t-il ? Les manuscrits l’ignorent, les contraintes matérielles et les conventions de ce théâtre (de plein air, le plus souvent masqué) semblent proscrire son usage. Pourtant, certains passages exigent un jeu de l’acteur qui marque un tel décrochage énonciatif. Mais ce jeu étant mal connu, nous abordons les apartés en cherchant en priorité dans le texte les bornes, formes et fonctions de leurs occurrences possibles, sans nous interdire une réflexion sur leur mise en scène : l’épreuve du plateau fait l’objet d’un enregistrement présentant diverses solutions pour des extraits choisis. Une vidéo associée à ce livre est consultable à cette adresse : http://bit.ly/video-aparte. SOMMAIRE À la recherche de l’aparté dansle théâtre antique Pascale Paré-Rey I. Les conditionsd’émergence de l’aparté.Théorie classique et pratiques antiques L’aparté dans la poétique et le théâtreclassiques en France (XVII e siècle) Nathalie Fournier L’aparté existe-t-il dans le théâtregrec du V e siècle ? Christine Mauduit II. Apartés tragiques Les apartés dans le théâtre de Sénèque: mode de sélection et corpus Jean-Pierre Aygon Dramaturgie de l’aparté dans lestragédies de sénèque Pascale Paré-Rey III. Apartés comiques Usages de l’aparté dans quelquescomédies de Ménandre Christophe Cusset etNathalie Lhostis Les apartés chez Plaute : définitionet corpus critique Christina Filoche L’aparté chez Plaute, à proposd’un passage d’Amphitryon(v. 153-340) Isabelle David IV. L’aparté dans lescommentaires antiqueset les éditions modernes Hoc enim apud se : la conscience del’aparté et de ses potentialités comiqueschez Donat commentateur de térence Bruno Bureau et Christian Nicolas La notation des apartés dans les éditions modernes et contemporaines de Plaute :un piège herméneutique Pierre Letessier V. Du texte à la scène Les coulisses de l’aparté – mettre enscène les apartés du théâtre antique : problèmes et tentatives Estelle Baudou avec la collaboration des comédiens :Fanny Bloc, Maxime Peyron et BaptisteVérine VI. Bilan et perspectives L’aparté : un « petit écueil semésur la route théâtrale » ou un« laboratoire théâtral » ? Pascale Paré-Rey
↧
↧
A.-A. Kekeh-Dika, M. Graham, J. A. Mayes (dir.), Toni Morrison. Au-delà du visible ordinaire. Beyond the ordinary visible
Référence bibliographique : Andrée-Anne Kekeh-Dika, Maryemma Graham, Janis A. Mayes (dir.), Toni Morrison. Au-delà du visible ordinaire. Beyond the ordinary visible , Presses Universitaires de Vincennes, collection "L'imaginaire du texte", 2015. EAN13 : 9782842924133. Andrée-Anne Kekeh-Dika, Maryemma Graham, Janis A. Mayes (dir.), Toni Morrison. Au-delà du visible ordinaire. Beyond the ordinary visible (PUV, Saint-Denis, 2015, 18 €) « Who could mistake a sign that clear ? », « Qui pouvait se méprendre sur un signe aussi évident » ?, lit-on dans Home, dixième roman de Toni Morrison paru en 2012. À partir de leurs langues respectives, le français et l’anglais principalement, les auteurs de ce livre ont pris cette question au sérieux pour arpenter l’univers fictionnel et discursif de Toni Morrison dans ses romans, ses entretiens et ses essais. Ils se sont attachés à suivre les « petits mécanismes qui régissent la vie quotidienne » et à saisir ce qui s’entrevoit au-delà de la surface du monde ou du mot ordinaire. L’ouvrage s’ouvre avec « Stones » et « Shelter », deux poèmes de Toni Morrison accompagnés d’une traduction inédite en français. SOMMAIRE La vérité sans apprêt ou lespouvoirs de l’ordinaire Andrée-Anne Kekeh-Dika From the Village to the World:Toni Morrison’s CriticalGeography Maryemma Graham I. Dans le creuxdes mots… A Mercy Textual Inventions:Reading A Mercy A Mercy : les lettres-paroles de Florens, ou la prose du mondeordinaire Emmanuelle Andrès Across Distances WithoutRecognition: Susceptibility,Immunity, and the Dilemmaof Speculative Agency inAMercy Herman Beavers Paroles de pierre: lire A Mercy(avec Derrida) Claudine Raynaud II. Les voies de l’objet :figuration, circulation,savoirs Objects : Figuration,Significations and TheCirculation of Knowledge Au-delà du « destin manifeste »,« une idée du paradis dans la vie, non dans l’après-vie », oul’art d’apprendre à y voir sans images Claude Le Fustec Des choses et des mots :l’ancrage sensuel d’unephilosophie Annie-Paule Mielle dePrinsac Photography and Prose Pictures in Beloved:The Frames of Emotional Memory Dana Mihăilescu III. Ramifications Transformation Beyond theOrdinary “Neo-slave Narratives”and Literacies of Maroonage:Rereading Morrison with Dionne Brand, George Jackson, andAssata Shakur Greg Thomas Interior Designs: Re-introducing Morrison / Translation as Black Literary Passaging—Beyond theOrdinary Visible Afterword Janis A. Mayes
↧
B. Lahire, Ceci n'est pas qu'un tableau. Essai sur l'art, la domination, la magie et le sacré
 Ceci n'est pas qu'un tableau - Essai sur l'art, la domination, la magie et le sacré Bernard Lahire Date de parution : 15/01/2015 Editeur : La Découverte Collection : Laboratoire sciences sociales ISBN : 978-2-7071-8521-1 EAN : 9782707185211 Présentation : Broché Nb. de pages : 597 p. En 1657, Nicolas Poussin peint une Fuite en Égypte au voyageur couché, une toile qui disparaît ensuite pendant plusieurs siècles. Dans les années 1980, plusieurs versions du tableau réapparaissent. De grands experts mondiaux s'opposent, des laboratoires d'analyse et des tribunaux s'en mêlent et nombreux sont ceux – galeristes, experts, directeurs de musée, conservateurs, etc. – à vouloir authentifier l'une ou l'autre des toiles, puis à souhaiter s'approprier le chef-d'œuvre désigné. L'une des versions sera finalement acquise, pour 17 millions d'euros, par le Musée des Beaux-arts de Lyon. De quoi nous parle cette histoire aux allures d'intrigue policière ? Pourquoi une telle débauche d'énergies, de controverses et d'argent pendant autant d'années ? Qu'est-ce qui fait la valeur – économique, esthétique – d'une œuvre d'art ? Et d'où vient cette aura attachée aux créateurs et aux œuvres ? L'enquête impressionnante de Bernard Lahire met en évidence le fait que le sacré n'a jamais disparu de notre monde, mais qu'il s'est transformé au point de s'être rendu invisible. La magie sociale est omniprésente dans le domaine de l'économie, de la politique, du droit, de la science ou de l'art autant que dans celui de la mythologie ou de la religion, car elle est l'effet d'enchantement produit par le pouvoir sur ceux qui en reconnaissent tacitement l'autorité. C'est cet enchantement qui transforme une sculpture d'animal en totem, un morceau de métal en monnaie, un papier en titre de propriété, une eau banale en eau bénite ; et c'est cette même magie sociale qui fait passer un tableau du statut de simple copie à celui de chef-d'œuvre. Puisant avec érudition dans les vastes domaines du savoir anthropologique, historique et sociologique, Ceci n'est pas qu'un tableau interroge, grâce à une série de régressions historiques, les socles de croyance sur lesquels nos institutions et nos perceptions reposent. Questionnant radicalement l'art et son ambition émancipatrice, il révèle les formes de domination qui se cachent derrière l'admiration des œuvres. Bernard Lahire, professeur de sociologie à l'École normale supérieure de Lyon, a publié une vingtaine d'ouvrages, parmi lesquels L'Homme pluriel (Nathan, 1998), La Culture des individus (La Découverte, 2004), Franz Kafka. Éléments pour une théorie de la création littéraire (La Découverte, 2010) et Monde pluriel : penser l'unité des sciences sociales (Seuil, 2012). Voir sur le site de l'éditeur… Sommaire: Introduction D'une toile, tirer le fil Fuites en Égypte : trajectoires, concurrences et controverses Rompre avec la logique des récits fabuleux - Tableaux qualifiés, classifiés et illusions rétrospectives Le réel : entre continuité matérielle et discontinuité sociale Les objets de la recherche : statuts, valeurs et modes de comportements Tirer le fil Coda Livre 1 : Histoire, domination et magie sociale 1. États de faits et socles de croyances 2. Domination et magie sociale Les formes objectives de la domination Un problème caché sous le morcellement des points de vue Capital ou effets symboliques ? Esquisse d'une théorie générale de la magie du pouvoir 3. L'articulation des oppositions : dominants/dominés et sacré/profane Histoire des transformations conjointes du pouvoir et du sacré Magie et pouvoir dans les sociétés sans État Magie et pouvoir dans les sociétés à État Le haut et le bas Des fictions politiques ou comment l'homme a créé Dieu à son image Les luttes pour l'appropriation du sacré Sécularisation, transferts de sacralité et fondements sacrés de toute société Livre 2 - Art, domination, sacralisation 4. L'extension du domaine du sacré : l'émergence de l'art comme domaine autonome et séparé du profane Poètes et artistes, souverains ou démiurges L'histoire d'une sacralisation collective Des reliques aux oeuvres d'art La séparation de l'art et de la vie Admirer avant d'interpréter Sous l'admiration, la domination La magie des tableaux Récits fabuleux et mystifications Copies et faux 5. Authentification, attribution Où chercher les vérités scientifiques ? Être expert : faire des choses avec des mots Acte performatif I : le catalogue raisonné Acte performatif II : l'exposition Attributions et désattributions : controverses et changements d'avis Histoire et logique de l'attributionnisme La science au service du sacré Désévidencier l'authentique Livre 3 - Du Poussin et de quelques Fuites en Égypte 6. Sublime Poussin : maître du classicisme français Parcours d'un artiste à contretemps et à contre-pente : indépendance et liberté de création Peintre-philosophe et artiste Sur la fortune de Poussin À l'art, la nation reconnaissante 7. Le fabuleux destin de tableaux attribués à Nicolas Poussin Raccordements, associations et statuts de l'objet Histoire de toiles Le tableau d'un grand peintre au talent déclinant Les traces d'un tableau admirable Trois apparitions - La montée d'une controverse - L'épreuve de la confrontation - Le travail souterrain des galeristes - La première reconnaissance publique de la version « Pardo » Rebondissement : la demande d'annulation de la vente de 1986 L'acquisition d'un trésor national À la recherche des mécènes La magie d'un chef-d'oeuvre Clore une controverse Les conditions de l'envoûtement et du désenvoûtement Une version sans expert 8. Poussin, la science, le droit et le marché Poussin au laboratoire Analyses de la version « Piasecka-Johnson » - Analyses de la version « Pardo-MBA de Lyon »Poussin au tribunal Erreur sur la substance - Un précédent déterminant : le cas d'Olympos et Marsyas ou l'« affaire Saint-Arroman » - Le procès de l'« autre affaire Poussin » Le prix d'un tableau 9. Comment chacun joue son jeu Des historiens de l'art : qui a l'oeil ? Sir Anthony Blunt (1907-1983) - Sir Denis Mahon (1910-2011) - Jacques Thuillier(1928-2011) - Pierre Rosenberg (1936-) Des galeristes : jouer (et perdre) son jeu Une directrice de musée : jouer (et gagner) son jeu Conclusions Se tenir en deçà des champs À la racine des croyances Donner à voir le monstre invisible Un jeu savant fragile Post-scriptum Les conditions de la création scientifique Remerciements Liste résumée des données exploitées Éléments bibliographiques Bibliographie documentaire Index des noms d'auteur Index thématique et conceptuel.
Ceci n'est pas qu'un tableau - Essai sur l'art, la domination, la magie et le sacré Bernard Lahire Date de parution : 15/01/2015 Editeur : La Découverte Collection : Laboratoire sciences sociales ISBN : 978-2-7071-8521-1 EAN : 9782707185211 Présentation : Broché Nb. de pages : 597 p. En 1657, Nicolas Poussin peint une Fuite en Égypte au voyageur couché, une toile qui disparaît ensuite pendant plusieurs siècles. Dans les années 1980, plusieurs versions du tableau réapparaissent. De grands experts mondiaux s'opposent, des laboratoires d'analyse et des tribunaux s'en mêlent et nombreux sont ceux – galeristes, experts, directeurs de musée, conservateurs, etc. – à vouloir authentifier l'une ou l'autre des toiles, puis à souhaiter s'approprier le chef-d'œuvre désigné. L'une des versions sera finalement acquise, pour 17 millions d'euros, par le Musée des Beaux-arts de Lyon. De quoi nous parle cette histoire aux allures d'intrigue policière ? Pourquoi une telle débauche d'énergies, de controverses et d'argent pendant autant d'années ? Qu'est-ce qui fait la valeur – économique, esthétique – d'une œuvre d'art ? Et d'où vient cette aura attachée aux créateurs et aux œuvres ? L'enquête impressionnante de Bernard Lahire met en évidence le fait que le sacré n'a jamais disparu de notre monde, mais qu'il s'est transformé au point de s'être rendu invisible. La magie sociale est omniprésente dans le domaine de l'économie, de la politique, du droit, de la science ou de l'art autant que dans celui de la mythologie ou de la religion, car elle est l'effet d'enchantement produit par le pouvoir sur ceux qui en reconnaissent tacitement l'autorité. C'est cet enchantement qui transforme une sculpture d'animal en totem, un morceau de métal en monnaie, un papier en titre de propriété, une eau banale en eau bénite ; et c'est cette même magie sociale qui fait passer un tableau du statut de simple copie à celui de chef-d'œuvre. Puisant avec érudition dans les vastes domaines du savoir anthropologique, historique et sociologique, Ceci n'est pas qu'un tableau interroge, grâce à une série de régressions historiques, les socles de croyance sur lesquels nos institutions et nos perceptions reposent. Questionnant radicalement l'art et son ambition émancipatrice, il révèle les formes de domination qui se cachent derrière l'admiration des œuvres. Bernard Lahire, professeur de sociologie à l'École normale supérieure de Lyon, a publié une vingtaine d'ouvrages, parmi lesquels L'Homme pluriel (Nathan, 1998), La Culture des individus (La Découverte, 2004), Franz Kafka. Éléments pour une théorie de la création littéraire (La Découverte, 2010) et Monde pluriel : penser l'unité des sciences sociales (Seuil, 2012). Voir sur le site de l'éditeur… Sommaire: Introduction D'une toile, tirer le fil Fuites en Égypte : trajectoires, concurrences et controverses Rompre avec la logique des récits fabuleux - Tableaux qualifiés, classifiés et illusions rétrospectives Le réel : entre continuité matérielle et discontinuité sociale Les objets de la recherche : statuts, valeurs et modes de comportements Tirer le fil Coda Livre 1 : Histoire, domination et magie sociale 1. États de faits et socles de croyances 2. Domination et magie sociale Les formes objectives de la domination Un problème caché sous le morcellement des points de vue Capital ou effets symboliques ? Esquisse d'une théorie générale de la magie du pouvoir 3. L'articulation des oppositions : dominants/dominés et sacré/profane Histoire des transformations conjointes du pouvoir et du sacré Magie et pouvoir dans les sociétés sans État Magie et pouvoir dans les sociétés à État Le haut et le bas Des fictions politiques ou comment l'homme a créé Dieu à son image Les luttes pour l'appropriation du sacré Sécularisation, transferts de sacralité et fondements sacrés de toute société Livre 2 - Art, domination, sacralisation 4. L'extension du domaine du sacré : l'émergence de l'art comme domaine autonome et séparé du profane Poètes et artistes, souverains ou démiurges L'histoire d'une sacralisation collective Des reliques aux oeuvres d'art La séparation de l'art et de la vie Admirer avant d'interpréter Sous l'admiration, la domination La magie des tableaux Récits fabuleux et mystifications Copies et faux 5. Authentification, attribution Où chercher les vérités scientifiques ? Être expert : faire des choses avec des mots Acte performatif I : le catalogue raisonné Acte performatif II : l'exposition Attributions et désattributions : controverses et changements d'avis Histoire et logique de l'attributionnisme La science au service du sacré Désévidencier l'authentique Livre 3 - Du Poussin et de quelques Fuites en Égypte 6. Sublime Poussin : maître du classicisme français Parcours d'un artiste à contretemps et à contre-pente : indépendance et liberté de création Peintre-philosophe et artiste Sur la fortune de Poussin À l'art, la nation reconnaissante 7. Le fabuleux destin de tableaux attribués à Nicolas Poussin Raccordements, associations et statuts de l'objet Histoire de toiles Le tableau d'un grand peintre au talent déclinant Les traces d'un tableau admirable Trois apparitions - La montée d'une controverse - L'épreuve de la confrontation - Le travail souterrain des galeristes - La première reconnaissance publique de la version « Pardo » Rebondissement : la demande d'annulation de la vente de 1986 L'acquisition d'un trésor national À la recherche des mécènes La magie d'un chef-d'oeuvre Clore une controverse Les conditions de l'envoûtement et du désenvoûtement Une version sans expert 8. Poussin, la science, le droit et le marché Poussin au laboratoire Analyses de la version « Piasecka-Johnson » - Analyses de la version « Pardo-MBA de Lyon »Poussin au tribunal Erreur sur la substance - Un précédent déterminant : le cas d'Olympos et Marsyas ou l'« affaire Saint-Arroman » - Le procès de l'« autre affaire Poussin » Le prix d'un tableau 9. Comment chacun joue son jeu Des historiens de l'art : qui a l'oeil ? Sir Anthony Blunt (1907-1983) - Sir Denis Mahon (1910-2011) - Jacques Thuillier(1928-2011) - Pierre Rosenberg (1936-) Des galeristes : jouer (et perdre) son jeu Une directrice de musée : jouer (et gagner) son jeu Conclusions Se tenir en deçà des champs À la racine des croyances Donner à voir le monstre invisible Un jeu savant fragile Post-scriptum Les conditions de la création scientifique Remerciements Liste résumée des données exploitées Éléments bibliographiques Bibliographie documentaire Index des noms d'auteur Index thématique et conceptuel.
↧
Littératures classiques , n° 85, 2014 : Littérature et science : archéologie d'un litige (XVI e-XVIII e s.)
Littérature et science : archéologie d'un litige (XVI e-XVIII e siècles) sous la direction de Philippe Chométy et Jérôme Lamy Littératures classiques n° 85- 2014 Armand Colin ISSN : 0992-5279 ISBN : 978-2-200-92953-4 Il existe depuis une trentaine d’années un mouvement de redécouverte de l’histoire des relations entre littérature et science. Mais si les travaux les plus récents qui ont accompagné la recherche sur cette question ont montré qu’à l’époque moderne la littérature et les sciences sont dans un rapport de contiguïté voire d’adéquation à l’intérieur du domaine des belles-lettres, parvenant à contrecarrer le préjugé – dominant dans la conscience contemporaine – d’une séparation ou d’une dualité naturelle des «deux cultures», notre connaissance des relations entre littérature et science est encore largement intuitive, parce qu’issue pour une bonne part d’études générales sur les rapports de la littérature au savoir et à la vérité. Ainsi, lorsqu’il s’agit de définir précisément la nature du «et», nous sommes embarrassés. Qu’entend-on par le vocabulaire de l’influence, du lien, de l’affinité, de l’interférence, de l’inscription, etc.? Que dénotent les images du «lieu de passage», de la «maison commune», de «la passerelle»,etc. qui alimentent abondamment le discours critique ? Le schéma constitutif du «et» est-il une construction anhistorique, ou bien faut-il chercher dans l’époque moderne un moment spécifique des relations entre littératureet science ? Cette relation que l’on peine à qualifier entre littérature et science n’est jamais univoque ou monolithique. De plus, en mobilisant ces deux catégories massives que sont la science et la littérature (le singulier employé pour ces deux termes renvoie à des généralités plurielles) le risque est grand d’essentialiser des pratiques et des discours, ou de penser à partir d’un anachronisme manifeste. Tout semble opposer aujourd’hui littérature et science (y compris les tentatives de rapprochement revendiquées), mais on peut penser que cet écart n’a pas toujours été et qu’il reste à proposer un tableau des conditions, des facteurs et des débats qui ont construit cette séparation. À l’initiative de deux chercheurs impliqués dans les questions de pluridisciplinarité, l’un en socio-histoire des sciences (JérômeLamy) et l’autre dans le domaine de la poésie scientifique (PhilippeChométy), cette nouvelle livraison de la revue de Littératures classiques (n° 85) envisage de contribuer à l’effort de théoriser les relations exactes entre littérature et science. En effet, le «et» fonctionne encore aujourd’hui comme un obstacle épistémologique à la compréhension de textes hybrides au statut mal identifié, ni vraiment «scientifiques», ni vraiment «littéraires». En proposant de nuancer tout à la fois les termes du syntagme «littérature et science », de questionner la pluralité des sens, de cerner le « et » non comme un «contre», mais comme un «autre» venant diversifier le champ des pratiques intellectuelles, ce numéro se propose de prolonger les recherches entreprises sur les liens et les recoupements entre deux champs disciplinaires, voire entre deux activités cognitives, en cours de différenciation et d’autonomisation à l’époque moderne. Outre l’étude des textes qui intéressent directement la question, ce numéro se propose aussi de circonscrire un «corpus conceptuel», c'est-à-dire de faire une synthèse des notions, des catégories et des dispositifs théoriques qui permettent de penser la relation entre littérature et science. À partir des contributions réunies, qu’elles viennent de la théorie littéraire, de l’histoire littéraire, de l’épistémologie ou de la sociologie des pratiques, ce numéro devrait contribuer à former, par la diversité des points de vue, un état des lieux des interrogations dont procède le travail actuel des chercheurs sur les rapports de la littérature et des sciences. Sommaire Philippe Chométy et Jérôme Lamy Introduction Littérature et science : archéologie d'un litige (XVI e-XVIII e siècles) Frédérique Aït-Touati Littérature et science: faire histoire commune LA CITÉ DES SAVANTS Nicolas Correard La poésie contre les sciences: le scepticisme comme exercice spirituel dans la poésie calviniste française et anglaise Andreas Gipper Cyrano de Bergerac, l’imagination et la visibilité du monde Richard Goodkin Pascal et le calcul des partis: unité de temps scientifique, mathématique, littéraire Mickaël Popelard Science et hommes de science dans le théâtre de Shakespeare Florent Libral Mages, géomètres et orateurs. L’optique des religieux au XVII e siècle DinahRibard La science comme littérature à l’époque moderne EXERCICES D’ÉCRITURE Magali Brunel «Sans la science, la vie est presque une image de la mort»: la place du discours scientifique dans l’esthétique verbale de Molière Joël Castonguay-Bélanger À l’ombre de Fontenelle. Dissémination du discours scientifique par la fiction au XVIII esiècle Fabrice Chassot Littérature et socialisation des sciences dans le dialogue scientifique Alexandre Wenger Déplacer les savoirs. Discours savant et fiction romanesque chez Sade et Diderot Gilles Chabaud Littérature savante et assignation culturelle: le Dictionnaire encyclopédique des amusemens des sciences mathématiques et physiques Alain Guyot Quand science et littérature se croisent dans les Alpes au tournant des Lumières: Saussure et Bourrit AGENTS DOUBLES Violaine Giacomotto-Charra Le poète aimé des savants: la réception scientifique de Du Bartas entre 1580 et 1630 Véronique Adam Béroalde de Verville et le transfert des savoirs Frédéric Tinguely Le navire immobile: mobilité d’un topos scientifique de Copernic à Casanova Anne Vila De la pathologie à l’extase poétique : la catalepsie entre médecine et littérature au XVIII esiècle Anne-Lise Rey La littérarisation de la science newtonienne au XVIII e siècle: une littérature pour les dames? Didier Foucault Vibrations du clavecin de Diderot, des Lumières vers le marxisme et le surréalisme
↧
M. Coquet, Un destin contrarié. La mission Rivière-Tillion dans l'Aurès (1935-1936)
Référence bibliographique : Michèle Coquet, Un destin contrarié. La mission Rivière-Tillion dans l'Aurès (1935-1936) , LAHIC / DPRPS-Direction des patrimoines, collection ""Les Carnets de Bérose"", 2015. Un destin contrarié. La mission Rivière-Tillion dans l'Aurès (1935-1936) Michèle Coquet DATE DE PARUTION: Octobre 2014 - EDITEUR: Lahic / DPRPS-Direction des patrimoines - COLLECTION: Les Carnets de Bérose, 6. [En ligne]. Disponible à l'adresse: http://www.berose.fr/spip.php?article596 .Mandatées pour réaliser une enquête sur l’Aurès et ses habitants par l’International Society of African Languages and Cultures de Londres et l’Institut d’ethnologie de Paris, alors dirigé par Lucien Lévy-Bruhl, Marcel Mauss et Paul Rivet, Thérèse Rivière et Germaine Tillion rejoignent le massif de l’Ahmar Khaddou et le pays chaouïa en janvier 1935. Elles y resteront deux ans. Nombre des matériaux recueillis lors de cette première mission ethnographique dans l’Aurès étaient demeurés inaccessibles jusqu’à leur redécouverte en 2006. Certains sont cependant définitivement perdus; Th. Rivière et G. Tillion, pour des raisons différentes, la maladie pour l’une et la déportation pour l’autre, n’auront pu mener leurs recherches à terme. L’analyse de ces archives – plusieurs milliers de photographies, carnets de terrain et de dessins, correspondance, rapports de mission – révèle comment, tout en répondant aux exigences de leurs tutelles qui leur demandaient d’investir des domaines aussi différents que l’anthropologie physique, la botanique, la zoologie, l’archéologie ou la sociologie, les deux jeunes femmes affrontent cette première expérience du terrain et de la pratique ethnographique. La rencontre avec les Chaouïa, marquée par un engagement affectif intense, conduit Th. Rivière à l’illusion d’une possible immersion dans leur culture dont ses photographies gardent la trace. Elle porte en revanche G. Tillion, fidèle à l’idéal d’une Algérie française, à une réflexion d’ordre politique. TABLE DES MATIÈRES: Faits et quantités - L'air du temps : Germaine Tillion aux prises avec l'Algérie coloniale - Une ethnographie visuelle : Thérèse Rivière, dessinatrice et photographe - Bibliographie. Cet ouvrage est le sixième volume des Carnets de Bérose, une collection éditée électroniquement par le Lahic et le département du Pilotage de la recherche et de la politique scientifique de la Direction générale des patrimoines (ministère de la Culture). Il fait partie d’une série consacrée aux missions, enquêtes et terrains des années 1930. Michèle COQUET est chercheur au CNRS, membre du Laboratoire d’anthropologie et d’histoire de l’institution de la culture (LAHIC) et de l’Institut Interdisciplinaire de l’Anthropologie du Contemporain (IIAC). En tant qu’africaniste, elle a étudié la fonction et l’usage des représentations figurées dans des sociétés à tradition orale, leur rôle dans l’apprentissage et la transmission des connaissances, ce que leur morphologie révèle de conceptions du monde sensible, les rapports entre image et récit. Dans une perspective comparative, ses travaux ont également associé à la réflexion anthropologique des préoccupations relevant de l’histoire des arts du monde occidental et porté sur certaines notions au fondement de notre propre théorie de l’image, comme celles deressemblance iconique, de modèle, d’effet spéculaire… Elle s’intéresse actuellement à la relation entre expérience sensible et savoir-faire et aux procédés créateurs. Elle est l’auteur de Textiles africains (1993), Arts de cour en Afrique noire (1996), Arts primitifs, arts populaires, arts savants (2007). Elle a dirigé Cultures à l’œuvre – Rencontres en art (2005, avec B. Derlon et M.Jeudy-Ballini) et Enfances – Pratiques, croyances et inventions (2013, avec Cl. Macherel).
↧
↧
M. Vidal, Fist
Fist Marco Vidal Date de parution : 15/01/2015 Editeur : Zones ISBN : 978-2-35522-086-9 EAN : 9782355220869 Présentation : Broché Nb. de pages : 155 p. Le XXe siècle aurait inscrit une seule innovation au répertoire des pratiques sexuelles : le fist fucking. Fallait-il en rester à cette doxa popularisée par nombre d'intellectuels et de chercheurs ? Combinant érudition historique, réflexions théoriques, récits à la première personne, quasi-poèmes en prose, Fist peut se lire au choix comme une apostille à Histoire de la sexualité de Michel Foucault ou comme un roman queer. La singulière généalogie érotique qu'il nous propose s'ouvre sur des photographies de Robert Mapplethorpe et se clôt par une relecture du Cantique des cantiques. Entretemps, on aura visité Les Catacombes, mythique club privé du San Francisco des années 1970 ; relu Koltès, Sade, Homère, Ovide, Ronsard et Henry James ; croisé Amerifist, acteur star de ce sousgenre du cinéma porno ; compulsé des traités de médecine du XIXe siècle pour y découvrir d'étranges prescriptions ; passé des petites annonces sur des sites spécialisés ; fait quelques rencontres et pris rendez-vous chez un proctologue… Réduire le fist fucking à la violence du « poing » est un contresens. Le plaisir civilise la main pour mieux réinvestir les puissances imaginaires du corps, dans une union improbable qui pourrait bien aussi s'appeler « amour ». Pour affronter plus librement le public, l'auteur a choisi le pseudonyme de Marco Vidal. Voir le site de l'éditeur… Sommaire : 1. 28 juin 2012 2. les mots et la chose 3. Les Catacombes 4. Cynthia Slater 5. Canard-lapin 6. Jean-Luc 7. Premiers pas 8. Un, deux, trois, quatre... sphincters 9. Glaçant le feu en son centre 10. Autres deals 11. Pal 12. La lance-meurtre et la main d'Achille 13. Avec ou sans gant 14. Vagin 15. Le Dr B de l'hôpital B 16. Sigmoïde 17. Accidents 18. Jonas 19. Coup de poing 20. La fissure 21. Tui Na 22. Fin de partie 23. Cantique du fist Sources non précisées dans le texte
↧
Poste d'écrivain en résidence, 2015-2016
Appel de candidatures Département de langue et littérature françaises, Université McGill Écrivain en résidence 2015-2016 Le Département de langue et littérature françaises sollicite des candidatures à un poste temporaire d’écrivain en résidence, du 1 er septembre 2015 au 15 avril 2016. L’écrivain en résidence devra donner un atelier de création littéraire de premier cycle (3 crédits) en français et organiser diverses activités littéraires (lectures, rencontres, etc.), dont certaines seront en collaboration avec l’écrivain en résidence du Département d’anglais. Le concours est ouvert à tous les écrivains peu importe le genre qu’ils pratiquent (l’écriture narrative ou scénaristique, la poésie, le théâtre, etc.). La rémunération totale sera de 20000$. Les candidatures doivent inclure un curriculum vitae, une lettre de présentation mettant en évidence l’expérience d’enseignement ainsi que les noms et adresses de 3 répondants. Veuillez soumettre votre candidature par voie électronique à la directrice du Département de langue et littérature françaises, madame Jane Everett ( jane.everett@mcgill.ca ), d’ici le 15 mars 2015. L'Université McGill souscrit à la diversité et à l'équité en matière d'emploi. Elle accueille favorablement les demandes d'emploi: des femmes, des peuples autochtones, des minorités ethniques, des personnes handicapées, des personnes de toutes orientations et identités sexuelles, des minorités visibles, et d'autres personnes qui pourraient contribuer à une plus grande diversité. On encourage tous les candidats qualifiés à postuler; veuillez noter que, conformément aux exigences de l’immigration canadienne, la priorité sera toutefois accordée aux Canadiens ainsi qu'aux résidents permanents. Ce poste est financé grâce au programme d’écrivains en résidence Mordecai-Richler mis sur pied à la Faculté des Arts en 2010.
↧
Femmes des lumières et de l'ombre
Le 5ème colloque d'Orléans, au titre générique de "Femmes des lumières et de l'ombre" se prépare sous la houlette de Mix-Cité 45, association féministe mixte pour l'égalité des sexes. Il se déroulera les jeudi 17 et vendredi 18 septembre 2015 à la Médiathèque d'Orléans. Les éditions précédentes ont successivement mis en lumière les femmes du XVIII ème siècle, celles de la Belle Epoque, les savantes femmes du XVII ème siècle, les femmes de l'entre-deux guerres. Le colloque 2014 nous a montré comment les femmes ont diversifié leurs parcours, du cinéma à la chanson, de la mode à la magie, de l'histoire à la littérature. Au-delà des voies originales et flamboyantes que nous avons découvertes, il reste à poursuivre la réflexion sur les contradictions, les évolutions nettes ou inabouties, les mythes en devenir. Nous centrerons ainsi notre questionnement sur des domaines nouveaux: médecine, journalisme, sciences, sport, techniques, voyages et explorations... Comme l'an passé, si nous souhaitons que ce colloque fasse connaître des inconnues remarquables, nous souhaitons aussi qu'il croise diverses perspectives - historique, sociologique, esthétique - en affinant ce que nous connaissons mieux désormais des femmes de l'entre-deux guerres. Les communications sont à adresser pour le 27 mars 2015 dernier délai à lavalturpin@yahoo.fr et dominique.brechemier@gmail.com
↧
N. Pireddu, The Works of Claudio Magris. Temporary Homes, Mobile Identities, European Borders
Référence bibliographique : Nicoletta Pireddu, The Works of Claudio Magris. Temporary Homes, Mobile Identities, European Borders , Palgrave McMillan, collection "Italian and Italian American Studies", 2015. EAN13 : 9781137492623. The first English book on contemporary Italian writer Claudio Magris, this interdisciplinary and comparative study examines the connections between space and individual, national and European identity in his works. Magris invites us to cross the borders that enclose private and public spheres in order to discover the otherness within ourselves and reject the fanaticism of self-sameness. Through the recurring image of temporary homes, the book explores Magris’sceaselesssearch formeaning and values, aiming at a habitable life, where diversity and tolerance can prevail over all fundamentalisms. With a sophisticated theoretical framework that connects Magris's thought to leading European intellectuals from Benjamin, Steiner, De Certeau and Habermas to Derrida, Bauman, Cassano and Nussbaum, this innovative analysis involves Magris’s entire fiction and non-fiction writings, down to his most recent, still untranslated collections. With what Pireddu calls “geography of domesticity,” Magris addresses the crucial question of the return to humanism that is moving literature and theory beyond the alleged death of the subject, and confirms the enduring value of the humanities as a critical and constructive tool. TABLE OF CONTENTS Introduction: Claudio Magris's Geography of Domesticity 1. Households of the Self 2. Homely Memories, Promised Homelands 3. European Thresholds and Relocations 4. From Snug Refuges to Ghastly Cells 5. Habitat and Habitus Conclusion Bibliography Index ABOUT THE AUTHOR Nicoletta Pireddu is Associate Professor of Italian and Comparative Literature at Georgetown University, USA. Her monograph Antropologi alla corte della bellezza. Decadenza ed economia simbolica nell'Europa fin de siècle received the American Association for Italian Studies Book Prize. She edited Paolo Mantegazza's The Physiology of Love and Other Writings and The Year 3000 , and has authored over fifty articles in journals like Comparative Literature ,Romanic Review ,Gothic Studies , and Research in African Literatures . She was awarded fellowships from the NEH and the Howard Foundation, and the "Mario Soldati" prize for criticism.
↧
↧
R. Bonamy dir., Itinéraires de Roberto Rossellini
Référence bibliographique : Robert Bonamy dir., Itinéraires de Roberto Rossellini , ELLUG, collection "La Fabrique de l'oeuvre", 2015. EAN13 : 9782843102882. Itinéraires de Roberto Rossellini ,textes réunis et présentés par Robert Bonamy 24 euros, 14 x 21,5 cm 180 p. L’ouvrage est vendu avec unDVD comprenant deux documents exceptionnels : La dernière utopie.La télévision selonRoberto Rossellini , par Jean-Louis Comolli et Adriano Aprà & Jean-Louis Comolli .Le présent recueil, en associant esthétique et fabrique, plutôt que de penser les films de Rossellini au miroir de la seule société italienne ou en fonction de la prétendue césure entre cinéma et télévision, se propose de suivre ses multiples itinéraires. Les déplacements géographiques s'associent à des trajectoires historiques et temporelles complexes. Ce livre envisage aussi comment les films se font l’écho des sculptures, des textes poétiques, des créations théâtrales, des textes philosophiques que le cinéaste croise sur son parcours. L’autre piste, et cet enjeu est considérable, concerne l’empreinte des idées cinématographiques de Rossellini sur le cinéma moderne et contemporain, qui poursuit en quelque sorte les chemins tracés tout en les réinventant. Autrement dit, les films de Rossellini continuent leur fabrique… Table des matières Introduction Poétique de Rossellini : des images mobiles, Robert Bonamy 1. Voyage(s) et modernité Dans le sillage des statues, Suzanne Liandrat-Guigues Ceci n'est pas une carte postale : Voyage en Italie (1953) dans l'optique de Jean-Luc Godard, Guillaume Bourgois L’Inde vue par Rossellini : un beau montage, Aurore Renaut 2. Voies humaines, voix poétiques Les premières manifestations du réalisme rossellinien au filtre de la critique de Giuseppe De Santis : Un pilota ritorna (1942) et L’Uomo dalla croce (1943), Laurent Scotto d’Ardino Una voce umana / La Voix humaine : chambre d’échos théâtraux, musicaux et filmiques, Didier Coureau Dialogues de téléastes : de Pascal à La Bruyère, de Socrate à Descartes, de Rohmer à Rossellini, Philippe Fauvel 3. Démarches éthiques Sur la proximité du monde : mouvement, distance et croyance dans le regard filmique de Rossellini, Daniele Dottorini La camera della morte : quand Roberto Rossellini et Vittorio De Seta filment la pêche aux thons, Vincent Sorrel L’image innocente : sur Francesco, giullare di Dio , Cyril Neyrat Les films de télévision de Roberto Rossellini, Jean-Louis Comolli
↧
H. Bardon, La Littérature latine inconnue
 Henry Bardon, La Littérature latine inconnue Tome I: L'Époque républicaine. Tome II: L'Époque impériale. Paris : Klincksieck, coll. "Série littérature", 2015. 734 p. EAN 9782252039182 99,00 EUR Présentation de l'éditeur : Citant A.F. Wert qui constatait, il y a plus de cent ans en dressant l'état des lieux, que sur les 772 auteurs latins, dont nous avons gardé le souvenir, 276 ne sont que des noms; que pour 352 d’entre eux nous ne possédons que des fragments, que seuls les 144 qui restent – soit 20% du nombre total – ont préservé un ou plusieurs ouvrages, Henry Bardon écrit: Imaginons une littérature française où des bribes du Serment de Strasbourg, quelques vers de Soties ou du Roman de Renard , une strophe de la Chanson de Roland représenteraient les écrivains du Moyen Âge; pour le siècle classique, point de Racine (je songe à Varius); pas davantage de Lamartine (je pense à Gallus); des genres entiers auraient disparu, sans qu’il en subsistât autre chose que quelques lignes atrophiées et suspectes. Bref, une brume de néant, d’où émergeraient, plus ou moins, quelques cimes. Exploitant néanmoins les milliers de témoignages qui, épars dans les œuvres conservées, documentent l’existence éphémère d’une foule d’ouvrages disparus, un travail de géant s’était engagé, depuis Robert et Henri Estienne jusqu’à Émile Baehrens, pour lutter contre les forces de destruction, enquête inlassable qui se poursuit encore aujourd’hui. Néanmoins les conditions étaient déjà assez largement réunies au milieu du siècle dernier pour qu’un athlète de la philologie, s’appuyant sur cette riche fenaison et la dominant, s’emploie à en réunir les résultats pour les ordonner chronologiquement dans une vision d’ensemble, un immense panorama, rétablissant les perspectives et brossant la toile de fond sur laquelle se détachent et se comprennent les chefs-d’œuvre conservés. C’est l’exploit inédit et non réédité que réalisent ces deux volumes, qui comprennent, à leur sortie, respectivement 384 et 344 pages et englobent, le premier, la période républicaine, le second l’époque impériale, soit près de huit siècles (IV e av.-V e ap. J-C.), au terme desquels l’auteur tente de cerner les causes historiques et la disparition de tant d’œuvres parfois magistrales. Henry Bardon , professeur de latin à la Faculté des Lettres de Poitiers et titulaire de la chaire Franqui à Bruxelles, éditeur de Quinte Curce (1947-1948) et de Catulle (1970), a été, depuis sa thèse sur Les Empereurs et les Lettres latines d’Auguste à Hadrien (1940) l’auteur de nombreux ouvrages, dont: Il genio latino (1961), dont la version française (1963) a été couronnée par un prix de l’Académie française, Le Crépuscule des Césars (1964), les Propositions sur Catulle (1970), ainsi que plus de deux cents articles. Ses Mélanges ont été édités en 1985 dans la revue Latomus par les soins de Marcel Renart et Pierre Laurens.
Henry Bardon, La Littérature latine inconnue Tome I: L'Époque républicaine. Tome II: L'Époque impériale. Paris : Klincksieck, coll. "Série littérature", 2015. 734 p. EAN 9782252039182 99,00 EUR Présentation de l'éditeur : Citant A.F. Wert qui constatait, il y a plus de cent ans en dressant l'état des lieux, que sur les 772 auteurs latins, dont nous avons gardé le souvenir, 276 ne sont que des noms; que pour 352 d’entre eux nous ne possédons que des fragments, que seuls les 144 qui restent – soit 20% du nombre total – ont préservé un ou plusieurs ouvrages, Henry Bardon écrit: Imaginons une littérature française où des bribes du Serment de Strasbourg, quelques vers de Soties ou du Roman de Renard , une strophe de la Chanson de Roland représenteraient les écrivains du Moyen Âge; pour le siècle classique, point de Racine (je songe à Varius); pas davantage de Lamartine (je pense à Gallus); des genres entiers auraient disparu, sans qu’il en subsistât autre chose que quelques lignes atrophiées et suspectes. Bref, une brume de néant, d’où émergeraient, plus ou moins, quelques cimes. Exploitant néanmoins les milliers de témoignages qui, épars dans les œuvres conservées, documentent l’existence éphémère d’une foule d’ouvrages disparus, un travail de géant s’était engagé, depuis Robert et Henri Estienne jusqu’à Émile Baehrens, pour lutter contre les forces de destruction, enquête inlassable qui se poursuit encore aujourd’hui. Néanmoins les conditions étaient déjà assez largement réunies au milieu du siècle dernier pour qu’un athlète de la philologie, s’appuyant sur cette riche fenaison et la dominant, s’emploie à en réunir les résultats pour les ordonner chronologiquement dans une vision d’ensemble, un immense panorama, rétablissant les perspectives et brossant la toile de fond sur laquelle se détachent et se comprennent les chefs-d’œuvre conservés. C’est l’exploit inédit et non réédité que réalisent ces deux volumes, qui comprennent, à leur sortie, respectivement 384 et 344 pages et englobent, le premier, la période républicaine, le second l’époque impériale, soit près de huit siècles (IV e av.-V e ap. J-C.), au terme desquels l’auteur tente de cerner les causes historiques et la disparition de tant d’œuvres parfois magistrales. Henry Bardon , professeur de latin à la Faculté des Lettres de Poitiers et titulaire de la chaire Franqui à Bruxelles, éditeur de Quinte Curce (1947-1948) et de Catulle (1970), a été, depuis sa thèse sur Les Empereurs et les Lettres latines d’Auguste à Hadrien (1940) l’auteur de nombreux ouvrages, dont: Il genio latino (1961), dont la version française (1963) a été couronnée par un prix de l’Académie française, Le Crépuscule des Césars (1964), les Propositions sur Catulle (1970), ainsi que plus de deux cents articles. Ses Mélanges ont été édités en 1985 dans la revue Latomus par les soins de Marcel Renart et Pierre Laurens.
↧
D'Holbach, Essai sur l’art de ramper, à l’usage des courtisans
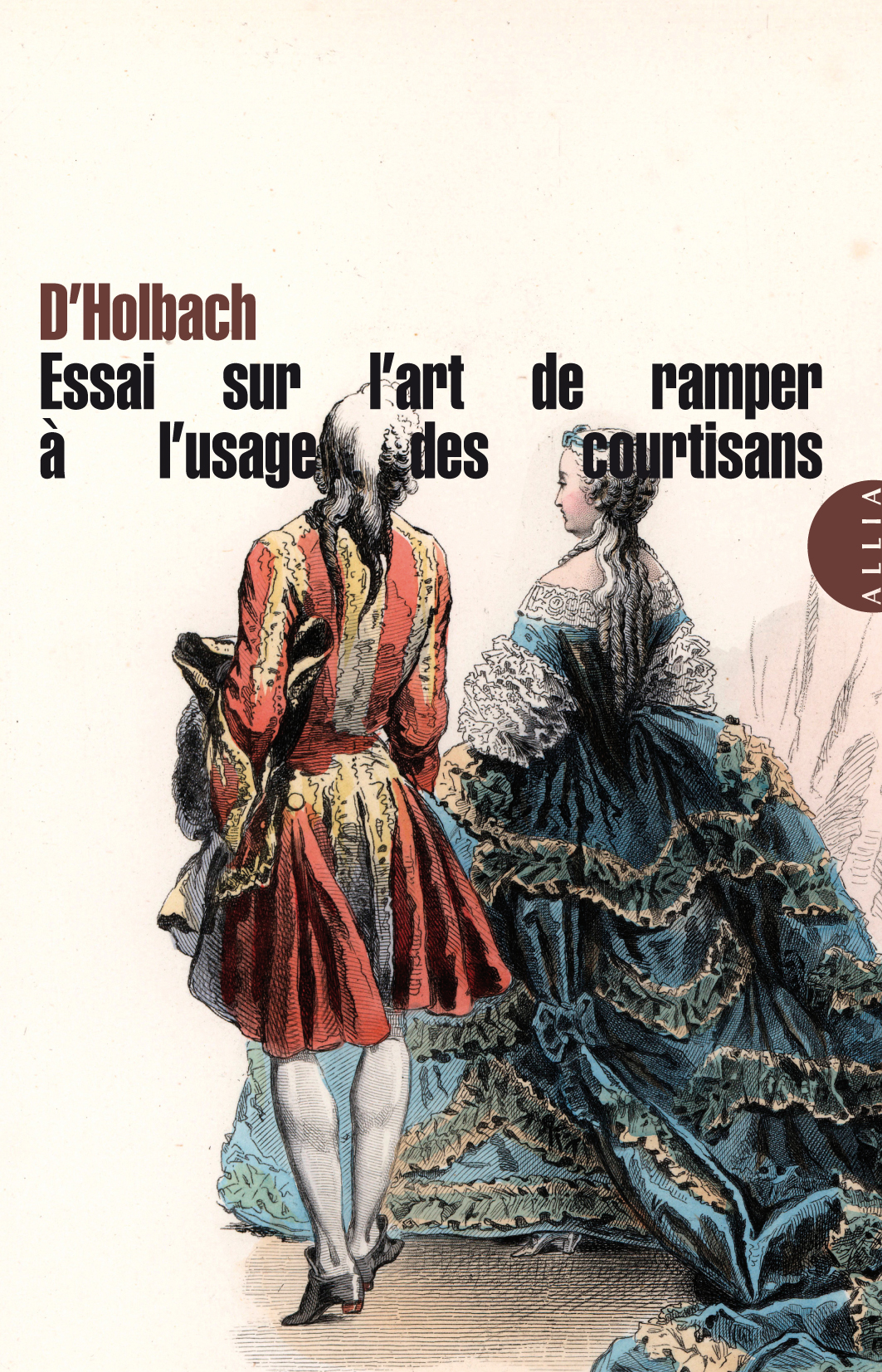 D'Holbach, Essai sur l’art de ramper, à l’usage des courtisans Paris : Allia, 2015. 48 p. EAN 9782844853332 3,10 EUR Présentation de l'éditeur : “Quel art, quel empire sur soi-même ne suppose pas cette dissimulation profonde qui forme le premier caractère du vrai courtisan ! Il faut que sans cesse sous les dehors de l’amitié il sache endormir ses rivaux, montrer un visage ouvert, affectueux, à ceux qu’il déteste le plus, embrasser avec tendresse l’ennemi qu’il voudrait étouffer ; il faut enfin que les mensonges les plus impudents ne produisent aucune altération sur son visage.” Le propre de l’ironie est le double discours. Sous la forme elle-même ambiguë de l’essai, d’Holbach fait ici l’apologie de l’art singulier de ramper, nécessaire au maintien du courtisan dans la Cour du Roi. Art du maintien, de la bonne façade et du savoir-vivre hypocrite, ramper est une manœuvre subtile, fondée sur l’abnégation. D’Holbach moque l’intelligence des conventions sociales, tissées d’hypocrisie et d’arrivisme. Car c’est n’avoir que peu d’orgueil et de passion que de devoir revêtir le costume de l’hypocrite pour, au fond, conforter le pouvoir des puissants. La position de l’auteur à l’égard de ces courtisans n’a d’égale que celle des courtisans face à leurs pairs et à leur maître. En décrivant les masques dont doit se revêtir le courtisan, d’Holbach met bas les mécanismes mêmes de la dissimulation et de la pantomime. Lire un extrait
D'Holbach, Essai sur l’art de ramper, à l’usage des courtisans Paris : Allia, 2015. 48 p. EAN 9782844853332 3,10 EUR Présentation de l'éditeur : “Quel art, quel empire sur soi-même ne suppose pas cette dissimulation profonde qui forme le premier caractère du vrai courtisan ! Il faut que sans cesse sous les dehors de l’amitié il sache endormir ses rivaux, montrer un visage ouvert, affectueux, à ceux qu’il déteste le plus, embrasser avec tendresse l’ennemi qu’il voudrait étouffer ; il faut enfin que les mensonges les plus impudents ne produisent aucune altération sur son visage.” Le propre de l’ironie est le double discours. Sous la forme elle-même ambiguë de l’essai, d’Holbach fait ici l’apologie de l’art singulier de ramper, nécessaire au maintien du courtisan dans la Cour du Roi. Art du maintien, de la bonne façade et du savoir-vivre hypocrite, ramper est une manœuvre subtile, fondée sur l’abnégation. D’Holbach moque l’intelligence des conventions sociales, tissées d’hypocrisie et d’arrivisme. Car c’est n’avoir que peu d’orgueil et de passion que de devoir revêtir le costume de l’hypocrite pour, au fond, conforter le pouvoir des puissants. La position de l’auteur à l’égard de ces courtisans n’a d’égale que celle des courtisans face à leurs pairs et à leur maître. En décrivant les masques dont doit se revêtir le courtisan, d’Holbach met bas les mécanismes mêmes de la dissimulation et de la pantomime. Lire un extrait
↧