Colloque international 19-20 novembre 2015 Université de Lorraine Campus Lettres et Sciences Humaines de Nancy Le corps masculin déplacé. L’ É preuve de la migration dans la litt é rature arabe moderne Avant la parution, en 2005, de la grande encyclopédie en trois volumes sur L’histoire du corps , dirigée par Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine et Georges Vigarello, l’histoire de la perception du corps humain, en particulier le corps masculin, a longtemps souffert, auprès des chercheurs en sciences humaines et sociales, d’une désaffection injuste. Dès 1962, Lucien Febvre rappelait l’importance de faire l’histoire de «l’homme vivant, l’homme en chair et en os» (Febvre, 1962: 544-545), tandis que, douze ans plus tard, Jacques Revel et Jean-Pierre Peter déploraient que le corps soit «absent de l’histoire, mais pourtant un de ses lieux». (Le Goff, 1974). Progressivement, le corps, en tant que «corps qui mange, boit et souffre, d’un personnage en chair et en os dont on raconte l’histoire» (Berthelot, 1997: 9), devint un véritable objet d’étude, pour les historiens, les sociologues ou les ethnologues. Dans le domaine littéraire cependant, les représentations multiples de l’organicité du corps dans la fiction n’offrent que de trop rares études scientifiques, elles aussi souvent incomplètes ou biaisées, en ce sens qu’elles s’intéressent surtout aux corps féminins et excluent presque totalement les corps masculins. Or, en tant que fait social, produit d’une société et d’une culture déterminées, la littérature de fiction, en poésie ou en prose, produit, à toutes les époques et dans toutes les sociétés, des représentations du corps aux aspects multiformes: elle reflète l’inscription du corps dans un espace, un temps, une culture donnés, son interaction avec une société, ses classes, son organisation, ses perceptions… La mise en scène littéraire du corps tient ainsi compte à la fois de ses aspects biologiques (propriétés corporelles, caractéristiques physiques,…) et de ses rapports avec la société (vêtements, accessoires, attitudes, mouvements, manifestations culturelles, valorisation/dévalorisation...). «Le corps est en effet, au même titre que tous les autres objets techniques dont la possession marque la place de l’individu dans la hiérarchie des classes, par sa couleur (blafarde ou bronzée), par sa texture (flasque et molle ou ferme et musclée), par son volume (gros ou mince, replet ou élancé), par l’ampleur, la forme ou la vitesse de ses déplacements dans l’espace (gauche ou gracieux), un signe de statut ‒ peut-être le plus intime et par là le plus important de tous ‒ dont le rendement symbolique est d’autant plus fort qu’il n’est pas, le plus souvent, perçu comme tel et n’est jamais dissocié de la personne même de celui qui l’habite» (Boltanski, 1971: 206). L’évolution de la représentation du corps en littérature est subordonnée aux multiples mutations de «dynamiques temporelles, autant de visions différentes du monde et d’investissements différents dans le corps.» (Corbin, Courtine et Vigarello, 2006: III, 9). Ainsi, le corps, en tant qu’objet littéraire, est intrinsèquement lié à un contexte, sans lequel il n’a aucune existence: «Corps à écrire, il est aussi un corps à lire qui possède sa signification propre à l’intérieur de l’œuvre. En ce sens, il est le texte premier, ce à partir de quoi le livre a été écrit. C’est un système de signes, donc de significations, qui fait pendant au système de sens que le texte comme écriture déploie. Texte premier et en même temps texte effacé, à reconstituer à chaque lecture comme un palimpseste. C’est là l’ambiguïté du corps romanesque qui tout à la fois s’éclipse devant le regard direct et fait sens» (Hammas, 2003: 76). De cette constatation naît la question de l’inscription du corps dans le texte narratif, à travers les relations complexes qu’il entretient à l’intérieur du texte, mais aussi en tant que produit d’une identité propre à la fois partagée et singulière. Le colloque se propose de répondre à cette question au travers de l’étude de la représentation du corps viril en contexte de déplacement, dans la littérature arabe. La virilité sera envisagée dans ses diverses acceptions: en tant que en tant que ensemble des caractéristiques physiques et sexuelles de l’homme, ce qui renvoie tout à la fois aux particularités biologiques de l’homme adulte, à son comportement sexuel et aux qualités morales ou symboliques qui lui sont culturellement attribuées et le distinguent de la femme). La virilité est au cœur des pratiques culturelles et intellectuelles et y développe des règles, un imaginaire, un langage, des représentations propres. Cependant, dans le domaine arabisant, elle n’a fait l’objet que de rares analyses scientifiques, à de notables exceptions près: La virilité en Islam (Benslama et Fathi, 1998), Penser le corps au Maghreb (Lachheb, 2012) ou encore Récits du corps au Maroc et au Japon (Kober et Zekri, 2012). Il s’agira donc d’étudier ce corps viril à l’épreuve du déplacement, de quelque type qu’il soit, qu’il soit vécu comme un enrichissement ou comme une déchirure: contraint ou volontaire, définitif ou transitoire, réel ou fantasmé, réussi ou manqué, ponctuel ou régulier, migration, émigration, immigration, expatriation, déportation, bannissement, exclusion, exil, exode, déracinement et ré-enracinement, voyage d’agrément, voyage d’étude. Ce colloque a pour ambition de questionner le corps et la virilité à l’épreuve du déplacement, dans le corpus littéraire arabe en poésie ou en prose (fiction, roman, nouvelle, théâtre, témoignage, récit de voyages), arabophone ou allophone, moderne ou contemporain. Il envisagera, au travers de divers types de méthodologies ‒ sociocritique, écocritique, sémiotique, narratologie, intertextualité, poétique, physiognomonie, «sociologie des usages sociaux du corps» (Détrez, 2002)… ‒, trois axes majeurs: 1. Corps déplacé et altérité Il s’agira d’étudier, au-delà de la vision des gender studies , la représentation littéraire du corps de l’autre du corps désiré, du corps exotique, du corps agressé/agressif, du corps à corps, du corps dans l’amour et dans la lutte, dans la mêlée, du corps découvert, du corps caché, du corps exposé,… 2. Corps migrant et territoire(s) Cet axe s’intéressera aux marques du territoire sur le corps et aux indices physiques de la déterritorialisation. On y étudiera notamment le passage des frontières, le reflux aux frontières, le corps déplacé malade, le corps clandestin notamment. Pourront être analysées aussi les représentations des rituels ou habitudes du corps, en tant qu’ils sont conservés ou au contraire effacés, minorés ou dissimulés… 3. Corps exilé et (re)connaissance de soi Reconnaître le corps dans son territoire est une chose, le voir ailleurs est autre chose. Certains corps déplacés peuvent ne pas se reconnaître eux-mêmes, espérer être vus ou au contraire chercher à se fondre dans la masse. Le corps délocalisé peut être non reconnu et envisagé comme arraché, perdu, altéré, reconstitué, dissimulé, déguisé, travesti, clandestin, transformé, mutilé, atrophié, défiguré, exhibé, honni, … Bibliographie Astbury, Katerine et Planiol-Dieval Marie-Emmanuelle (Ed.), Le mâle en France, 1715-1830: représentations de la masculinité , Bern, New York, P. Lang, 2004 (coll.: «French studies of the Eighteenth and Nineteenth centuries»). Bazié Isaac, «Corps perçu et corps figuré», dans Études françaises [online] , 41, 2 (2005), p.9-24; URL: http://id.erudit.org/iderudit/011375ar. Benslama Fathi et Tazi Nadia, La virilité en Islam , Paris, Éditions de l’Aube, 1998 (coll. «Intersignes»). BerthElot Francis, Le corps du héros. Pour une sémiologie de l’incarnation romanesque , Paris, Nathan, 1997. Boltanski Luc, «Les usages sociaux du corps», dans Les Annales , 1(1971), p.205-233. Corbin Alain, Courtine Jean-Jacques, Vigarello Georges (dir.), Histoire du corps , 3vol., Paris, Le Seuil; vol.1: De la Renaissance aux Lumières , 2005; vol.2: De la Révolution à la Grande Guerre , 2005; vol.3: Les mutations du regard. Le XX esiècle , 2006. Corbin Alain, Courtine Jean-Jacques, Vigarello Georges (dir.), Histoire de la virilité , 3 volumes, Paris, Le Seuil, 2011; vol.1: L’invention de la virilité. De l’Antiquité aux Lumières ; vol.2: Le triomphe de la virilité. Le XIX e siècle ; vol.3: La virilité en crise. XX e et XXI e siècles. Détrez Christine, La construction sociale du corps , Paris, Éditions du Seuil, 2002. Febvre Lucien, Pour une histoire à part entière, Paris, SEVPEN, 1962. Hammas Axel, Images et écritures du corps dans l’œuvre romanesque de Tahar Ben Jelloun , Lille, Atelier national de reproduction des thèses, 2003. Kober Marc et Zekri Khalid, Récits du corps au Maroc et au Japon , Paris, L’Harmattan et Université Paris 13, Coll. «Itinéraires Littérature, textes, cultures», 2012. Lachheb Monia (dir.), Penser le corps au Maghreb , coll. Hommes et sociétés, Karthala, Paris, 2012. Le Breton David, La sociologie du corps, Paris, PUF, coll. «Que sais-je?», 1992. Le Goff Jacques et Nora Pierre (dir.), Faire de l’histoire, II: Nouveaux objets, le corps, Paris, Gallimard, 1974. Mosse Georges Lachmann, L’image de l’homme: l’invention de la virilité moderne , Paris, Abbeville, 1997. Rauch André, Histoire du premier sexe: de la Révolution à nos jours . Paris, Hachette littératures, 2006 (coll. «Pluriel : sociologie»). Revenin Régis (Dir.), Hommes et masculinités de 1789 à nos jours: contributions à l’histoire du genre et de la sexualité en France , préface d’Alain Corbin, Paris, Ed. Autrement, 2007 (coll. «Mémoires»). Rousseau Pascal, «Figure de déplacement. L’écriture du corps en mouvement» [ online ], Copyright Éditions HYX, 1995, p.86-97; URL: http://ftp.editions-hyx.com/sites/default/files/expose_2_p.rousseau.pdf. Sohn Anne Marie, Sois un homme: la construction de la masculinité au xix e siècle , Paris, Ed. du Seuil, 2009. Quéran Odile et Trarieux Denis (dir.), Les discours du corps. Une anthologie , Paris, Presse Pocket, 1993 (coll. «Agora»). Responsables scientifiques Laurence Denooz, Professeur en Littérature et culture arabes contemporaines, Université de Lorraine ( laurence.denooz@univ-lorraine.fr )Miloud Gharrafi, MCF en Littérature arabe contemporaine, Université de Toulouse et Saint-Cyr Coëtquidan (mgharrafi@yahoo.fr) Najeh Jegham, MCF en Littérature arabe contemporaine, Université de Nantes (najeh.jegham@univ-nantes.fr) Xavier Luffin, Professeur en Littérature arabe contemporaine, Université libre de Bruxelles (xluffin@ulb.ac.be) Élisabeth Vauthier, Professeur en Littérature arabe contemporaine, Université de Lorraine (elisabeth.vauthier@uhb.fr) Comité d’organisation Naouel Abdessemed, Doctorante en Littérature arabe contemporaine, Université de Rennes 2 (naouel.abdessemed@uhb.fr) Nassima Berkouchi-Claudon, Doctorante en Littérature arabe contemporaine, Université de Lorraine (nassima.claudon@univ-lorraine.fr) Amina Chorfa, Doctorante en Littérature arabe contemporaine, Université de Lorraine (amina.chorfa@univ-lorraine.fr) Muriel Le Bloa, Doctorante en Littérature arabe contemporaine, Université de Rennes 2 (muriel.lebloa@uhb.fr) Lamiae Kintzinger, Doctorante en Littérature arabe contemporaine, Université de Lorraine (lamiae.kintzinger@univ-lorraine.fr) Comité scientifique Laurence Denooz, Université de Lorraine, France et Université libre de Bruxelles, Belgique Said Gafaiti, Université de Fès, Maroc Miloud Gharrafi, Saint-Cyr Coëtquidan, France Abdallah al-Ghawasli al-Marrakchi, Université de Fès, Maroc Najeh Jegham, Université de Nantes, France Xavier Luffin, Université libre de Bruxelles, Belgique Abdellatif Najid, Université de Fès, Maroc Antonino Pellitteri, Université de Palerme, Italie Elisabeth Vauthier, Université de Rennes 2, France Propositions de communication 1 page isolée comportant le nom, l’appartenance institutionnelle, le grade, le titre de la communication et les coordonnées de l’auteur (adresse professionnelle, adresse personnelle, adresse électronique et téléphone) Sur 1 autre page: une proposition de 15 à 20 lignes en français, en anglais ou en arabe (Word, Times 12, interligne 1,5) avec indication de l’axe choisi et un titre. Toutes les propositions seront soumises à une double expertise en aveugle des membres du comité scientifique. Les propositions de communication seront adressées conjointement à: Elisabeth Vauthier : elisabeth.vauthier@uhb.fr Laurence Denooz : laurence.denooz@univ-lorraine.fr Calendrier 15 avril 2015 : date de retour des propositions 1er juin 2015: envoi des avis du comité scientifique aux auteurs 19-20 novembre 2015 : colloque 30 janvier 2016 : remise des textes à Laurence Denooz et Elisabeth Vauthier 1er avril 2016 : envoi des avis du comité scientifique aux auteurs pour corrections 30 mai 2016 : remise des textes définitifs pour publication Les articles retenus, après avis du comité scientifique, feront l’objet d’une publication. Les consignes éditoriales feront également partie de l’évaluation du texte. Frais d’inscription : 30 euros. Les frais de déplacement ne sont pas pris en charge. Les déjeuners seront offerts aux intervenants.
 Italo Svevo, Ma paresse Traduit de l’italien par Thierry Gillybœuf. Paris : Allia, 2015. 64 p. EAN 9782844859532 3,10 EUR Présentation de l'éditeur : "Il fut assez difficile de trouver la femme que je recherchais. À la maison, il n’y en avait aucune qui convînt à cet office, d’autant que l’idée de souiller ma demeure me rebutait. Je l’aurais fait si cela avait été nécessaire, étant donné le besoin où j’étais de duper Mère Nature afin qu’elle ne pense pas que l’heure était venue de m’envoyer la maladie fatale, et ma difficulté à trouver hors de chez moi ce qui convenait dans mon cas, celui d’un vieillard occupé d’économie politique, était si grande que cela en devenait véritablement impossible." Le narrateur, un vieil homme de 70 ans, vit aux côtés de sa femme Augusta. Or, sentant approcher le crépuscule de sa vie, il développe une hypocondrie, qui s’avère chronique. Sur les conseils de son neveu et médecin Carlo, il commence alors, et secrètement, à payer les services amoureux de jeunes femmes, qui égrènent les prénoms allégoriques, de Felicita à Amphore. L’homme espère déjouer ainsi les pièges de “Mère Nature” et se convaincre qu’il peut encore embrasser la vie et ses illusions. Mais il prend conscience que son temps est passé : il réalise que “Dame Nature” ne maintient un organisme en vie qu’à la condition que celui-ci sache se reproduire. Le narrateur sombre alors dans une paresse qui est une forme de renoncement. Déni du libre arbitre, puissance de la nature sur le Vouloir, lui-même illusion, tous les thèmes de la philosophie de Schopenhauer sont exprimés là. Lire un extrait
Italo Svevo, Ma paresse Traduit de l’italien par Thierry Gillybœuf. Paris : Allia, 2015. 64 p. EAN 9782844859532 3,10 EUR Présentation de l'éditeur : "Il fut assez difficile de trouver la femme que je recherchais. À la maison, il n’y en avait aucune qui convînt à cet office, d’autant que l’idée de souiller ma demeure me rebutait. Je l’aurais fait si cela avait été nécessaire, étant donné le besoin où j’étais de duper Mère Nature afin qu’elle ne pense pas que l’heure était venue de m’envoyer la maladie fatale, et ma difficulté à trouver hors de chez moi ce qui convenait dans mon cas, celui d’un vieillard occupé d’économie politique, était si grande que cela en devenait véritablement impossible." Le narrateur, un vieil homme de 70 ans, vit aux côtés de sa femme Augusta. Or, sentant approcher le crépuscule de sa vie, il développe une hypocondrie, qui s’avère chronique. Sur les conseils de son neveu et médecin Carlo, il commence alors, et secrètement, à payer les services amoureux de jeunes femmes, qui égrènent les prénoms allégoriques, de Felicita à Amphore. L’homme espère déjouer ainsi les pièges de “Mère Nature” et se convaincre qu’il peut encore embrasser la vie et ses illusions. Mais il prend conscience que son temps est passé : il réalise que “Dame Nature” ne maintient un organisme en vie qu’à la condition que celui-ci sache se reproduire. Le narrateur sombre alors dans une paresse qui est une forme de renoncement. Déni du libre arbitre, puissance de la nature sur le Vouloir, lui-même illusion, tous les thèmes de la philosophie de Schopenhauer sont exprimés là. Lire un extrait
 Italo Svevo, Ma paresse Traduit de l’italien par Thierry Gillybœuf. Paris : Allia, 2015. 64 p. EAN 9782844859532 3,10 EUR Présentation de l'éditeur : "Il fut assez difficile de trouver la femme que je recherchais. À la maison, il n’y en avait aucune qui convînt à cet office, d’autant que l’idée de souiller ma demeure me rebutait. Je l’aurais fait si cela avait été nécessaire, étant donné le besoin où j’étais de duper Mère Nature afin qu’elle ne pense pas que l’heure était venue de m’envoyer la maladie fatale, et ma difficulté à trouver hors de chez moi ce qui convenait dans mon cas, celui d’un vieillard occupé d’économie politique, était si grande que cela en devenait véritablement impossible." Le narrateur, un vieil homme de 70 ans, vit aux côtés de sa femme Augusta. Or, sentant approcher le crépuscule de sa vie, il développe une hypocondrie, qui s’avère chronique. Sur les conseils de son neveu et médecin Carlo, il commence alors, et secrètement, à payer les services amoureux de jeunes femmes, qui égrènent les prénoms allégoriques, de Felicita à Amphore. L’homme espère déjouer ainsi les pièges de “Mère Nature” et se convaincre qu’il peut encore embrasser la vie et ses illusions. Mais il prend conscience que son temps est passé : il réalise que “Dame Nature” ne maintient un organisme en vie qu’à la condition que celui-ci sache se reproduire. Le narrateur sombre alors dans une paresse qui est une forme de renoncement. Déni du libre arbitre, puissance de la nature sur le Vouloir, lui-même illusion, tous les thèmes de la philosophie de Schopenhauer sont exprimés là. Lire un extrait
Italo Svevo, Ma paresse Traduit de l’italien par Thierry Gillybœuf. Paris : Allia, 2015. 64 p. EAN 9782844859532 3,10 EUR Présentation de l'éditeur : "Il fut assez difficile de trouver la femme que je recherchais. À la maison, il n’y en avait aucune qui convînt à cet office, d’autant que l’idée de souiller ma demeure me rebutait. Je l’aurais fait si cela avait été nécessaire, étant donné le besoin où j’étais de duper Mère Nature afin qu’elle ne pense pas que l’heure était venue de m’envoyer la maladie fatale, et ma difficulté à trouver hors de chez moi ce qui convenait dans mon cas, celui d’un vieillard occupé d’économie politique, était si grande que cela en devenait véritablement impossible." Le narrateur, un vieil homme de 70 ans, vit aux côtés de sa femme Augusta. Or, sentant approcher le crépuscule de sa vie, il développe une hypocondrie, qui s’avère chronique. Sur les conseils de son neveu et médecin Carlo, il commence alors, et secrètement, à payer les services amoureux de jeunes femmes, qui égrènent les prénoms allégoriques, de Felicita à Amphore. L’homme espère déjouer ainsi les pièges de “Mère Nature” et se convaincre qu’il peut encore embrasser la vie et ses illusions. Mais il prend conscience que son temps est passé : il réalise que “Dame Nature” ne maintient un organisme en vie qu’à la condition que celui-ci sache se reproduire. Le narrateur sombre alors dans une paresse qui est une forme de renoncement. Déni du libre arbitre, puissance de la nature sur le Vouloir, lui-même illusion, tous les thèmes de la philosophie de Schopenhauer sont exprimés là. Lire un extrait
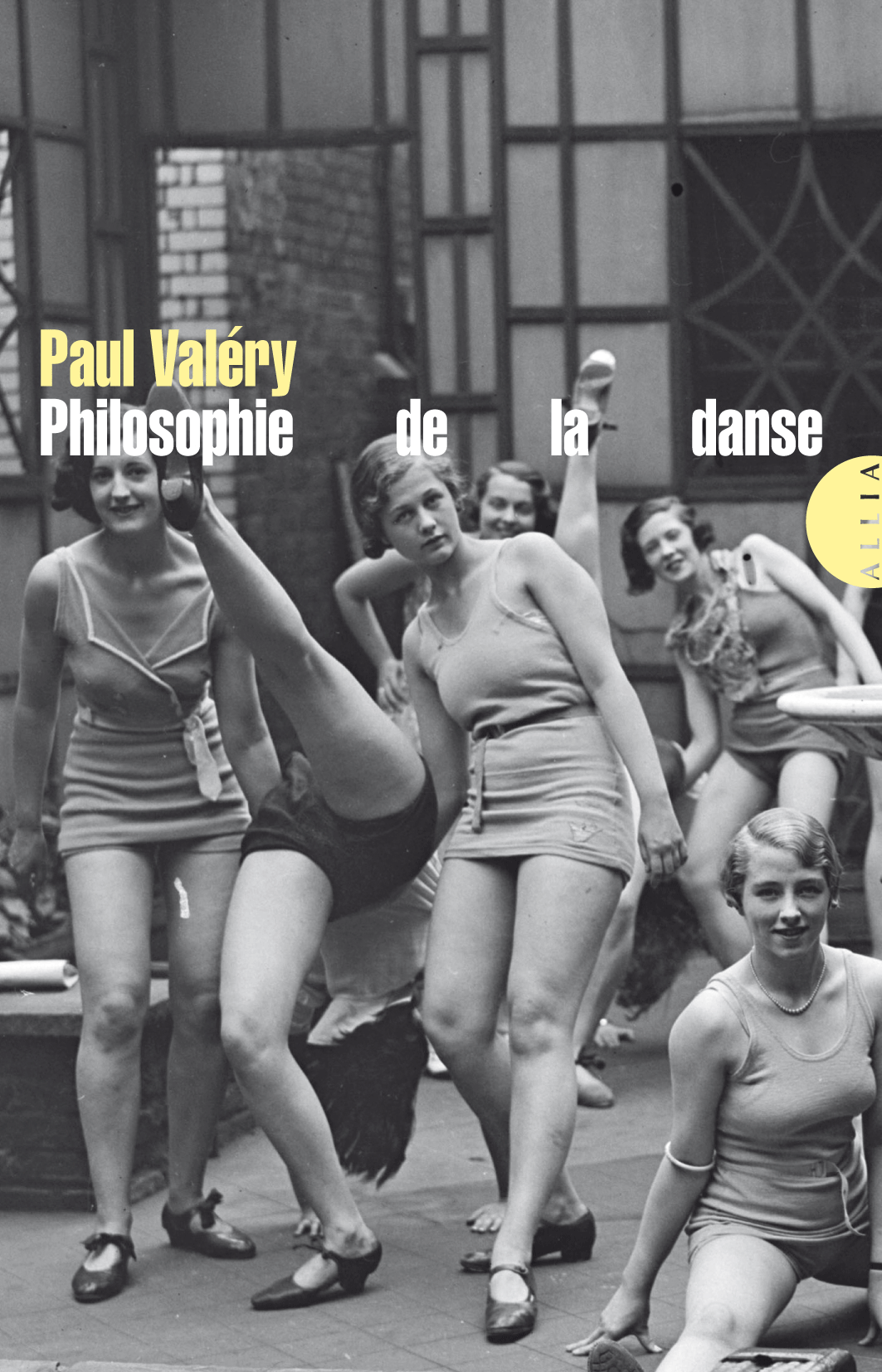 Paul Valéry, Philosophie de la danse Paris : Allia, 2015. 48 p. EAN 9782844859464 3,10 EUR Présentation de l'éditeur : Oui, ce corps dansant semble ignorer le reste, ne rien savoir de tout ce qui l'environne. On dirait qu'il s’écoute et n'écoute que soi ; on dirait qu'il ne voit rien, et que les yeux qu'il porte ne sont que des joyaux, de ces bijoux inconnus dont parle Baudelaire, des lueurs qui ne lui servent de rien. C'est donc bien que la danseuse est dans un autre monde, qui n'est plus celui qui se peint de nos regards, mais celui qu'elle tisse de ses pas et construit de ses gestes. Mais, dans ce monde-là, il n'y a point de but extérieur aux actes ; il n'y a pas d’objet à saisir, à rejoindre ou à repousser ou à fuir, un objet qui termine exactement une action et donne aux mouvements, d'abord, une direction et une coordination extérieures, et ensuite une conclusion nette et certaine. Un réflexion passionnée et passionnante qui ravira les break dancers, les valseurs du dimanche, les amateurs de tango musette, de cucaracha, de bourrée bretonne, de boogie woogie, les couturiers de la fisel, les noctambules de la zumba ou de la tecktonik, mais aussi ceux qui ne dansent pas, qui n'aiment pas danser, les indécollables de la tapisserie comme les amateurs de philosophie. Se détachant de l'utile, la danse est une action poétique. L'homme a découvert le plaisir pris dans le rythme, dans l'enivrement des sens jusqu'à épuisement. L'oralité du conférencier donne à ce bref texte énergique l'ivresse du mouvement sans fin. Observez le ballet des doigts du pianiste, le mouvement de la toupie, tout est danse. Une poésie de l'arbitraire que Paul Valéry nous fait sentir avec sa sensibilité particulière. On assiste en acte autant à une philosophie de la danse qu'à une danse de la philosophie. Lire un extrait
Paul Valéry, Philosophie de la danse Paris : Allia, 2015. 48 p. EAN 9782844859464 3,10 EUR Présentation de l'éditeur : Oui, ce corps dansant semble ignorer le reste, ne rien savoir de tout ce qui l'environne. On dirait qu'il s’écoute et n'écoute que soi ; on dirait qu'il ne voit rien, et que les yeux qu'il porte ne sont que des joyaux, de ces bijoux inconnus dont parle Baudelaire, des lueurs qui ne lui servent de rien. C'est donc bien que la danseuse est dans un autre monde, qui n'est plus celui qui se peint de nos regards, mais celui qu'elle tisse de ses pas et construit de ses gestes. Mais, dans ce monde-là, il n'y a point de but extérieur aux actes ; il n'y a pas d’objet à saisir, à rejoindre ou à repousser ou à fuir, un objet qui termine exactement une action et donne aux mouvements, d'abord, une direction et une coordination extérieures, et ensuite une conclusion nette et certaine. Un réflexion passionnée et passionnante qui ravira les break dancers, les valseurs du dimanche, les amateurs de tango musette, de cucaracha, de bourrée bretonne, de boogie woogie, les couturiers de la fisel, les noctambules de la zumba ou de la tecktonik, mais aussi ceux qui ne dansent pas, qui n'aiment pas danser, les indécollables de la tapisserie comme les amateurs de philosophie. Se détachant de l'utile, la danse est une action poétique. L'homme a découvert le plaisir pris dans le rythme, dans l'enivrement des sens jusqu'à épuisement. L'oralité du conférencier donne à ce bref texte énergique l'ivresse du mouvement sans fin. Observez le ballet des doigts du pianiste, le mouvement de la toupie, tout est danse. Une poésie de l'arbitraire que Paul Valéry nous fait sentir avec sa sensibilité particulière. On assiste en acte autant à une philosophie de la danse qu'à une danse de la philosophie. Lire un extrait
 Robert Musil, De la bêtise Traduit de l'allemand par Matthieu Dumont et Arthur Lochmann. Paris : Allia, 2015. 64 p. EAN 9782844859495 6,20 EUR Présentation de l'éditeur : Dans la vie de tous les jours, on a coutume de considérer comme bête une personne "un peu faible de la tête". Mais les variantes qui affectent l'âme comme l’esprit sont fort nombreuses, et peuvent entraver, contrarier ou fourvoyer jusqu'aux intelligences les plus saines que la nature ait faites, de sorte qu'on en revient finalement à des cas pour lesquels la langue ne dispose encore que d'un seul nom : la bêtise. Ce mot recouvre donc deux réalités au fond très différentes : la bêtise probe des simples, et l'autre, quelque peu paradoxale, qui est même un signe d'intelligence. Dans la première, la faiblesse de l'entendement est absolue, tandis que dans la seconde elle n'est que relative. C'est de loin cette deuxième forme qui est la plus dangereuse. Célèbre surtout pour son œuvre romanesque, Robert Musil (1880-1942) est aussi l'auteur de nombreux essais, conférences et aphorismes, qui le montrent attentif aux mutations de la conscience moderne. De la bêtise , qu'il considérait comme l'un de ses textes majeurs, aborde un sujet tabou dans la pensée classique : confrontée à son contraire, la réflexion ne court-elle pas le risque de vaciller sur ses bases ? "Si la bêtise ne ressemblait pas à s’y méprendre au progrès, au talent, à l'espoir ou au perfectionnement, personne ne voudrait être bête." Lire un extrait
Robert Musil, De la bêtise Traduit de l'allemand par Matthieu Dumont et Arthur Lochmann. Paris : Allia, 2015. 64 p. EAN 9782844859495 6,20 EUR Présentation de l'éditeur : Dans la vie de tous les jours, on a coutume de considérer comme bête une personne "un peu faible de la tête". Mais les variantes qui affectent l'âme comme l’esprit sont fort nombreuses, et peuvent entraver, contrarier ou fourvoyer jusqu'aux intelligences les plus saines que la nature ait faites, de sorte qu'on en revient finalement à des cas pour lesquels la langue ne dispose encore que d'un seul nom : la bêtise. Ce mot recouvre donc deux réalités au fond très différentes : la bêtise probe des simples, et l'autre, quelque peu paradoxale, qui est même un signe d'intelligence. Dans la première, la faiblesse de l'entendement est absolue, tandis que dans la seconde elle n'est que relative. C'est de loin cette deuxième forme qui est la plus dangereuse. Célèbre surtout pour son œuvre romanesque, Robert Musil (1880-1942) est aussi l'auteur de nombreux essais, conférences et aphorismes, qui le montrent attentif aux mutations de la conscience moderne. De la bêtise , qu'il considérait comme l'un de ses textes majeurs, aborde un sujet tabou dans la pensée classique : confrontée à son contraire, la réflexion ne court-elle pas le risque de vaciller sur ses bases ? "Si la bêtise ne ressemblait pas à s’y méprendre au progrès, au talent, à l'espoir ou au perfectionnement, personne ne voudrait être bête." Lire un extrait
 Traversé par des fractures historiques fortes, le XIX e siècle a donné naissance à la littérature «considérée dans ses rapports avec les institutions sociales» (Madame de Staël). Lorsque émerge et se développe l’idée d’autonomisation de la littérature, dans la seconde moitié du siècle, comment cette dernière va-t-elle se situer face aux événements contemporains - Commune, affaire Dreyfus, Grande Guerre - , qui marquent la période et infléchissent l’histoire? Ces quarante années témoignent à la fois de l’évolution du lien entre littérature et politique, et de la mise en place d’un nouveau système d’autonomisation de la littérature, dont il faut interroger l’évidence, fixée a posteriori dans le clivage (configuré après 1945) entre écriture engagée et écriture dégagée de l’histoire. Contemporaine de la séparation des disciplines et de la naissance des sciences sociales, l’autonomie de la littérature est-elle affirmation de la puissance de la littérature, ou bien relégation de fait- ou encore oubli de ses alliances passées? Le colloque «De l’absolu littéraire à la relégation: le poète hors les murs. Littérature et politique» (tenu en 2011 à Montpellier, dans le cadre du projet ANR HIDIL) présente des analyses de ce moment de bascule où se substituent à l’union tranquille de la littérature et de l’histoire des modalités plus conflictuelles et des configurations nouvelles.
Traversé par des fractures historiques fortes, le XIX e siècle a donné naissance à la littérature «considérée dans ses rapports avec les institutions sociales» (Madame de Staël). Lorsque émerge et se développe l’idée d’autonomisation de la littérature, dans la seconde moitié du siècle, comment cette dernière va-t-elle se situer face aux événements contemporains - Commune, affaire Dreyfus, Grande Guerre - , qui marquent la période et infléchissent l’histoire? Ces quarante années témoignent à la fois de l’évolution du lien entre littérature et politique, et de la mise en place d’un nouveau système d’autonomisation de la littérature, dont il faut interroger l’évidence, fixée a posteriori dans le clivage (configuré après 1945) entre écriture engagée et écriture dégagée de l’histoire. Contemporaine de la séparation des disciplines et de la naissance des sciences sociales, l’autonomie de la littérature est-elle affirmation de la puissance de la littérature, ou bien relégation de fait- ou encore oubli de ses alliances passées? Le colloque «De l’absolu littéraire à la relégation: le poète hors les murs. Littérature et politique» (tenu en 2011 à Montpellier, dans le cadre du projet ANR HIDIL) présente des analyses de ce moment de bascule où se substituent à l’union tranquille de la littérature et de l’histoire des modalités plus conflictuelles et des configurations nouvelles.
 La Boétie - De la servitude volontaire ou Contr'un Olivier Guerrier, Michaël Boulet, Mathilde Thorel Date de parution : 11/01/2015 Editeur : Atlande Collection : Clefs Concours ISBN : 978-2-35030-288-1 EAN : 9782350302881 Présentation : Broché Nb. de pages : 250 p.
La Boétie - De la servitude volontaire ou Contr'un Olivier Guerrier, Michaël Boulet, Mathilde Thorel Date de parution : 11/01/2015 Editeur : Atlande Collection : Clefs Concours ISBN : 978-2-35030-288-1 EAN : 9782350302881 Présentation : Broché Nb. de pages : 250 p.
 Rire des femmes (avec Molière) Séminaire de Lise Michel et Marc Escola assistés de Coline Piot Université de Lausanne Semestre de printemps Jeudi 10h15-12h, Anthropole/4078, du 19 février au 28 mai Est-il seulement permis de rire (au théâtre) lorsqu’une femme est réduite au silence à coup de bâtons par son mari alcoolique (Martine dans Le Médecin malgré lui ) ? Qu’ont donc de comique la sottise d’une jeune fille privée de toute éducation par la volonté d’un tuteur tyrannique (Agnès dans L’École des femmes ) et les discours d’un homme pour lequel l’esprit féminin n’est rien de plus qu’une «girouette dans le vent» (Gros-René dans Le Dépit amoureux )? Et inversement : en quoi deux femmes qui militent pour un égal accès au savoir entre les deux sexes sont-elles ridicules (Philaminte et Armande dans Les Femmes savantes )? La complète humiliation d’une coquette trop sûre d’elle-même est-ellevraiment comique (Célimène dans Le Misanthrope )? Sait-on toujours de quoi les spectateurs se moquaient lorsqu’ils riaient aux pièces de Molière, et de quoi nous nous moquons? Rousseau en doutait nettement dans la Lettre à d’Alembert sur les spectacles. S’il entre une part de mystère dans le génie comique de Molière, ou une part de magie dont les spectateurs font l’épreuve génération après génération depuis plus de trois siècles, elle passe peut-être par le traitement accordé aux «caractères» féminins. Le séminaire se propose de comprendre, dans son principe et son contexte de production, le fonctionnement d’un humour singulier, qu’une critique postérieure a bien rapidement considéré comme misogyne, le réduisant à n’être qu’une manifestation de la «querelle des femmes» parcourant les siècles classiques. On confrontera quelques comédies de Molière aux débats qui leur sont contemporains sur la question féminine dont elles se font apparemment l’écho (au vrai, le milieu du XVIIe siècle voit l’apparition des premiers manifestes «féministes»), mais aussi à ce que l’on peut savoir de la réception des pièces. Comment expliquer qu’un large public féminin ait fait le succès d’un théâtre qui maltraite aussi régulièrement «le beau sexe»? On sait assez ce qu’est un rire misogyne : est-il seulement permis de postuler l’existence d’un rire «philogyne» dont les femmes seraient (avec Molière) les complices avisées ? Pièces retenues : - Les Précieuses ridicules , éd. C. Bourqui, Le Livre de Poche, 1999. - Sganarelle ou le Cocu imaginaire , éd. P. Dandrey, Paris, Gallimard, Folio, 2004. - L’Ecole des maris , Paris, Petits classiques Larousse, 2014. - Le Dépit amoureux – texte fourni sur l’espace Moodle du séminaire. - L’École des femmes , éd. B. Louvat, Paris, Flammarion, «GF», 2011. - Le Médecin malgré lui , éd. B. Rey-Flaud, Paris, Le Livre de Poche, 1986. - Les Femmes savantes , éd. C. Bourqui, Paris, Le Livre de Poche, 1999. - Le Misanthrope , éd. C. Bourqui, Paris, Le Livre de Poche, 2000.
Rire des femmes (avec Molière) Séminaire de Lise Michel et Marc Escola assistés de Coline Piot Université de Lausanne Semestre de printemps Jeudi 10h15-12h, Anthropole/4078, du 19 février au 28 mai Est-il seulement permis de rire (au théâtre) lorsqu’une femme est réduite au silence à coup de bâtons par son mari alcoolique (Martine dans Le Médecin malgré lui ) ? Qu’ont donc de comique la sottise d’une jeune fille privée de toute éducation par la volonté d’un tuteur tyrannique (Agnès dans L’École des femmes ) et les discours d’un homme pour lequel l’esprit féminin n’est rien de plus qu’une «girouette dans le vent» (Gros-René dans Le Dépit amoureux )? Et inversement : en quoi deux femmes qui militent pour un égal accès au savoir entre les deux sexes sont-elles ridicules (Philaminte et Armande dans Les Femmes savantes )? La complète humiliation d’une coquette trop sûre d’elle-même est-ellevraiment comique (Célimène dans Le Misanthrope )? Sait-on toujours de quoi les spectateurs se moquaient lorsqu’ils riaient aux pièces de Molière, et de quoi nous nous moquons? Rousseau en doutait nettement dans la Lettre à d’Alembert sur les spectacles. S’il entre une part de mystère dans le génie comique de Molière, ou une part de magie dont les spectateurs font l’épreuve génération après génération depuis plus de trois siècles, elle passe peut-être par le traitement accordé aux «caractères» féminins. Le séminaire se propose de comprendre, dans son principe et son contexte de production, le fonctionnement d’un humour singulier, qu’une critique postérieure a bien rapidement considéré comme misogyne, le réduisant à n’être qu’une manifestation de la «querelle des femmes» parcourant les siècles classiques. On confrontera quelques comédies de Molière aux débats qui leur sont contemporains sur la question féminine dont elles se font apparemment l’écho (au vrai, le milieu du XVIIe siècle voit l’apparition des premiers manifestes «féministes»), mais aussi à ce que l’on peut savoir de la réception des pièces. Comment expliquer qu’un large public féminin ait fait le succès d’un théâtre qui maltraite aussi régulièrement «le beau sexe»? On sait assez ce qu’est un rire misogyne : est-il seulement permis de postuler l’existence d’un rire «philogyne» dont les femmes seraient (avec Molière) les complices avisées ? Pièces retenues : - Les Précieuses ridicules , éd. C. Bourqui, Le Livre de Poche, 1999. - Sganarelle ou le Cocu imaginaire , éd. P. Dandrey, Paris, Gallimard, Folio, 2004. - L’Ecole des maris , Paris, Petits classiques Larousse, 2014. - Le Dépit amoureux – texte fourni sur l’espace Moodle du séminaire. - L’École des femmes , éd. B. Louvat, Paris, Flammarion, «GF», 2011. - Le Médecin malgré lui , éd. B. Rey-Flaud, Paris, Le Livre de Poche, 1986. - Les Femmes savantes , éd. C. Bourqui, Paris, Le Livre de Poche, 1999. - Le Misanthrope , éd. C. Bourqui, Paris, Le Livre de Poche, 2000.
 Claire Westall & Michael Gardiner, The Public on the Public: The British Public as Trust, Reflexivity and Political Foreclosure Londres : Palgrave Macmillian, col. "Palgrave Pivot", 2015. EAN 9781137351333. 154 p. Prix : £45 Présentation de l'éditeur : The Public on the Public argues that in the United Kingdom efforts to resuscitate the public as a popular opposition to global capital's narrowing elite are largely misguided. Tracking Britain's understanding of the public from the inception of its state, this discussion intervenes in longstanding debates about the decline of the public in order to stress the public's ongoing and anti-popular constitutional role as the continuity of financial trust . It follows the fiscal duties of the social and cultural life of the public, and describes how the public protects itself from popular sovereignty through systems of self-reporting within and across politically foreclosing institutions. From the party system to the BBC, and from the imperial remnants of commonwealth heritage through to media, arts and educational efforts to galvanise 'public value', the public has insisted on a mode of compulsory inclusion that recent constitutional fissures have allowed us to look beyond in the search for more substantial bases of popular and political action. Here the contention is that, in Britain's case, the resistance to popular determination enabled by the public has been so successful that the term public must be re-read as politically paralysing. Indeed, the problem, or our problem ,is the public – that which we are so often told will bring us together and provide for us. Contents: 1. Introduction: We are not 'The Public' 2. The Public as Financial Trust 3. The Public as Cultural Commonwealth 4. Public Participation as Debt Demand 5. Public Reflexivity as Political Foreclosure 6. The Arts of Public Value 7. Coda: On not Saving 'The Public'
Claire Westall & Michael Gardiner, The Public on the Public: The British Public as Trust, Reflexivity and Political Foreclosure Londres : Palgrave Macmillian, col. "Palgrave Pivot", 2015. EAN 9781137351333. 154 p. Prix : £45 Présentation de l'éditeur : The Public on the Public argues that in the United Kingdom efforts to resuscitate the public as a popular opposition to global capital's narrowing elite are largely misguided. Tracking Britain's understanding of the public from the inception of its state, this discussion intervenes in longstanding debates about the decline of the public in order to stress the public's ongoing and anti-popular constitutional role as the continuity of financial trust . It follows the fiscal duties of the social and cultural life of the public, and describes how the public protects itself from popular sovereignty through systems of self-reporting within and across politically foreclosing institutions. From the party system to the BBC, and from the imperial remnants of commonwealth heritage through to media, arts and educational efforts to galvanise 'public value', the public has insisted on a mode of compulsory inclusion that recent constitutional fissures have allowed us to look beyond in the search for more substantial bases of popular and political action. Here the contention is that, in Britain's case, the resistance to popular determination enabled by the public has been so successful that the term public must be re-read as politically paralysing. Indeed, the problem, or our problem ,is the public – that which we are so often told will bring us together and provide for us. Contents: 1. Introduction: We are not 'The Public' 2. The Public as Financial Trust 3. The Public as Cultural Commonwealth 4. Public Participation as Debt Demand 5. Public Reflexivity as Political Foreclosure 6. The Arts of Public Value 7. Coda: On not Saving 'The Public'
 Brigitte Brami, Miracle de Jean Genet Paris : L'Harmattan, coll. "L'écarlate", 2014.EAN 9782343040035.198 p.Prix 19EUR Présentation de l'éditeur : Inclassable et dérangeant, Miracle de Jean Genet nest pas un ovni. Cest une exégèse sans les murs, sans lacadémisme universitaire habituel. Cest un long poème écrit par une captive amoureuse aussi déjantée quérudite ; cest une bombe littéraire sans retardement, tout comme on a parlé de la « bombe Genet » (Jean Cocteau) au sujet de lauteur de Miracle de la rose .Le Miracle de Jean Genet , cest celui de la poésie qui pulvérise tous les paradigmes éculés, fait voler en léclat les flicages quels quils soient, y compris ceux de la pensée. Cette exégèse est composée de 3 grandes paries : Le Théâtre du pouvoir Le Pouvoir du théâtre et Le Miracle de la poésie elle comporte également un Epilogue : Allers et retours dans le désert, une (petite) bibliographie, et se termine par des annexes Concernant l'auteure : Brigitte Brami est née en 1964, à Tunis et vit à Paris. Après la publication d’un recueil de poèmes : La Lune verte, puis l’obtention d’un Diplôme d’Études Approfondies (Master 2) en arts du spectacle, et des études doctorales en littérature et civilisation françaises, l’auteure s’est surtout fait remarquer, en 2011, par le succès en librairie d’un petit livre relatant sa première incarcération à Fleury-Mérogis – du 18 juin au 29 novembre 2008 - : La Prison ruinée. Spécialiste depuis 1995 de l’œuvre de Jean Genet, elle y célèbre ici le miracle de sa poésie. C’est lors de sa deuxième incarcération à la MAF – du 22 novembre 2013 au 14 mai 2014 - qu’elle a finalisé les corrections de Miracle de Jean Genet.
Brigitte Brami, Miracle de Jean Genet Paris : L'Harmattan, coll. "L'écarlate", 2014.EAN 9782343040035.198 p.Prix 19EUR Présentation de l'éditeur : Inclassable et dérangeant, Miracle de Jean Genet nest pas un ovni. Cest une exégèse sans les murs, sans lacadémisme universitaire habituel. Cest un long poème écrit par une captive amoureuse aussi déjantée quérudite ; cest une bombe littéraire sans retardement, tout comme on a parlé de la « bombe Genet » (Jean Cocteau) au sujet de lauteur de Miracle de la rose .Le Miracle de Jean Genet , cest celui de la poésie qui pulvérise tous les paradigmes éculés, fait voler en léclat les flicages quels quils soient, y compris ceux de la pensée. Cette exégèse est composée de 3 grandes paries : Le Théâtre du pouvoir Le Pouvoir du théâtre et Le Miracle de la poésie elle comporte également un Epilogue : Allers et retours dans le désert, une (petite) bibliographie, et se termine par des annexes Concernant l'auteure : Brigitte Brami est née en 1964, à Tunis et vit à Paris. Après la publication d’un recueil de poèmes : La Lune verte, puis l’obtention d’un Diplôme d’Études Approfondies (Master 2) en arts du spectacle, et des études doctorales en littérature et civilisation françaises, l’auteure s’est surtout fait remarquer, en 2011, par le succès en librairie d’un petit livre relatant sa première incarcération à Fleury-Mérogis – du 18 juin au 29 novembre 2008 - : La Prison ruinée. Spécialiste depuis 1995 de l’œuvre de Jean Genet, elle y célèbre ici le miracle de sa poésie. C’est lors de sa deuxième incarcération à la MAF – du 22 novembre 2013 au 14 mai 2014 - qu’elle a finalisé les corrections de Miracle de Jean Genet.