Appel à contribution Colloque: vendredi 18 novembre 2016 à Paris et vendredi 31 mars 2017 à Lausanne Propositions à envoyer avant le : 31 juillet 2016 Organisation: Université de Paris-Sorbonne (EA 3556 REIGENN et UFR d’études germaniques et nordiques) & Université de Lausanne Homme de lettres et grand voyageur, Xavier Marmier (1808-1892) a joué un rôle majeur d’intermédiaire entre la France et les aires culturelles septentrionales. Ses nombreux articles et ouvrages ont contribué à mieux faire connaître la géographie, l’histoire et la culture des pays du Nord (Islande, Féroé, Danemark, Norvège, Suède, Finlande, Pays-Bas, Allemagne) en France, ainsi que dans d’autres pays d’Europe où étaient traduites ses études. Ses voyages commencent en Allemagne, avec un premier séjour en 1831. Il publie des articles dans différentes revues littéraires comme la Revue Germanique , la Revue de Paris ou la Revue des deux mondes , incarnant «plus encore qu’Ampère ou Bonstetten un rêve romantique-philologue du Nord germanique et scandinave» [1] . C’est son intérêt pour les cultures étrangères qui le pousse à devenir traducteur d’auteurs allemands et critique littéraire. La bonne réception de son étude sur Goethe [2] et d’articles sur les mœurs, les institutions, le folklore, l’histoire et la littérature allemande, lui permet de participer à l’expédition de La Recherche sur les mers du Nord. Il est chargé par l’Académie française d’étudier les sagas et de recueillir tous les documents possibles sur les traditions, la littérature, l’histoire et les mœurs des Islandais. La cohérence et l’ampleur de son travail intellectuel font de lui un des pionniers de la littérature comparée en France: «en un temps où dominait encore en France un sentiment de supériorité culturelle établi depuis la Renaissance et que les tensions de la période révolutionnaire avait encore conforté, Xavier Marmier fut l’un des plus ardents défenseurs de l’idée d’une nécessaire ouverture vers les littératures étrangères» [3] . Il a également fait partie de ce que l’on pourrait appeler les précurseurs de l’anthropologie et de l’ethnologie moderne. A la suite de sa première expédition en Islande, il a souligné la nécessité de voyager et de vivre parmi les peuples dont on étudie l’histoire et la littérature: "il est vrai cependant que j’aurais pu trouver, à Paris, à la Bibliothèque du Roi, une grande partie des trésors poétiques que j’allais chercher si loin […]. Mais c’est une chose importante de voir le pays dont on étudie l’histoire, de vivre parmi les hommes dont on veut connaître la langue. Il y a entre la poésie d’un peuple et la terre qu’il habite, et la nature qui l’entoure, et le ciel sous lequel il vit, une alliance intime, alliance que peu de livres révèlent, et qu’il faut avoir observée sur les lieux mêmes pour bien la sentir [4] ." Son travail, témoignage des nouveaux intérêts de son époque, est d’autant plus intéressant à étudier qu’il marque le début des grandes explorations scientifiques. Par ses nombreux récits de voyage et recueils de lettres, Xavier Marmier fait découvrir en France des pays du Nord encore mal connus: «après les laborieuses explorations du siècle passé et du siècle actuel, nous en sommes encore, à l’égard des contrées septentrionales, à peu près au même point de vue que nos ancêtres» [5] . La publication de Chants populaires du Nord est un exemple «de la façon dont le déterminisme fondé sur la théorie des climats de Montesquieuet articulé sur l’opposition Nord-Sud opère un élargissement vers ce qui était encore la périphérie exotique de l’Europe» [6] . En effet, dès l’introduction Marmier s’attachait à montrer la permanence culturelle du Nord, en particulier poétique, malgré la rigueur du climat qui augmentait à mesure de l’avancement vers les terres situées à la longitude du cercle polaire. Son œuvre est très variée: on y trouve, en plus des récits de voyage, des œuvres d’histoire [7] , des essais et des romans [8] , des traductions de pièces de théâtre [9] et de contes [10] , ainsi que de la poésie [11] . Si ses travaux sur les littératures étrangères et ses récits lui avaient valu d’être élu à l’Académie française le 19 mai 1870, il est surtout considéré de nos jours comme l’un des premiers à faire connaître en France la littérature scandinave et germanique. Nombre de chercheurs issus de disciplines différentes se réfèrent encore aujourd’hui aux travaux de ce pionnier des études germaniques et nordiques. Il représente donc un objet d’étude idéal dans le cadre d’un colloque interdisciplinaire réunissant des travaux de chercheurs de tout bord: histoire, géographie, littérature, philologie, culture, etc. Ce sera l’occasion d’étudier l’image que Marmier donne du Nord et de la confronter aux travaux de chercheurs contemporains. Les organisateurs font appel à des communications portant sur les territoires du Nord parcourus par Marmier, parmi lesquels l’Allemagne, les Pays-Bas, le Danemark, la Suède, la Norvège, l’Islande, et le Groenland. On analysera entre autres l’activité de traducteur de Marmier, ses histoires littéraires, la relation avec les travaux de ses prédécesseurs (Paul-Henri Mallet notamment) et sa postérité. Le colloque donnera lieu en 2018 à la publication d’un numéro collectif dans la revue Deshima .Merci d’envoyer vos propositions (200 mots) accompagnées d’une courte notice biobibliographique avant le 31 juillet 2016 à Gaëlle Reneteaud-Metzger ( gaelle.reneteaud@gmail.com ) et Cyrille François ( cyrille.francois@unil.ch ). Les propositions seront évaluées par le comité scientifique et réparties à Lausanne ou à Paris selon les regroupements thématiques. Comité scientifiqueBernard Banoun (Université de Paris-Sorbonne)Thomas Beaufils (Université de Lille 3)Sylvain Briens (Université de Paris-Sorbonne)Jérôme David (Université de Genève)Martine Hennard Dutheil (Université de Lausanne)Thomas Mohnike (Université de Strasbourg)Marthe Segrestin (Université de Paris-Sorbonne)Irene Weber Henking (Université de Lausanne) Organisation : Gaëlle Reneteaud-Metzger (Université de Paris-Sorbonne) et Cyrille François (Université de Lausanne) [1] Michel Espagne, «Le moment allemand dans l’étude française des pays du Nord», Michel Espagne, 2006, Tusson, Le prisme du Nord. Pays du Nord, France, Allemagne (1750-1920) , édition Du Lérot, p.197. [2] Xavier Marmier, 1835, Etude sur Goethe , Paris, édition F.G. Levrault. [3] Maria Walecka-Garbalinska, « Du décentrement au désenchantement, Xavier Marmier et les origines du comparatisme français », Christian Benne, Svend Erik Larsen, Morten Nøjgaard et Lars Ole Sauerberg, 2013, Orbis Litterarum , Volume 68, p.1. [4] Xavier Marmier, 1855 (quatrième édition), Lettres sur l’Islande et poésies , Paris, édition Arthus Bertrand, Préface, pp.XV-XVI. Première édition parue en 1837 chez Félix Bonnaire. [5] Xavier Marmier, Lettres sur le Nord , Paris, Delloye, 1840, Tome 1 préface, pp.V-VI. [6] Maria Walecka-Garbalinska, « Du décentrement au désenchantement, Xavier Marmier et les origines du comparatisme français », Christian Benne, Svend Erik Larsen, Morten Nøjgaard et Lars Ole Sauerberg, 2013, Orbis Litterarum , Volume 68, p.7. [7] Histoire de la Scandinavie : Danemarck, Suède et Norvége , 1840, Paris, édition Bertrand et Histoires allemandes et scandinaves , 1891, Paris, édition Calmann Lévy. [8] Les fiancés de Spitzberg et Gazida qui sont récompensés par l’Académie française. [9] Théâtre choisi de Oehlenschlæger et de Holberg , 1881, Paris, édition Didier. [10] Contes fantastiques d’Hoffmann , 1858, Paris, édition Charpentier. [11] Son premier recueil s’intitule Nouvelles Esquisses , 1831, Vesoul, édition Zaepffel.
↧
Le(s) Nord de Xavier Marmier (Paris & Lausanne)
↧
F. Mercier, Les Ecrivains du 7e art
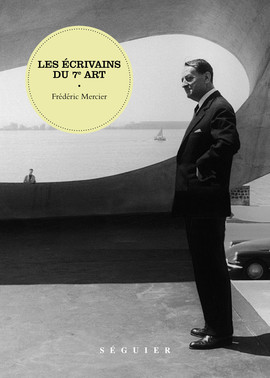 Frédéric Mercier, Les Ecrivains du 7e art Paris : Séguier Edition, 2016. 372 p. EAN 9782840496953 22,00 EUR Présentation de l'éditeur : Qui se souvient que Joseph Kessel a écrit une trentaine de scripts pour le cinéma ? Ou que Jean Giono signa le scénario d’un film dont Jean-Luc Godard fut convaincu qu’il était le symbole de la modernité cinématographique ? Comme eux, Céline, André Malraux, Julien Green, Roger Nimier, Françoise Sagan, Patrick Modiano, Romain Gary, Michel Houellebecq, Emmanuel Carrère, François Bégaudeau – et bien d’autres encore – ont mis leur talent d’hommes de lettres au service du cinéma en tant que scénaristes, dialoguistes et parfois réalisateurs. Les Écrivains du 7e art est une plongée amoureuse dans ces aventures cinématographiques parfois méconnues, qui convoque également les figures d’Éric Rohmer, François Truffaut, Arnaud Desplechin pour interroger la notion d’« auteur de cinéma », et tenter de remettre en lumière certains films aujourd’hui oubliés ou injustement mésestimés. Frédéric Mercier est critique de cinéma. Après avoir travaillé plusieurs années pour la chaîne de cinéma classique TCM Cinéma et collaboré avec les Cahiers du Cinéma, il est aujourd'hui membre de la rédaction de la revue Transfuge.
Frédéric Mercier, Les Ecrivains du 7e art Paris : Séguier Edition, 2016. 372 p. EAN 9782840496953 22,00 EUR Présentation de l'éditeur : Qui se souvient que Joseph Kessel a écrit une trentaine de scripts pour le cinéma ? Ou que Jean Giono signa le scénario d’un film dont Jean-Luc Godard fut convaincu qu’il était le symbole de la modernité cinématographique ? Comme eux, Céline, André Malraux, Julien Green, Roger Nimier, Françoise Sagan, Patrick Modiano, Romain Gary, Michel Houellebecq, Emmanuel Carrère, François Bégaudeau – et bien d’autres encore – ont mis leur talent d’hommes de lettres au service du cinéma en tant que scénaristes, dialoguistes et parfois réalisateurs. Les Écrivains du 7e art est une plongée amoureuse dans ces aventures cinématographiques parfois méconnues, qui convoque également les figures d’Éric Rohmer, François Truffaut, Arnaud Desplechin pour interroger la notion d’« auteur de cinéma », et tenter de remettre en lumière certains films aujourd’hui oubliés ou injustement mésestimés. Frédéric Mercier est critique de cinéma. Après avoir travaillé plusieurs années pour la chaîne de cinéma classique TCM Cinéma et collaboré avec les Cahiers du Cinéma, il est aujourd'hui membre de la rédaction de la revue Transfuge.
↧
↧
R. Perrin, Pierre Pelot - L'Ecrivain raconteur d'histoires
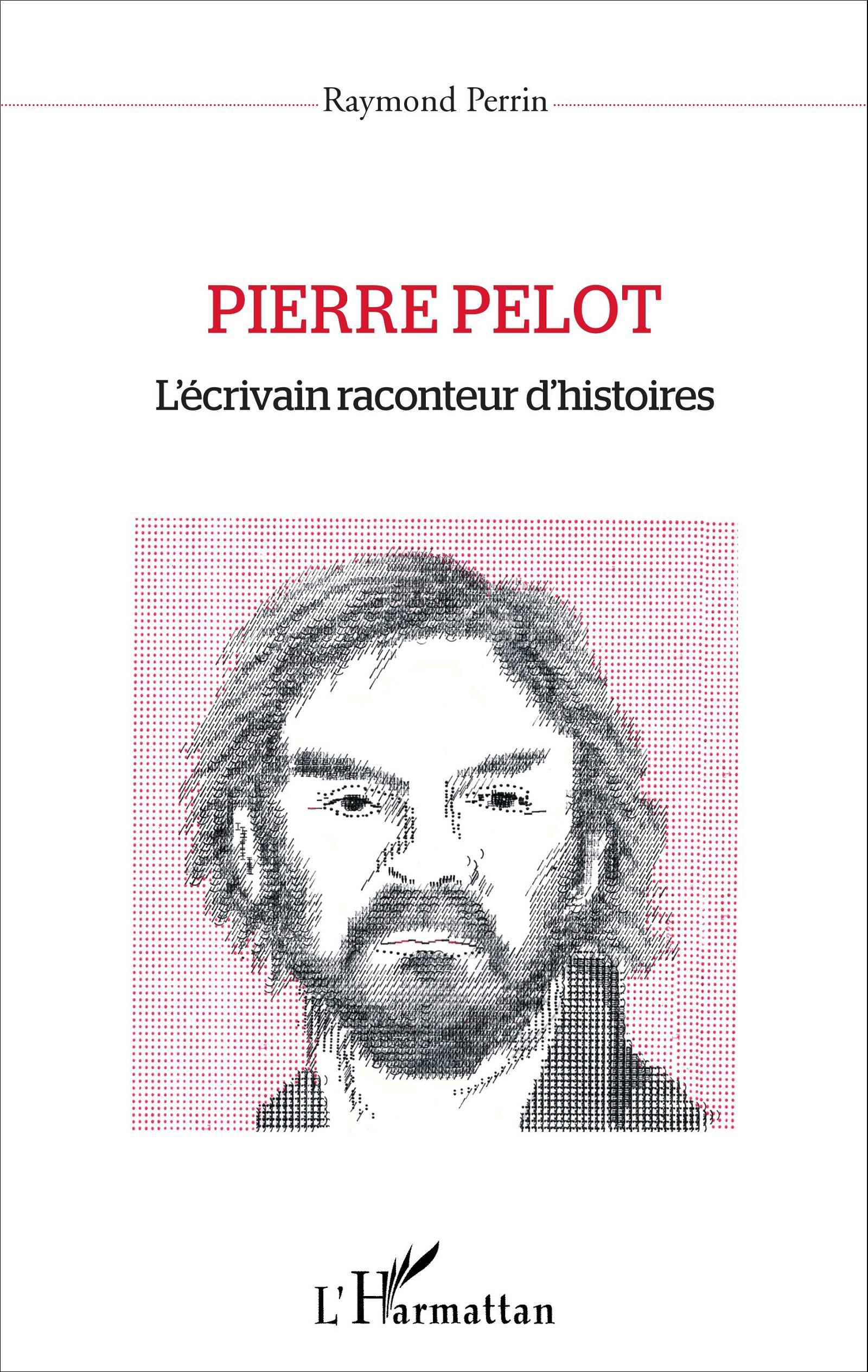 Raymond Perrin, Pierre Pelot - L'Ecrivain raconteur d'histoires Paris : L'Harmattan, 2016. 398 p. EAN 9782343081700 39,00 EUR Présentation de l'éditeur : Le long cheminement multigenre de Pierre Pelot au cours de 50 années d'écriture rend difficile une juste appréciation de son oeuvre et de l'originalité d'un parcours d'écrivain exemplaire. Cet essai vise à donner d'un auteur de près de 200 romans une vision ample et équitable, éloignée des stéréotypes.
Raymond Perrin, Pierre Pelot - L'Ecrivain raconteur d'histoires Paris : L'Harmattan, 2016. 398 p. EAN 9782343081700 39,00 EUR Présentation de l'éditeur : Le long cheminement multigenre de Pierre Pelot au cours de 50 années d'écriture rend difficile une juste appréciation de son oeuvre et de l'originalité d'un parcours d'écrivain exemplaire. Cet essai vise à donner d'un auteur de près de 200 romans une vision ample et équitable, éloignée des stéréotypes.
↧
H. Morgan, Dictionnaire esthétique et thématique de la bande dessinée : "fantasy"
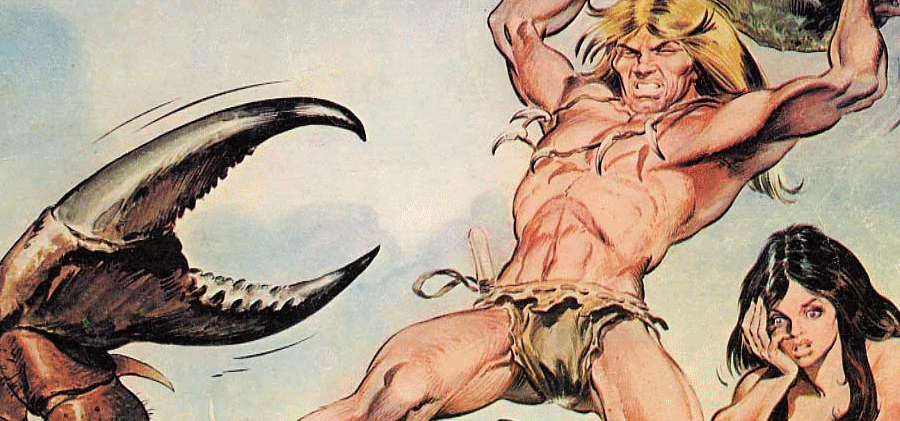 Harry Morgan, Dictionnaire esthétique et thématique de la bande dessinée : "fantasy" Article paru sur le site "neuvième art 2.0", mai 2016. "’ambiguïté, pour ne pas dire le caractère précaire, de la catégorie littéraire de la fantasy est bien manifestée dans le fait qu’on ait conservé pour la désigner un terme anglais, qui présente, de surcroît, toutes les apparences d’un faux ami. Sa traduction littérale, fantaisie , a, en français, des connotations de légèreté et de caprice qui sont aux antipodes d’un genre qui donne au contraire la prééminence à la convention assumée et à la cohérence de l’univers fictionnel. Quant au néologisme de fantasie , recommandé par l’Académie et adopté par la commission générale de terminologie et de néologie (JO du 23 décembre 2007), il ne s’est jamais imposé. Par comparaison, les catégories limitrophes – merveilleux, fantastique – ont, elles, des désignations françaises traditionnelles, tandis que l’expression anglophone de science fiction a été francisée par le simple expédient d’un tiret (science-fiction). Si on la réduit à son noyau thématique, la présence d’un ou plusieurs éléments relevant de mondes imaginaires, on pourrait dire que la fantasy est consubstantielle à la bande dessinée, quand bien même ces éléments trouvent leur source, le cas échéant, dans les littératures écrites. On pense à des personnages longtemps considérés, au moins en France, comme emblématiques de la bande dessinée, comme Tarzan, à des genres comme celui des séries à animaux anthropomorphes ( funny animals ) ou celui des super-héros, à des procédés habituels dans les récits dessinés (le monde fictionnel fait de bric et de broc et aux lois invraisemblables, l’invention fabuleuse comme ressort narratif), voire à des conventions romanesques, présentes dans des séries qui ne se posent cependant pas comme dérogeant aux lois du monde ordinaire (par exemple le fait que, dans l’univers fictionnel, personne, en réalité, ne travaille). Si l’on annexe au domaine toute série incluant, à l’intérieur du monde naturel, quelque élément relevant du merveilleux, tel que super-pouvoir ou faculté prodigieuse, ou encore animal doué de raison, on englobera de facto une grande partie des littératures dessinées. Astérix , Tintin ou Lucky Luke relèvent alors de la fantasy . Le risque d’une telle approche est évidemment de diluer la notion même de fantasy jusqu’à sa disparition. On constate ainsi que la recherche à partir du mot clé fantasy sur des catalogues en ligne de manga renvoie à une grande partie de la production, car des éléments tels que les pouvoirs magiques, les êtres fabuleux, le recours à l’allégorie, font partie des invariants de cette littérature. (...) Lire la suite
Harry Morgan, Dictionnaire esthétique et thématique de la bande dessinée : "fantasy" Article paru sur le site "neuvième art 2.0", mai 2016. "’ambiguïté, pour ne pas dire le caractère précaire, de la catégorie littéraire de la fantasy est bien manifestée dans le fait qu’on ait conservé pour la désigner un terme anglais, qui présente, de surcroît, toutes les apparences d’un faux ami. Sa traduction littérale, fantaisie , a, en français, des connotations de légèreté et de caprice qui sont aux antipodes d’un genre qui donne au contraire la prééminence à la convention assumée et à la cohérence de l’univers fictionnel. Quant au néologisme de fantasie , recommandé par l’Académie et adopté par la commission générale de terminologie et de néologie (JO du 23 décembre 2007), il ne s’est jamais imposé. Par comparaison, les catégories limitrophes – merveilleux, fantastique – ont, elles, des désignations françaises traditionnelles, tandis que l’expression anglophone de science fiction a été francisée par le simple expédient d’un tiret (science-fiction). Si on la réduit à son noyau thématique, la présence d’un ou plusieurs éléments relevant de mondes imaginaires, on pourrait dire que la fantasy est consubstantielle à la bande dessinée, quand bien même ces éléments trouvent leur source, le cas échéant, dans les littératures écrites. On pense à des personnages longtemps considérés, au moins en France, comme emblématiques de la bande dessinée, comme Tarzan, à des genres comme celui des séries à animaux anthropomorphes ( funny animals ) ou celui des super-héros, à des procédés habituels dans les récits dessinés (le monde fictionnel fait de bric et de broc et aux lois invraisemblables, l’invention fabuleuse comme ressort narratif), voire à des conventions romanesques, présentes dans des séries qui ne se posent cependant pas comme dérogeant aux lois du monde ordinaire (par exemple le fait que, dans l’univers fictionnel, personne, en réalité, ne travaille). Si l’on annexe au domaine toute série incluant, à l’intérieur du monde naturel, quelque élément relevant du merveilleux, tel que super-pouvoir ou faculté prodigieuse, ou encore animal doué de raison, on englobera de facto une grande partie des littératures dessinées. Astérix , Tintin ou Lucky Luke relèvent alors de la fantasy . Le risque d’une telle approche est évidemment de diluer la notion même de fantasy jusqu’à sa disparition. On constate ainsi que la recherche à partir du mot clé fantasy sur des catalogues en ligne de manga renvoie à une grande partie de la production, car des éléments tels que les pouvoirs magiques, les êtres fabuleux, le recours à l’allégorie, font partie des invariants de cette littérature. (...) Lire la suite
↧
D. Vaugeois, Malraux à contretemps
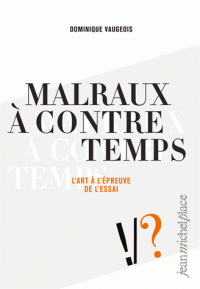 Malraux à contre temps - L'art à l'épreuve de l'essa iDominique Vaugeois Date de parution : 14/05/2016 Editeur : Jean-Michel Place (Nvelles Ed) ISBN : 978-2-85893-981-7 EAN : 9782858939817 Nb. de pages : 352 p. Cet ouvrage retrace la vie mouvementée des textes d’André Malraux sur l’art des années 1930 à nos jours. Exhumant des sources nombreuses et variées, l'analyse des turbulences liées à l’accueil de ce « Malraux » met en scène des joutes aux accents romanesques. Dévotion, rejet radical... Histoire de l’essai littéraire et histoire de l’histoire de l’art révèlent alors combien la pensée peut être un objet de passion. Chemin faisant, une réflexion stimulante sur la vie des œuvres d’art soumises aux paradoxes du temps et lues par les sciences humaines apparaît peu à peu. Au programme : Élie Faure, Georges Duthuit, Pierre Bourdieu, Georges Didi-Huberman… Attentif à l’esprit des époques, cet essai interroge ainsi les grilles de perception qui façonnent et ordonnent les regards. Qu’est-ce qui fonde l’autorité esthétique : celle de l’écrivain, celle du spécialiste ? Comment construire l’historicité de l’art ? En discernant des continuités, des brisures, des enchevêtrements de temporalités? Et que dire de ce « Musée Imaginaire »? Est-il une formule séduisante, un concept esthétique ou encore une notion empirique ouvrant sur une pensée problématique de la culture ? Telles sont quelques-unes des questions invitant, ici, à relire Malraux et à repenser le rôle de ses écrits sur l’art. Dominique Vaugeois est maître des conférences habilitée à diriger des recherches à l'Université de Pau. Ses travaux portent sur l'essai esthétique au XXe siècle. Elle est l'auteur de L'Epreuve du livre. Henri Matisse, roman d'Aragon (Presses universitaires du Septentrion, 2002) et a dirigé, entre autres, "La Valeur" (Revue des sciences humaines, n° 283, 2006), L'Ecrivain et le Spécialiste (avec. I. Rialland, Classiques Garnier, 2010) et le n° 8 de la Revue critique de fixxion française contemporaine ("Fiction et savoirs de l'art", 2014, avec J. Gratton).
Malraux à contre temps - L'art à l'épreuve de l'essa iDominique Vaugeois Date de parution : 14/05/2016 Editeur : Jean-Michel Place (Nvelles Ed) ISBN : 978-2-85893-981-7 EAN : 9782858939817 Nb. de pages : 352 p. Cet ouvrage retrace la vie mouvementée des textes d’André Malraux sur l’art des années 1930 à nos jours. Exhumant des sources nombreuses et variées, l'analyse des turbulences liées à l’accueil de ce « Malraux » met en scène des joutes aux accents romanesques. Dévotion, rejet radical... Histoire de l’essai littéraire et histoire de l’histoire de l’art révèlent alors combien la pensée peut être un objet de passion. Chemin faisant, une réflexion stimulante sur la vie des œuvres d’art soumises aux paradoxes du temps et lues par les sciences humaines apparaît peu à peu. Au programme : Élie Faure, Georges Duthuit, Pierre Bourdieu, Georges Didi-Huberman… Attentif à l’esprit des époques, cet essai interroge ainsi les grilles de perception qui façonnent et ordonnent les regards. Qu’est-ce qui fonde l’autorité esthétique : celle de l’écrivain, celle du spécialiste ? Comment construire l’historicité de l’art ? En discernant des continuités, des brisures, des enchevêtrements de temporalités? Et que dire de ce « Musée Imaginaire »? Est-il une formule séduisante, un concept esthétique ou encore une notion empirique ouvrant sur une pensée problématique de la culture ? Telles sont quelques-unes des questions invitant, ici, à relire Malraux et à repenser le rôle de ses écrits sur l’art. Dominique Vaugeois est maître des conférences habilitée à diriger des recherches à l'Université de Pau. Ses travaux portent sur l'essai esthétique au XXe siècle. Elle est l'auteur de L'Epreuve du livre. Henri Matisse, roman d'Aragon (Presses universitaires du Septentrion, 2002) et a dirigé, entre autres, "La Valeur" (Revue des sciences humaines, n° 283, 2006), L'Ecrivain et le Spécialiste (avec. I. Rialland, Classiques Garnier, 2010) et le n° 8 de la Revue critique de fixxion française contemporaine ("Fiction et savoirs de l'art", 2014, avec J. Gratton).
↧
↧
M. Atallah, A. Boillat, BD-US :Les comics vus par l’Europe
 Référence bibliographique : Marc Atallah et AlainBoillat, BD-US :Les comics vus par l’Europe , Infolio, 2016. EAN13 : 9782884748247. Marc Atallah et AlainBoillat, BD-US :Les comics vus par l’Europe Faisant suite au suite au colloque BD–US / La bande dessinée américaine vue par l’Europe. Réception et réappropriations qui s’était tenu à L’Université de Lausanne en 2014, cet ouvrage réunit des spécialistes de l’étude de la bande dessinée qui proposent une série d’éclairages sur la manière dont les pro- ductions culturelles européennes ont diffusé, exploité, reformulé ou détourné l’imaginaire et le langage des comics venus d’outre- Atlantique. L’approche se veut comparative, interculturelle et intermédiale : les chercheurs abordent autant Edgar P. Jacobs ou les récents albums de Serge Lehman que les séries TV de science- fiction britanniques ou les films d’Alain Resnais, et interroge la réception et les réappropriations de motifs et genres populaires situés au croisement d’influences et de références diverses. La production américaine est ainsi discutée dans toute sa richesse, des super-héros à l’underground, à travers des (re)lectures proposées en Europe. Les comics américains, qu’ils soient mainstream ou underground, influencent sans conteste la BD, la télévision et le cinéma européens, mais par le biais de réappropriations et de détournements analysés ici avec brio par des amoureux du «9 e art». Marc Atallah est directeur de la Maison d’Ailleurs et maître d’enseignement et de recherche à la section de français de l’Université de Lausanne. Alain Boillat est professeur ordinaire à la section d’histoire et esthétique du cinéma de l’Université de Lausanne et doyen de la Faculté des lettres. Avec les contributions de Alain Corbellari, Jean-Paul Gabilliet , Gianni Haver, Désirée Lorenz , Michaël Meyer, Harry Morgan,Raphaël Œsterlé .Disponible à la commande sur le site de l’éditeur ainsi qu’en librairie.
Référence bibliographique : Marc Atallah et AlainBoillat, BD-US :Les comics vus par l’Europe , Infolio, 2016. EAN13 : 9782884748247. Marc Atallah et AlainBoillat, BD-US :Les comics vus par l’Europe Faisant suite au suite au colloque BD–US / La bande dessinée américaine vue par l’Europe. Réception et réappropriations qui s’était tenu à L’Université de Lausanne en 2014, cet ouvrage réunit des spécialistes de l’étude de la bande dessinée qui proposent une série d’éclairages sur la manière dont les pro- ductions culturelles européennes ont diffusé, exploité, reformulé ou détourné l’imaginaire et le langage des comics venus d’outre- Atlantique. L’approche se veut comparative, interculturelle et intermédiale : les chercheurs abordent autant Edgar P. Jacobs ou les récents albums de Serge Lehman que les séries TV de science- fiction britanniques ou les films d’Alain Resnais, et interroge la réception et les réappropriations de motifs et genres populaires situés au croisement d’influences et de références diverses. La production américaine est ainsi discutée dans toute sa richesse, des super-héros à l’underground, à travers des (re)lectures proposées en Europe. Les comics américains, qu’ils soient mainstream ou underground, influencent sans conteste la BD, la télévision et le cinéma européens, mais par le biais de réappropriations et de détournements analysés ici avec brio par des amoureux du «9 e art». Marc Atallah est directeur de la Maison d’Ailleurs et maître d’enseignement et de recherche à la section de français de l’Université de Lausanne. Alain Boillat est professeur ordinaire à la section d’histoire et esthétique du cinéma de l’Université de Lausanne et doyen de la Faculté des lettres. Avec les contributions de Alain Corbellari, Jean-Paul Gabilliet , Gianni Haver, Désirée Lorenz , Michaël Meyer, Harry Morgan,Raphaël Œsterlé .Disponible à la commande sur le site de l’éditeur ainsi qu’en librairie.
↧
France: "Après le désaveu des ComUE franciliennes" -groupe Jean-Pierre Vernant (19 mai 2016)
"Après le désaveu des ComUE franciliennes" Groupe Jean-Pierre Vernant (19 mai 2016) Les résultats de l’évaluation des Idex de la première vague ont récemment été rendus publics. Ils constituent des preuves irréfutables, visibles par tous, de l’échec de la partition du réseau universitaire francilien en ComUE, et de l’échec de la forme fédérale d’organisation universitaire. Nous rappelons ici l’urgence à ce que l’organisation territoriale francilienne soit enfin pensée en fonction des besoins de l’enseignement et de la recherche, au plus près du terrain, et la nécessité de mettre en place un réseau confédéral d’universités à taille humaine, adapté du modèle britannique aux spécificités françaises. Le Premier ministre a décidé de ne confirmer aucun des Idex franciliens, en s’appuyant sur les conclusions d’un « jury d’experts » [1] dont le mode de constitution et la démission fracassante ses deux membres les plus connus (M. Gillet et M. Aghion) [2], suffisent à montrer qu’il n’a rien d’indépendant [3]. Cette décision vient sanctionner le découpage aberrant du maillage universitaire francilien en plusieurs ComUE, destinées dans la grande couronne à assurer sans moyens l’enseignement de masse et sur son axe central, à constituer, selon la nov’lang en vigueur, des « universités de recherche intégrées, visibles au plan international et reconnues comme telles ». Rappelons que l’Île-de-France est la plus grande région universitaire de France et d’Europe. Sur 1,6 % du territoire national, elle concentre plus d’un quart des étudiants, un tiers des universitaires et deux cinquièmes des laboratoires de recherche. Lire la suite .
↧
CA de Paris 1 du17 mai 2016,vote pour la présidence de l’université -Communiquédu collectif des doctorant.e.s mobilisé.e.s pour l’université
Communiqué prononcé et diffusé lors du dernier CA de Paris 1 du17 mai 2016, à l’occasion du vote pour la présidence de l’université Collectif des doctorant.e.s mobilisé.e.s pour l’université En ce jour de CA entérinant l’élection d’un nouveau président pour l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, nous, doctorant.e.s mobilisé.e.s dénonçons fermement les fonctionnements anti-démocratiques qui y ont cours depuis trop longtemps. Nous nous opposons à un système non représentatif dans lequel un petit groupe de mandarins dirige l’université sans tenir compte des travailleurs qui la font vivre au quotidien. Depuis une dizaine d’années, des conditions de travail et d’emploi inacceptables nous sont imposées sans que notre avis soit écouté : à plusieurs reprises les personnels de l’université aussi bien que les doctorant.e.s se sont mobilisé.e.s, sans suite, pour revendiquer de meilleures conditions de travail et d’étude. Bien au contraire les directions successives n’ont fait qu’organiser une précarité structurelle, étouffant tout dialogue social – d’autant plus depuis l’intégration d’acteurs extérieurs à l’université dans les instances de décision. Nous ne tolérons plus cette situation ni les abus qu’elle permet. Notre mobilisation, qui réunit des doctorant.e.s de tous statuts et de toutes disciplines, s’inscrit dans un mouvement national de contestation des précaires de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Elle se structure depuis un an et a permis enfin la représentation des doctorant.e.s au sein de tous les collèges des conseils centraux. Malgré nos revendications, nos actions répétées et notre visibilité accrue, nous n’avons essuyé que le mépris des instances dirigeantes. Lire la suite .
↧
Figures de l’étudiant de l’Antiquité au XXI e siècle. Entre communauté et marginalité
Figures de l’étudiant de l’Antiquité au XXI e siècle. Entre communauté et marginalité Colloque IDENSO, Université de Bretagne-Sud 1er et 2 décembre 2016 à l’UBS (Lorient) Dans le sillage des récents et importants travaux de Jacques Verger [1] sur la mobilité étudiante au Moyen Âge, nous souhaiterions proposer une vaste réflexion au croisement des disciplines sur la figure de l’étudiant de l’Antiquité au XXI e siècle. Population née de migrations inter et intra nationales, de brassages et de recompositions, les étudiants constituent au fil des siècles des communautés spécifiques, parfois en marge de la société, parfois au cœur des changements sociologiques ou de l’action politique comme en atteste par exemple la fondation, en 1935, de la revue L’Étudiant noir par Aimé Césaire permettant l’émergence du mouvement littéraire et politique de la Négritude. Dans la littérature, de Villon à Jules Vallès, en passant par Hugo ou Flaubert, l’étudiant constitue un type, traité au travers de diverses approches, figure de l’exclusion ou de l’intégration – balancement mis en question dès l’ Institution oratoire de Quintilien –, du changement ou de la reproduction sociale. Personnages privilégiés du roman de formation, les étudiants sont des êtres en devenir formant une communauté forcément mouvante, aux frontières floues. Cette enquête croisera avec profit des approches variées, historiques, géographiques, juridiques, sociologiques, rhétoriques, littéraires, médicales notamment et s’ouvrira à l’Europe et ailleurs. Ce projet s’articule avec les axes de recherche que privilégie le projet IDENSO, à savoir la question de la marginalité, de la communauté et des territoires. Nous souhaiterions également inviter des collègues extérieurs, spécialistes de l’histoire de l’université et des étudiants. Enfin, nous voudrions clôturer ce colloque par la représentation théâtrale du Testament de François Villon interprété par Michel Arbatz. Si ces axes d’études - qui ne sont pas restrictifs - vous intéressent, veuillez nous faire parvenir une proposition de communication pour le 15 juin au plus tard. Pour les inscriptions, prière de nous contacter. Contacts: idurand@univ-ubs.fr ; patricia.victorin@univ-ubs.fr ; marie.bulte@univ-ubs.fr Isabelle Durand (Pr Littérature comparée, HCTI); Patricia Victorin (Pr Littérature médiévale, HCTI); Marie Bulté (ATER en littérature française, HCTI) [1] Référence électronique
: Jacques Verger, « La circulation des étudiants dans l'Europe médiévale », Les Cahiers du Centre de Recherches Historiques [En ligne], 42 | 2008, mis en ligne le 20 octobre 2011, URL : http:// ccrh.revues.org/3429 . Autres repères bibliographiques: Pierre MOULINIER, La Naissance de l’étudiant moderne (XIXe siècle)., Paris, Belin, 2002; Didier FISCHER, L’Histoire des étudiants en France, de 1945 à nos jours, Paris, Flammarion, 2000. Louis Gruel, Olivier Galland et Guillaume Houzel (dir.), Les étudiants en France. Histoire et sociologie d'une nouvelle jeunesse , Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2009.
↧
↧
L'intermédialité duXIX e siècleauXXI es. (Paris Sorbonne)
Dernière séance du séminaire du LAM : Lors de la dernière séance du séminaire de doctorants de l'axe de recherche "Littérature, arts, médiums", nous entendrons deux communications, l'une portant sur le XIX e, l'autre sur le roman contemporain : Nadia Fartas , qui a récemment soutenu une thèse de doctorat sur l'articulation des notions de modernité et de simplicité dans la littérature et les arts visuels dans le secondXIX esiècle sous la direction d'Yves Hersant et de Bernard Vouilloux, présentera une communication intitulée "Fondre les polarités. Nuances, mélanges et variations dans la littérature et les arts visuels dans le second XIX esiècle". Mathilde Savard-Corbeil , en thèse à l'université de Toronto sous la direction de Pascal Riendeau sur la présence d'œuvres d'art fictives dans le roman contemporain, présentera une communication intitulée "La pensée intermédiale contemporaine comme héritage duchampien : enjeux esthétique et ontologique des écrits". La séance sera aussi l'occasion de présenter la suite du séminaire.
↧
Lecteur de Langue française (Abu Dhabi Sorbonne)
Lecteur de Langue française à la Sorbonne - Abu Dhabi Les enseignants devront : - Proposer une formation en Langue française du niveau A1 aux niveaux B2 et C1 (du CECR) - Évaluer le niveau de français des candidats à une inscription en FLE s’ils ont déjà fait du français (test de placement) - Offrir des cours de soutien linguistique aux étudiants inscrits en Licence et en Master - Offrir des cours de langue française aux employés de l’Université - Promouvoir la francophonie et l’Université au sein du pays d’accueil - Participer aux manifestations culturelles organisées par l’Université ou à l’Université et promouvoir le département dans ses activités - S’investir dans les opérations de recrutement, à l’Université et au-dehors (Open Day, salons et visites d’établissements) - Aider à l’orientation des étudiants dans les filières de Licence. Il est également de leur responsabilité de : - Préparer les cours en fonction du programme établi, du niveau des étudiants et du calendrier du département - Enseigner et évaluer en contrôle continu - Participer aux surveillances, corrections et réunions de validation des examens - Participer aux surveillances des examens de Licence et de Master - Recevoir les étudiants et leur famille - Participer aux réunions hebdomadaires du département et aux formations proposées - Participer, de manière générale, aux missions qui leur seront confiées par l’établissement Paris-Sorbonne Abou Dhabi -Travailler dans le cadre pédagogique prescrit par le responsable du Département de FLE, et sous l’autorité administrative du Vice Chancelier adjoint aux affaires académiques de l’UPSAD Le lecteur assurera 18 heures d’enseignement par semaine et 2 heures de réception des étudiants par jour (ou 40 heures par mois). Les vacances sont déterminées par la direction de l’UPSAD. Entre la fin des cours et le début des vacances, les enseignants doivent veiller aux préparations pédagogiques et peuvent être requis pour aider au recrutement et aux admissions. Diplômes requis :Une qualification récente en FLE (minimum master 2) est impérative. On attend une parfaite maîtrise de la langue et de la grammaire françaises, ainsi qu'une excellente connaissance de la civilisation française et de son système universitaire. La maîtrise du CECR est également requise. Une habilitation à faire passer les examens du CIEP (DELF et TCF) est souhaitée. - Expérience minimale : Une expérience minimale de 3 années d’enseignement de FLE (expérience d’enseignement en université, en Alliance française ou dans l’enseignement secondaire) est obligatoire. Une expérience d’enseignement du français dans le Monde arabe sera appréciée. -Compétences : - Connaissances informatiques et maîtrise des outils bureautiques (ICDL souhaité) - Dynamisme, innovation, goût pour le travail en équipe, capacité d’adaptation aux cultures étrangères, sens de la communication et forte motivation - Anglais (lu, parlé, écrit) indispensable - Une connaissance, même rudimentaire, de la langue arabe, constitue un élément supplémentaire d’appréciation. - Poste à pourvoir pour la rentrée académique 2016-2017 (septembre 2016) - Les candidats retenus seront auditionnés à Paris ou à Abu Dhabi, par vidéo conférence ou par entretien direct. - Un test de langue française sera éventuellement organisé pour les candidats retenus. date limite : 5 juin 2016
↧
B. Delignon, N. Le Meur, O. Thévenaz (éd.), La poésie lyrique dans la cité antique. Les Odes d'Horace au miroir de la lyrique grecque archaïque.
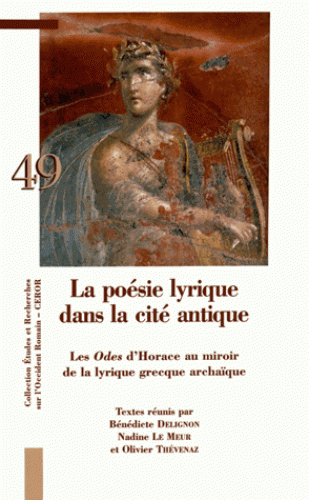 Bénédicte Delignon, Nadine Le Meur, Olivier Thévenaz (éd.), La poésie lyrique dans la cité antique. Les Odes d'Horace au miroir de la lyrique grecque archaïque, De Boccard, Collection du CEROR, Lyon, 2016. EAN13 :9782364420588 Prix : 36€ Présentation de l'ouvrage La cité est le contexte premier dans lequel il convient de situer la lyrique antique. En Grèce archaïque, les fonctions civiques des formes lyriques sont multiples. Dans la Rome augustéenne, le rôle politique de la poésie est également crucial et culmine lors des Jeux séculaires de 17 avant notre ère, pour lesquels Horace obtient la charge de composer un chant choral. Attentif aux spécificités de chaque discours poétique, ainsi qu’à la diversité des cultures et des cités qui les voient naître, le présent ouvrage approfondit et affine notre perception des enjeux civiques et politiques de la lyrique. Il se focalise sur la façon dont Horace, dans les Épodes et les Odes , assume et réoriente l’héritage archaïque pour recréer une partie de ses formes dans le contexte augustéen et devenir la voix d’une Rome refondée. Ce volume est issu du colloque inaugural d’un partenariat sur la lyrique antique qui associe l’École Normale Supérieure de Lyon, l’UMR 5189 HiSoMA et l’Université de Lausanne, avec le soutien de la Région Rhône-Alpes. Ce partenariat se propose de repenser les rapports entre la lyrique grecque et ses prolongements latins à la lumière des avancées récentes de la recherche, en instaurant un véritable échange de savoirs entre latinistes et hellénistes, qui permette l’éclairage réciproque de deux champs trop souvent étudiés séparément. Sommaire Introduction 1ère partie : La lyrique dans son contexte social et politique. Antonio Aloni - Kômos et cité. Stefano Caciagli -Lesbos et Athènes entre polis et oikia. Virginie Hollard -La fonction politique du poète dans la cité à l'époque d'Auguste : l'exemple d'Horace ( Odes et carmen saeculare) Hans-Christian Günther -Horace : poetry and politics. Michèle Lowrie -Le salut, la sécurité et le corps du chef : transformations dans la sphère publique à l'époque d'Horace. 2ème partie : Nouveaux contextes et création poétique Stephen J. Harrison - Horace Odes 2.7 : Greek models and Roman civil war. Olivier Thévenaz - Actium aux confins de l'iambe et de la lyrique. Lucia Athanassaki - Pindarum quisque studet aemulari : Greek and Roman civic performance contexts (Pindar's Fourth and Fifth Pythians and Horace's Odes 4.2) 3ème partie : Conditions d'énonciation et ancrage civique de la lyrique Nadine Le Meur - Prier pour la cité : présence de la communauté civique dans les Péans de Pindare. Chris Carey - Negociating the public voice. Michel Briand - Entre spectacle et texte : contextes, instances et procédures pragmatiques chez Pindare et Horace. Jean Yvonneau - Une présence inexpliquable : la déesse Létô chez Timocréon (fr. 727.4 Page) 4ème partie : Horace, la lyrique civique et l'innovation poétique Mario Citroni - Cicéron, Horace et la légitimation de la lyrique comme poésie civique. Grégory Bouchaud - Pouvoir et impuissance poétiques : éléments de comparaison entre Pindare et Horace. Bénédicte Delignon - Lyrique érotique et lyrique politique dans l' Ode 4.1 d'Horace. Gregson Davis - Festo quid potius die : locus of performance and lyric program in Horace, Odes 3.28. Jenny Strauss Clay - Horace et le frère cadet d'Apollon. Denis C. Feeney - Horace and the literature of the past : lyric, epic, and history in Odes 4. Références bibliographiques Index locorum.
Bénédicte Delignon, Nadine Le Meur, Olivier Thévenaz (éd.), La poésie lyrique dans la cité antique. Les Odes d'Horace au miroir de la lyrique grecque archaïque, De Boccard, Collection du CEROR, Lyon, 2016. EAN13 :9782364420588 Prix : 36€ Présentation de l'ouvrage La cité est le contexte premier dans lequel il convient de situer la lyrique antique. En Grèce archaïque, les fonctions civiques des formes lyriques sont multiples. Dans la Rome augustéenne, le rôle politique de la poésie est également crucial et culmine lors des Jeux séculaires de 17 avant notre ère, pour lesquels Horace obtient la charge de composer un chant choral. Attentif aux spécificités de chaque discours poétique, ainsi qu’à la diversité des cultures et des cités qui les voient naître, le présent ouvrage approfondit et affine notre perception des enjeux civiques et politiques de la lyrique. Il se focalise sur la façon dont Horace, dans les Épodes et les Odes , assume et réoriente l’héritage archaïque pour recréer une partie de ses formes dans le contexte augustéen et devenir la voix d’une Rome refondée. Ce volume est issu du colloque inaugural d’un partenariat sur la lyrique antique qui associe l’École Normale Supérieure de Lyon, l’UMR 5189 HiSoMA et l’Université de Lausanne, avec le soutien de la Région Rhône-Alpes. Ce partenariat se propose de repenser les rapports entre la lyrique grecque et ses prolongements latins à la lumière des avancées récentes de la recherche, en instaurant un véritable échange de savoirs entre latinistes et hellénistes, qui permette l’éclairage réciproque de deux champs trop souvent étudiés séparément. Sommaire Introduction 1ère partie : La lyrique dans son contexte social et politique. Antonio Aloni - Kômos et cité. Stefano Caciagli -Lesbos et Athènes entre polis et oikia. Virginie Hollard -La fonction politique du poète dans la cité à l'époque d'Auguste : l'exemple d'Horace ( Odes et carmen saeculare) Hans-Christian Günther -Horace : poetry and politics. Michèle Lowrie -Le salut, la sécurité et le corps du chef : transformations dans la sphère publique à l'époque d'Horace. 2ème partie : Nouveaux contextes et création poétique Stephen J. Harrison - Horace Odes 2.7 : Greek models and Roman civil war. Olivier Thévenaz - Actium aux confins de l'iambe et de la lyrique. Lucia Athanassaki - Pindarum quisque studet aemulari : Greek and Roman civic performance contexts (Pindar's Fourth and Fifth Pythians and Horace's Odes 4.2) 3ème partie : Conditions d'énonciation et ancrage civique de la lyrique Nadine Le Meur - Prier pour la cité : présence de la communauté civique dans les Péans de Pindare. Chris Carey - Negociating the public voice. Michel Briand - Entre spectacle et texte : contextes, instances et procédures pragmatiques chez Pindare et Horace. Jean Yvonneau - Une présence inexpliquable : la déesse Létô chez Timocréon (fr. 727.4 Page) 4ème partie : Horace, la lyrique civique et l'innovation poétique Mario Citroni - Cicéron, Horace et la légitimation de la lyrique comme poésie civique. Grégory Bouchaud - Pouvoir et impuissance poétiques : éléments de comparaison entre Pindare et Horace. Bénédicte Delignon - Lyrique érotique et lyrique politique dans l' Ode 4.1 d'Horace. Gregson Davis - Festo quid potius die : locus of performance and lyric program in Horace, Odes 3.28. Jenny Strauss Clay - Horace et le frère cadet d'Apollon. Denis C. Feeney - Horace and the literature of the past : lyric, epic, and history in Odes 4. Références bibliographiques Index locorum.
↧
Adeffi2016 – XVIIIème colloque annuel
Association des Études Françaises et Francophones d’Irlande (ADEFFI) XVIIIème colloque annuel University College Cork, Irlande (14-15-16 octobre 2016) -OBÉISSANCE - Ce congrès généraliste accueille la recherche de toutes les approches et portant sur tous les contextes historiques dans les domaines de la société et de la culture françaises et francophones. Pour son XVIIIème colloque, l’ADEFFI a retenule thème,'Obéissance'. Notre invité d’honneur sera cette année M. Yves Ansel, professeur de Littérature française des XIXe et XXe siècles à l’Université de Nantes Les pistes de réflexion ci-dessous sont données à titre indicatif: Maîtres et serviteurs Autorité et citoyenneté Travail-Famille-Patrie Relations parents-enfants Esclavage, servage, liberté Soumission, insoumission Déférence, vénération, respect Moquerie, mépris, blasphème Religions, laïcité Révolte, révolution, soulèvement, désobéissance Contraintes, obligations, responsabilité Habitus, habitudes, coutumes Autorité, auteur Jugement, justice Droit, lois, législation, règles, normes Les propositions de communication, rédigées en français ou en anglais sous la forme d’un résumé de 300 mots maximum (format MS Word), doivent être envoyées par courriel à adeffi.conference@yahoo.ie avant le 15 juin 2016 .
↧
↧
Voix plurielles , n°13
Référence bibliographique : Voix plurielles , revue de l'Association des Professeur-e-s de français des Universités et Collèges canadiens (APFUCC), Association des Professeur-e-s de français des Universités et Collèges canadiens (APFUCC), 2016. EAN13 : 19250614. Le numéro 13.1 (2016) de Voix plurielles , journal de l'Association des Professeur-e-s de français des Universités et Collèges canadiens (APFUCC), est à présent en ligne : https://brock.scholarsportal.info/journals/voixplurielles Voix plurielles publie des articles, des textes de création, des dossiers thématiques et des comptes-rendus de nature littéraire, linguistique, culturelle et/ou pédagogique. La langue est le français. Voix plurielles – SOMMAIRE 13.1 (2016) 1 – Editorial Articles 2-12 – Julien Defraeye. «Paris dans l’optique: cadre photographique et cadre littéraire chez Philippe Delerm» 13-30 – Maya Semaan. «En eaux troubles: la relation mère-fille dans l’œuvre d’Irène Némirovsky» 31-42 – Rozita Ilani. «Carrefour de l’apprentissage des langues: le persan, l’anglais et le français» Prix de la meilleure communication d’étudiante (APFUCC) 43-53 – Thaïs Bihour. «La chair ingénue: manipuler l’enfant et son image durant la Grande Guerre. L’exemple particulier des atrocités allemandes en France» Dossier – La créativité: enjeux théoriques, disciplinaires et interdisciplinaires (Dir. Isabelle Capron Puozzo) 54-53 – Isabelle Capron Puozzo. «Introduction» 57-75 – Enrica Piccardo. «La diversité culturelle et linguistique comme ressource à la créativité» 76-85 – Marie Potapushkina-Delfosse. «La créativité gestuelle et linguistique des élèves débutant l’apprentissage de l’anglais à l’école primaire» 86-100 – Adriana Teresa Damascelli et Marie-Berthe Vittoz. «Être créatif avec les technologies: enseigner le français de spécialité au niveau Master dans les cours de langues étrangères à l’Université de Turin (UniTO)» 101-112 – John Didier et Florence Quinche. «Concevoir des robots pour développer la créativité des élèves ?» 113-124 – Aude Ramseier et Sabine Oppliger. «Apprendre et pratiquer sa créativité: des dispositifs en actes inspirés de la démarche des arbres de connaissances» 125-137 – Rémi Deslyper. «La créativité développée par la forme scolaire: l’exemple des élèves guitaristes des écoles de ‘musiques actuelles’» 138-146 – Sébastien Charbonnier. «La créativitépeut-elle devenir un paradigme pédagogique émancipateur?» Création 147-160 – Millet, Jacques. «Au bout du grand fleuve… La balade danubienne (extraits)» Comptes rendus 161 – Fournier, Isabelle. «Lepage, Élise. Géographie des confins. Espaces et écriture chez Pierre Morency, Pierre Nepveu et Louis Hamelin » 162-163 – Rue, Emilienne. «Forrest-Wilson, Anne, dir. Sur les traces de Champlain. Un voyage extraordinaire en 24 tableaux » 164-165 – Parayre, Catherine. «Savoie, Paul. L’heure ovée » 166-167 – Parayre, Catherine. «Charlebois, Eric. Ailes de taule » 168-169 – Parayre, Catherine. «Dugas, Daniel H. L’esprit du temps / The Spirit of Time » 170-171 – Fournier, Isabelle. «Mazhig, Monia. Du pain et du jasmin » 172-172 – Camara, El hadji. «Ndala, Blaise. J’irai danser sur la tombe de Senghor » 174-175 – Camara, El hadji. «Leclair, Didier. Pour l’amour de Dimitri » 176-177 – Savoie, Paul. «Baril Pelletier, François. Déserts bleus » 178-179 – Savoie, Paul. «Lacelle, Andrée. Sol Ciel Ciels Sols » 180-181 – Jamme, Eric. «Doom, Alain. Un neurinome sur une balançoire » 182-183 – Falq, Armand. «Levesque, G. Je ne le répéterai pas » 184-185 – Falq, Armand. «Huard, Julie. Paysâmes et miroirs du monde » 186 – Jamme, Eric. «Côté Legault, Antoine. Corps à corps. Une blind date poétique » 187-188 – Rue, Emilienne. «Le Bouthillier, Claude. Tuer la lumière »
↧
Littérature et cosmopolitisme: q uels enjeux politiques et sociaux (XVIIIe-XXIe siècles)?
Littérature et cosmopolitisme: q uels enjeux politiques et sociaux (XVIIIe-XXIe siècles)? Programme du colloque Jeudi 26 mai Salle Dussane 9h00-10h00: Introduction , par Guillaume BRIDET (Université de Bourgogne, EA CPTC), Xavier GARNIER (Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, UMR THALIM), Sarga MOUSSA (CNRS, UMR THALIM) et Laetitia ZECCHINI (CNRS, UMR THALIM) 10h00-12h00 Voyageurs et vagabonds 10h00-10h30: Aurélie CHONÉ (Université de Strasbourg) Les lieux de l’Inde cosmopolite: expériences et regards des voyageurs germanophones (1880-1930) 10h30-11h00 : Roger MARMUS (Université Paris-Sorbonne) L’engagement vagabond. Lecture critique du récit de voyage Vagabondliv i Frankrike (Vie vagabonde en France , 1927) de l’écrivain prolétarien suédois Ivar Lo-Johansson 11h00-11h30: Vanezia PARLEA (Université de Bucarest, Roumanie) Isabelle Eberhardt: une poétique de la marginalité ou «l’art de porter les haillons» 11h30-12h00: Discussion 13h30-14h45 Figures autodidactes 13h30-14h00: Emmanuel LOZERAND (INALCO, Paris) Les contrebandiers du zen. 14h00-14h30: Hans -Jürgen LÜSEBRINK (Université de la Sarre, Saarbrücken, Allemagne) Cosmopolitisme subalterne et autodidaxie, Configurations européennes etconstellations (post-)coloniales (18 e-20 e siècles) 14h30-14h45: Discussion 14h45-15h00: Pause 15h00-17h00 Parcours interlopes 15h00-15h30: Laetitia TORDJMAN (Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3) Cosmopolitisme et imaginaire national : écarts, décalages, dans Banjo de Claude McKay et Les Contrebandiers d’Oser Warszawski. 15h30-16h00: Frederica ZEPHIR (Université de Nice) «Le vagabond du monde» ou le cosmopolitisme de Panaït Istrati 16h00-16h30: Jean Christophe IPPOLITO ( Institut Technologique de Géorgie, Atlanta, États-Unis) La Québécoite : faillite des paradigmes identitaires et intégrationnistes, cosmopolitisme du futur 16h30-17h00: Discussion Vendredi 27 mai Salle W 9h00-12h00 Sujets politiques en émergence 9h00-9h30: Tayeb BOUDERBALA (Université de Batna, Algérie) Emergence d’un nouveau cosmopolitisme. L‘exemple du roman Un passager de l’Occident de Nabile Farès 9h30-10h00 : Aïcha AKNAZZAY (Université de Cergy-Pontoise) Roberto Bolaño et Abdelkébir Khatibi: deux cosmopolites provinciaux? 10h00-10h15: Discussion 10h15-10h30: Pause 10h30-11h00: Markus MESSLING (Centre Marc Bloch, Berlin, Allemagne) Pertes et transgressions. La figure du réfugié : réalisme esthétique et cosmopolitisme littéraire 11h00-11h30: Aline BERGÉ (Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3) De la pratique littéraire au geste politique (1945-2015): Passages de relais pour un monde commun 11h30-12h00: Discussion 13h30-16h30 L’édition: circulation et décentrement 13h30-14h00: Alexis BUFFET (Université Lumière-Lyon 2) Théorie et pratique d’un cosmopolitisme populaire militant: l’exemple de Léon Bazalgette 14h00-14h30: Mar GARCIA (Université Autonome de Barcelone, Epsagne) Infrapolitismes: cosmopolitismes d’en bas dans les littératures hispanoafricaines 14h30-15h00: Aurélie JOURNO (Université Rennes 2) La revue littéraire comme passeur culturel : l'exemple de Kwani?, revue littéraire kényane 15h00-15h30: Discussion 15h30-15h45: Pause 15h45-16h30: Débat et conclusions
↧
Parcours en regard: Passeurs, alliés et transfuges à l’époque coloniale (Dijon)
Congrès international de la SIELEC Parcours en regard: Passeurs, alliés et transfuges à l’époque coloniale Programme des journées Jeudi 9 juin 2016 Amphithéâtre de la MSH Ouverture du colloque 9.30: Accueil, par Samir BAJRIC (Université Bourgogne-Franche-Comté / directeur-adjoint de l’équipe CPTC) 9.45: Introduction, par Guillaume BRIDET (Université Bourgogne-Franche-Comté / organisateur du colloque) Session 1: Réflexions critiques sur la colonisation 10.00: Yvan DANIEL (Université de La Rochelle) Judith Gautier et Albert Puyou de Pouvourville devant la conquête de l’Indochine 10.30: Pierre LIGUORI (EHESS) Wilfrid Scawen Blunt, des voyages dans l’Orient arabe à l’engagement pour la liberté de l’Égypte 11.00: Virginie BRINKER (Université Bourgogne-Franche-Comté) Thomas O’Reilly par la romancière Élise de Fontenaille: une figure rédemptrice? 11.30: Daniel LANÇON ( Université Grenoble-Alpes) Fernand Leprette: un Français au service de l’Égypte sous tutelle anglaise, 1919-1956 12.00: Assani ADJAGBÉ (Université Paris 1 / Université Félix Houphouët Boigny, Côte d'Ivoire) Félix Houphouët-Boigny: itinéraire d’un opposant devenu «chantre» de la présence française en Afrique 12.30: Discussion Déjeuner Session 2: Des ennemis de l’intérieur? 14.30: Neelam PIRBHAI-JETHA (Université des Mascareignes, Île Maurice) Étude du pro-colonialisme à l’île Maurice: figure du traître ou du complexe du colonisé? 15.00: Vicram RAMHARAI (Mauritius Institute of Education) Passeur ou transfuge dans le récit colonial et postcolonial mauricien 15.30: Guillaume BRIDET (Université Bourgogne-Franche-Comté) Daniel Guérin: homosexualité et littérature, anticolonialisme et action militante 16.00: Anne MATHIEU (Université de Lorraine-Nancy, Directrice de la revue Aden )Magdeleine Paz, actrice de la fraternité entre colonisés et métropolitains 16.30: Henri GARRIC (Université Bourgogne-Franche-Comté) Figures d’apostats dans Juan sans terre (1975) de Juan Goytisolo 17.00: Discussion Vendredi 10 juin 2016 Amphithéâtre de la MSH Session 3: Métissage: passeurs/ transfuges de cultures 9.30: Corinne FLICKER (Université Aix-Marseille) Un passeur en Indochine: Claude Bourrin, une vie de théâtre (1898-1952) 10.00: Antoine MUIKILU NDAYE (Institut National des Arts de Kinshasa, RDC) Aux sources de la dramaturgie en République Démocratique du Congo. Décryptage d’un métissage culturel en gestation 10.30: Jean ARROUYE (Université Aix-Marseille) Une tentative exceptionnelle de contribuer à l’intercompréhension culturelle : Sahara, Un homme sans l’Occident de Diego Brosset 11.00: Foteini THOMA (Université Montpellier 3) Les figures du passeur et du transfuge dans les Éthiopiques de Léopold Sédar Senghor : pour une approche romantique du monde 11.30: Discussion Déjeuner Session 4: Question religieuse: (se) convertir ou pas? 13.30: Ibrahim YAHAYA (Université Abdou Moumouni, Niger) La décivilisation d’Auguste Victor Dupuis 14.00: Maeva BOVIO ( Université Grenoble-Alpes) Laurent Depui / Chérif Ibrahim, le Lawrence d ’ Arabie français 14.30: Jacques POIRIER (Université Bourgogne-Franche-Comté) Abdou’l-Karim Jossot: anarchiste, soufi et renégat 15.00: Discussion Pause Session 5: Du côté des hommes de savoir 16.00: Jean-François DURAND (Université Montpellier 3) André Chevrillon au cœur des Empires: l’Exote et le colonial 16.30: Georges A. BERTRAND (Chercheur indépendant) Jean Ballard et les Cahiers du Sud: le rêve d’une nouvelle Andalousie 17.00: Marc KOBER (Université Paris 13) Jacques Berque (1910-1995): un homme entre deux rives 17.30: Éléonore DEVEVEY (ENS de Lyon) «Une sorte de contrat d’existence»: Georges Balandier pré-postcolonial 18.00: Discussion Samedi 11 juin 2016 Salle du conseil de Droit Session 6: Gros plan sur l’Algérie 9.30: Michèle SELLÈS-LEFRANC (EHESS) Passeurs de savoirs autochtones sur la Kabylie dans l’Algérie coloniale : modèles et affects, enquêtes et écritures 10.00: Abdelmalik ATAMENA (Université de Khenchela, Algérie) Le blé, la bible et le sang ou proximité et lien dans les Aurès pendant l’époque coloniale 10.30: Laure DEMOUGIN (Université Montpellier 3/Université Laval, Québec) La construction de la figure de l’interprète dans les premiers temps de la conquête en Algérie: autour d’Eusèbe de Salle 11.00: Sarga MOUSSA (CNRS-Thalim) Bouvier en Algérie (1950) 11.30: Roland ROUDIL (SIELEC) Heurts et malheurs du métissage culturel dans les Carnets d’Orient de Jacques Ferrandez (Casterman, 2008-2011) 12.00: Discussion Déjeuner Session 7: Parcours impériaux 14.00: Fanny ROBLES (Université Toulouse 2) Extraction, acculturation et retour du «sauvage» (XVII e-XIX e siècle) : résistances, influences, destins croisés 14.30: Hervé CASINI (Université Aix-Marseille) De la figure du soldat de la «Conquête» à celle de l'administrateur amoureux de l'Annam : le cas Jules Boissière 15.00: Gilbert SOUBIGOU (Chercheur indépendant) Les Aventuriers-rois, ces Décivilisés 15.30: Jean Bernard EVOUNG FOUDA (Université de Yaoundé I, Cameroun) Le Sauvage blanc de François Garde ou le rêve brisé de l’entreprise coloniale en Asie 16.00: Discussion
↧
Poste d’assistant/e-doctorant/e en littérature et culture française (Europa-Universität Flensburg, Allemagne)
Am Romanischen Seminar der Europa-Universität Flensburg ist im Bereich Französische Literatur- und Kulturwissenschaft zum 1. Oktober 2016 eine Stelle einer/eines wissenschaftlichen Mitarbeiterin/Mitarbeiters (Entgeltgruppe 13 TV-L, 50%) zur Weiterqualifikation (Promotion) zunächst befristet für die Dauer von 3 Jahren zu besetzen. Es besteht die Möglichkeit einer Verlängerung. Mit der Stelle ist ein Lehrdeputat von 2 SWS verbunden. Aufgabengebiet:Weiterqualifizierung (Promotion) im Bereich der französischsprachigen Literatur- und Kulturwissenschaft.Lehrtätigkeit im Bachelorstudiengang „Bildungswissenschaften“ im Teilbereich Französische Literatur- und Kulturwissenschaft und ggf. Didaktik.Unterstützung in der Ausarbeitung und Durchführung von Forschungsprojekten sowie beim Aufbau des Teilstudiengangs Französisch.Erwartet wird zudem die Mitwirkung an Prüfungen innerhalb des Seminars. Einstellungsvoraussetzungen:Abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium (Magister, Master, I. Staatsexamen oder vergleichbarer ausländischer Abschluss) im Fach Französisch, in Romanistik oder Komparatistik (mit französischsprachigem Profil).Überdurchschnittlich benotete Abschlussarbeit mit thematischer Anschlussfähigkeit an das Forschungs- bzw. Studienprofil der Abteilung Französisch des Romanischen Seminars.Promotionsabsicht zu einem literatur- bzw. kulturwissenschaftlichen Thema aus dem französischsprachigen Kontext seit dem 19. Jahrhundert.Sehr gutes Französisch in Wort und Schrift.Nach Möglichkeit erste universitäre Lehrerfahrungen. Die Europa-Universität Flensburg möchte in ihren Beschäftigungsverhältnissen die Vielfalt der Biographien und Kompetenzen fördern. Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich Menschen mit Migrationshintergrund bei uns bewerben. Personen mit einer Schwerbehinderung werden bei entsprechender Eignung vorrangig berücksichtigt. Die Europa-Universität Flensburg strebt in allen Beschäftigtengruppen eine ausgewogene Geschlechterrelation an. Für Fachauskünfte zur Stelle wenden Sie sich bitte an Frau Prof. Dr. Brink, E-Mail: margot.brink@uni-flensburg.de. Allgemeine Auskünfte erteilt Frau Katzka, Telefon 0461/805-2824, E-Mail: katharina.katzka@uni-flensburg.de. Sind Sie interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre schriftliche Bewerbung ( candidatures en français ou allemand ). Bitte richten Sie Ihre aussagekräftigen Unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse, Inhaltsverzeichnis der Abschlussarbeit, ein exemplarisches Kapitel aus der Abschlussarbeit im Umfang von 15-30 Seiten, ggf. Exposé der geplanten Dissertation) bis zum 15.06.2016 (Eingangsdatum) an das Präsidium der Europa-Universität Flensburg, z. H. Frau Katzka, persönlich/ vertraulich, Kennziffer 321637 , Postfach 29 54, 24919 Flensburg. Auf die Vorlage von Lichtbildern/Bewerbungsfotos verzichten wir ausdrücklich und bitten daher, hiervon abzusehen.
↧
↧
Myriades , n°3,« Impact des courants linguistiques d’inspiration francophone dans la recherche contemporaine»
Appel à contribution pour le numéro 3de la revue en ligne Myriades. Revue d’Études Francophones, éditée par le Département d’Études Romanes (UMinho) http://cehum.ilch.uminho.pt/myriades Titre: Impact des courants linguistiques d’inspiration francophone dans la recherche contemporaine Coordonné par Maria Aldina Bessa Marques, Sílvia Araújo, Conceição Varela. Depuis la Grammaire générale et raisonnée , plus connue sous le nom de Grammaire de Port-Royal , qui résulte, en 1660, de la collaboration fructueuse du grammairien Claude Lancelot et du philosophe Antoine Arnauld, la France et d'autres pays francophones ont contribué de manière décisive à l'évolution de la recherche dans ce domaine. Impossible de penser à la linguistique moderne sans tenir compte de cet apport fondamental qui mobilise des noms tels que Gustave Guillaume, connu pour sa théorie originale de la langue (la «psychomécanique"), Ferdinand de Saussure, dont les réflexions théoriques ont indéniablement conduit à l’affirmation de la linguistique comme science autonome, André Martinet, qui, dans le sillage des travaux du Cercle Linguistique de Prague, a servi de base à la linguistique fonctionnelle européenne. Plus proche de nous, Émile Benveniste a conféré à la linguistique une toute autre ampleur en plaçant la question de l’énonciation au centre de l'activité du langage: bien plus que le retour de l'homme à la linguistique, l’oeuvre de ce linguiste a bel et et bien marqué le retour de l'homme aux théories linguistiques. Nous ne saurions manquer de mentionner d’autres linguistes comme Oswald Ducrot ou bien Jean-Claude Anscombre, responsable du développement de la Théorie de l'Argumentation dans la Langue (TAL) dont la polyphonie est la dimension centrale. N’oublions pas non plus Antoine Culioli dont la théorie des opérations énonciatives a su rompre aussi bien avec la tradition saussurienne qu'avec le modèle théorique Chomskyen. D'autres noms francophones s'imposent tout autant sur la scène de la recherche actuelle. Outre Michel Pêcheux, une référence incontournable pour l'analyse du discours française, il nous faut citer également Dominique Maingueneau, Patrick Charaudeau, Jacqueline Authier-Revuz, Jean-Michel Adam, Jean-Paul Bronckart, Christian Plantin et Catherine Kerbrat Orecchioni connue, entre autres, pour son travail sur l'énonciation, l'implicite et les interactions verbales orales. La rétrospective qui précède ne correspond, bien évidemment, qu’à un reflet partiel des courants et auteurs qui ont contribué, simultanément ou à tour de rôle, à la vitalité de la linguistique d’inspiration francophone dans le monde. Compte tenu de l'importance de l'impact de ces courants théoriques et de ces auteurs dans la recherche contemporaine en sciences du langage, le numéro 3 de la revue Myriades vous invite précisément à rendre compte de l'importance et des conséquences de ces mouvements francophones. Nous proposons deux lignes thématiques majeures pour orienter cet appel à contribution: 1. La réflexion théorique sur ces courants d'inspiration francophone; 2. L'application de ces théories/courants à l’analyse d’une ou plusieurs langues. Les articles inédits pourront être rédigés en français, en portugais, en anglais, en espagnol ou en italien. Les propositions d’articles complets (texte, mots clés, notes, bibliographie et informations relatives au contributeur: grade et institution) ne devront pas dépasser les 40 0000 signes et devront parvenir sous forme électronique aux éditeurs du numéro, à l’adresse suivante: myriades@ilch.uminho.pt Les articles proposés seront soumis à supervision scientifique ( peer review ). Normes de publication disponibles à http://cehum.ilch.uminho.pt/myriades#appel CALENDRIER Envoi de la proposition d’article complet : 15/09/2016 Réponse du comité scientifique : 15/11/2016 Envoi de l’article définitif : 31/12/2016 Publication en ligne : mars 2017
↧
Pratiques théâtrales et archives numérisées. Projet des Registres de la Comédie-Française (1680-1793)
Colloque Pratiques théâtrales et archives numérisées. Projet des Registres de la Comédie-Française (1680-1793) " / " Early Modern Theater Practices & the Digital Archive: The Comédie-Française Registers Project (1680-1793) Université Harvard et au Massachusetts Institute of Technology Du 19 au 21 mai 2016 Autour de la base de données développée dans le cadre du projet de numérisation des registres administratifs de la Comédie-Française entre 1680 et 1793 ( http://cfregisters.org ), ce colloque réunira 17 communications scientifiques en anglais et en français, une exposition du fonds français de la Harvard Theater Collection, la mise en scène de pièces du répertoire du XVIIIe siècle et un hack-a-thon consacré à l’exploration de nouveaux outils numériques. Organisateurs & Contacts: Sylvaine Guyot (guyot@fas.harvard.edu) Jeffrey Ravel (ravel@mit.edu) Programme complet disponible à l'adresse suivante: http://cfregisters.org/fr/
↧
Le portrait dans la littérature et les arts visuels(Maroc)
Le portrait dans la littérature et les arts visuels Résumé D’après certains spécialistes “ un portrait (serait) une œuvre picturale , sculpturale , photographique , ou littéraire représentant une personne réelle ou fictive, d'un point de vue physique ou psychologique (…) Au delà de la volonté de perpétuer le souvenir d’une personne et de vouloir créer une image historique du commanditaire, le portrait a souvent une fonction immédiate de représentativité”. Le portrait écrit et le portrait peint (dessiné, photographié, filmé, numérisé…) ont de nombreuses caractéristiques en commun. Que ce soit dans la littérature, le cinéma, la peinture, l’image de synthèse, la vidéo et la performance, le portrait se construit suivant les orientations idéologiques de son auteur. Il suggère formes et impressions tout en répondant à différentes techniques romanesques ou visuelles qui témoignent d’une émission (production) d’un discours sur soi, sur son intimité et sur son propre corps. Le regard sur l’autre est, également, très manifeste dans l’art du portrait en peinture ainsi que dans la description du personnage qui est une sorte de portrait romanesque. La représentation du corps est fondamentale dans ces différents genres artistiques et littéraires qui sont autant d’espaces de création où le portrait, qu’il soit physique, psychologique ou moral, se réfléchit, se redécouvre comme lieu de sensations et d’émotions et se reproduit dans les domaines de la fiction et de l’imagination à travers la littérature et les arts visuels. Thématique générale Evaluer la correspondance qui existe entre la littérature, les arts plastiques et le cinéma, en ce qui concerne la symbolique des portraits féminin et masculin dans des genres narratifs et esthétiques tels que la description romanesque du personnage, la caricature, l’art de la vidéo, la peinture et la sculpture. Considérer l’impact de la culture visuelle sur l’idéologie littéraire et l’interaction fortement présente entre la littérature et les arts, en général. Objectifs Etablir une démarche de rapprochement entre la notion du genre dans la peinture, les arts visuels (portrait et autoportrait) et les procédés narratifs de l’écriture littéraire (description du personnage, récit autobiographique) pour arriver à lire et à étudier les différentes modalités de la représentation de soi et de l’autre dans l’art et la littérature. Traiter le portrait numérisé, pictural et littéraire comme étant un objet/sujet de narration dans le but de comparer les techniques de l’«écriture artistique» et celles de l’écriture littéraire. Axes de réflexion :- Les grands portraits de la peinture universelle. - La représentation sociale du personnage féminin dans le cinéma - La représentation du corps dans la littérature et les arts. - Le portrait de la mère dans la littérature universelle (le récit de l’enfance) - Le portrait masculin dans l’écriture féminine. - L’image de la femme dans la littérature populaire. - Le portrait de la femme dans la publicité et la presse. - Les problématiques de la représentation du portrait dans le langage des nouvels arts médiatiques. - L’art de la caricature - L’autoportrait Soumission des propositions Les propositions de communications doivent se faire en document attaché Word ou RTF. Le document doit contenir un titre et un résumé (ne dépassant pas deux paragraphes) accompagnés des coordonnées et d’une brève biographie de l’auteur, et ce avant le 30 septembre 2016 . Elles sont à envoyer au professeur Fatima Ahnouch: f.ahnouch@uiz.ac.ma Langue de communication : français Comité d’organisation :Fatima Ahnouch Abdelfettah Nacer Idrissi Khadija Youssoufi Hassan Ennassiri Wafaa Aït KaïKaï Rabie Robae Fiche de participation Nom et prénom: Institution: Intitulé de la communication: Résumé de la communication: Notice bio-bibliographique:
↧