PLACES D'ÉTUDIANTS BOURSIERS EN MASTER FRANCO-ALLEMAND NANCY/AUGSBURG OFFRE DE BOURSES ET DE POSTES Master en Cultures de la communication européennes des Lumières jusqu’à l’ère contemporaine Le Master binational avec programme doctoral «Cultures de la communication européennes des Lumières jusqu’à l’ère contemporaine» s’adresse aux étudiants titulaires d’une Licence de lettres ou de sciences humaines, qui s’intéressent à l’Europe, à l’Allemagne, à l’époque des Lumières, au monde moderne, ainsi qu’aux cultures de la communication et à la recherche scientifique.
Le Master propose en plus une orientation ciblée vers les métiers qui demandent des études de lettres et de sciences humaines et éventuellement une thèse de doctorat, comme les métiers de la recherche et de l’enseignement universitaires, de l’édition, des institutions culturelles, du journalisme et de la documentation. Contenus •Étude de la circulation et de la transmission des valeurs de la culture européenne des Lumières à nos jours;
•Approche de la culture européenne de la modernité en s’appuyant sur les sources originales du siècle des Lumières pour arriver aux technologies de pointe;
•Acquisition de compétences interculturelles par la confrontation de deux cultures scientifiques et de leurs médias;
•Approfondissement des compétences linguistiques de la langue partenaire
•Orientation professionnelle dans les domaines de l’édition et de la documentation, dans le domaine des métiers artistiques et culturels et dans le domaine des relations publiques et des échanges internationaux. Déroulement
Master
1e année à Nancy en groupe franco-allemand
•60 points ECTS
•Perfectionnement dans la langue partenaire
•Cours et séminaires dans le domaine de la langue, de la littérature et de la civilisation françaises et germaniques
•Séminaires de méthodologie contrastive en tandem franco-allemand
•Cycles de conférences à orientation professionnelle
•Stage
2e année à Augsburg en groupe franco-allemand
•60 points ECTS
•Perfectionnement dans la langue partenaire
•Cours et séminaires dans le domaine de la langue, de la littérature et de la civilisation françaises et germaniques
•Enseignement interdisciplinaire
•Séminaires de méthodologie contrastive en tandem franco-allemand
•Mémoire de Master avec soutenance. Pendant l’année passée à Augsburg, les étudiants venant de Francetouchent, en plus des éventuelles bourses Erasmus et bourses sur critères sociaux, une bourse spécifique de l’Université franco-allemande, d’un montant minimum de 270 euros par mois.
Diplôme délivré
•Double diplôme: Master Lettres, Arts et Culture, Mention: Master franco-allemand Cultures européennes de la communication / Master of Arts Deutsch-französischer Master Europäische Kommunikationskulturen Débouchés •La recherche et l’enseignement universitaires
•L’édition et la documentation
•Le monde des médias
•Organismes culturels
•Relations publiques et management culturel
•Organisations et institutions internationales Conditions d’admission
•Bachelor/Licence dans les domaines des lettres modernes ou classiques, de la littérature, de la culture, de la linguistique et des sciences du langage, des études allemandes, des LEA, des LCE allemand, des sciences politiques, de l’histoire;
Compétences linguistiques au niveau C1 (français et allemand). Possibilité de cours de remise à niveau. Le dossier de candidature comprend une lettre de motivation, un CV et un relevé de notes. Pour faire acte de candidature :•Envoyer le dossier par courriel jusqu’au 15 juillet à:
sebastien.aubry@univ-lorraine.fr Monsieur Sébastien AUBRY – Pôle Masters –
Master franco-allemand – UFR ALL – Département Lettres –CLSH Université de Lorraine – 3 place Godefroy de Bouillon – B.P. 3397 – 54015 Nancy Cedex •Transmettre une copie du dossier par courriel à alain.genetiot@univ-lorraine.fr, à rotraud.kulessa@phil.uni-augsburg.de et à aude.preta@univ-lorraine.fr Responsable de Programme Nancy :
Prof. Dr. Alain Génetiot. Courriel: alain.genetiot@univ-lorraine.fr Reponsable du Master Nancy : Prof. Dr.Aude Préta-de Beaufort Courriel: aude.preta@univ-lorraine.fr Projektbeauftragte Augsburg : Prof. Dr. Rotraud von Kulessa (Masterphase)
Tel.: +49 (0) 821 598 2724
E-Mail: rotraud.kulessa@phil.uni-augsburg.de Les sites à consulter www.univ-lorraine.fr http://www.uni-augsburg.de www.dhf-ufa.org URL DE RÉFÉRENCE http://www.dfh-ufa.org/fr/formations/guide-des-etudes/mode/detail/id/cultures-europeennes-de-la-communication-depuis-le-siecle-des-lumieres-jusqua-lere-contempora/
↧
Bourses de Master franco-allemand Nancy / Augsbourg
↧
Fontenelle et l'opéra (Rouen)
~ Fontenelle et l’opéra ~ Colloque international organisé par Jean-Philippe Grosperrin, Judith le Blanc et Claudine Poulouin Université de Rouen, 9 et 10 juin 2016 ~~~ Jeudi 9 juin 2016 9h: Accueil des participants 9h30: Ouverture du colloquepar Claudine Poulouin (Université de Rouen) 10h: Conférence introductivepar Christophe Martin (Université de Paris-Sorbonne): «La métaphore de l’opéra chez Fontenelle» Questions génériques Présidente de séance: Raphaëlle Legrand 10h30: Perry Gethner (Oklahoma State University): «Le mythe d’ Endymion et la transformation générique : entre tragédie et pastorale» 11h: Camille Guyon-Lecoq (Université de Picardie-Jules Verne, CERR / CERCLL): «Vers une "espèce mixte" du genre tragique: du "mélange per intima " des styles dans les tragédies en musique de Fontenelle» 11h30: Jean-Philippe Grosperrin (Université de Toulouse) : «Fontenelle et la pastorale pour l’opéra: Endymion et Œnone » Pause déjeuner Les compositeurs de Fontenelle Président de séance: Jean Duron 14h30: Raphaëlle Legrand (Université de Paris-Sorbonne): «Quand le président Hénault met en musique Fontenelle: l’ Endymion de 1713» 15h: Benoît Dratwiki (CMBV): « Endymion de Fontenelle et Colin de Blamont : froid garçon, vrai glaçon?» Pause 16h30: Conférence de Manuel Couvreur (Université libre de Bruxelles) 18h: Concert à l’église Saint Thomas de Cantorbéry , 70 rue Louis Pasteur 76130 Mont Saint Aignan. Conception Judith le Blanc et Pêcheur de perles (direction artistique Benjamin Pintiaux), avec Cécile Achille (soprano), Nicolas Bouils (flûte), Maud Gnidzaz (soprano), Marie-Suzanne de Loye (viole de gambe), Marouan Mankar Bennis (clavecin), Camille Verhoeven (violon) et l’Ensemble Léonor (direction Marielle Cafafa). ~~~ Vendredi 10 juin2016 10h: Conférence introductive: Theodora PSYCHOYOU(Université de Paris-Sorbonne) : «Fontenelle et les métamorphoses du domaine musical à l’aube du xviii e siècle. L’entrée de l’acoustique à l’Académie des sciences» Succéder à Lully Présidente de séance: Claudine Poulouin 10h30: Manuel Couvreur (Université libre de Bruxelles): «Fontenelle, le clan Corneille et la crise de la tragédie en musique (1677)» 11h: Jean Duron (CMBV) : «Écrire un nouvel opéra après Lully et Quinault: le cas de Thétis & Pelée de Fontenelle et Collasse» Pause déjeuner Réécritures et réception Président de séance: Jean-Philippe Grosperrin 14h: Judith le Blanc(Université de Rouen) : «La réception parodique de Fontenelle» 14h30: Michel Noiray (IReMus) : « Le Jardinier de Sidon (1768), un roi pasteur à l’Opéra-Comique» 15h: Julien Dubruque (cmbv) : « Énée et Lavinie de Collasse à Dauvergne» Pause Rayonnement européen Présidente de séance: Judith le Blanc 16h: Paolo Russo (Università degli Studi di Parma): « Énée et Lavinie en Italie. Modèles pour une réforme de l’ opera seria » 16h30: Lars Berglund et Maria Schildt (Université d’Uppsala) : «Transfer and use of Enée et Lavinie and Thétis et Pélée at the Swedish court of Charles XII (early 1710s)» Clôture du colloque
↧
↧
Histoire et voix. Personnages et personae porteurs d'histoire(s) (Paris Sorbonne)
Histoire et voix: personnages et personae porteurs d'histoire(s) Samedi 21 mai 2016 – 09h-18h00 Maison de la Recherche, salle 323 – 28, rue Serpente, Paris 6 eLaboratoire junior «Horizons comparatistes»/ Centre de Recherche en Littérature Comparée (EA 4510) - Université Paris-Sorbonne Contacts organisatrices: cilchapon@gmail.com ; marionlabourey@gmail.com 09h00-09h15: Accueil des participants 09h15-09h30: Introduction: problématiques croisées de l'histoire et de la voix. Cécile Chapon et Marion Labourey (Université Paris-Sorbonne, CRLC) 09h30-12h15: Traumatismes et voix occidentales Modératrice: Élisabeth Viain (Université Paris-Sorbonne, CRLC) 09h30-10h: Rémi Wallon (Université Paris Diderot-Paris 7): «Désordre, scandale et bégaiement. La voix célinienne, substitut à l'histoire» 10h-10h30: Cécile Bocianowski (Université Libre de Bruxelles – Université Paris-Sorbonne, CRLC): « Les voix dans Notre Classe de Tadeusz S łobodzianek : entre témoignages et mise en scène» 10h30-10h45: Discussion 10h45-11h00: Pause Café Modératrice: Élodie Coutier (Université Paris-Sorbonne, CRLC) 11h00-11h30: Isabelle Chemoul (Docteur en littérature comparée): « Relater les tragédies de 2001 dans le théâtre contemporain : voix singulière, voix plurielles, voix «porteuses» d'Histoire» 11h30-12h00: Caroline Magnin (Université Paris-Sorbonne, VALE): « Voix, silence et trauma : raconter l'Histoire dans Extremely Loud and Incredibly Close de Jonathan Safran Foer » 12h00-12h15: Discussion 12h15-13h15: Pause Déjeuner 13h15-15h45: Situations africaines: histoires (post)coloniales aux prismes de la voix et de l'archive Modérateur: Pierre Leroux (Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle) 13h15-13h45: Marion Coste (Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle): «'Je vais vraiment, vraiment raconter ma vie de merde et de damné' : la voix d’un enfant soldat dans Allah n’est pas obligé d’Ahmadou Kourouma» 13h45-14h15: Elara Bertho (Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle): «Voix et archives : de quelques postures éthiques pour dire l’histoire coloniale» 14h15-14h30: Discussion Modératrice: Marion Labourey (Université Paris-Sorbonne, CRLC) 14h30-15h00: Mahaut Rabaté (Université Paris-Sorbonne, CIEF): «Assia Djebar et Boualem Sansal : poétiques et politiques des voix fictionnelles» 15h00-15h30: Adilson Franzin (Université Paris-Sorbonne, CRIMIC): «'Hélas ! Si j'avais écouté ce que maman disait.' Une lecture de Le dernier vol du flamant de Mia Couto» 15h30-15h45: Discussion 15h45-16h00: Pause Café 16h-17h45: Performances, témoignages et mythes historiques Modératrice: Cécile Chapon (Université Paris-Sorbonne, CRLC – Université de Cergy-Pontoise) 16h00-16h30: Sébastien Ruffo (Université Western Ontario) : « Voix de sortie:Performance et fiction mytho-historiquedans « Capitão »de Jean-Marc Massie.» 16h30-17h00: Maya Anderson (Université de Cergy-Pontoise): «Témoignages d’Afro-Cubaines: quelles voix pour quelles subjectivités?» 17h00-17h30: Conclusions et clôture. *** Cette journée d’étude s'inscrit dans le cadre de la réflexion sur l'écriture de l'histoire dans les littératures du xx e et xxi e siècles, et pose plus précisément la question de la voix qui transmet, narre, chante ou dénonce le «cauchemar de l'histoire». Il s'agit d'étudier, dans sa dimension poétique et performative, la construction des narrateurs, personnages ou personae qui sont porteurs d'histoire(s), et les nouvelles représentations de l'histoire qu'ils suscitent. Le terme d’ histoire désigne, au sens large, l’ensemble des événements passés, et s’il est certes à prendre en compte dans sa dimension politique, il peut renvoyer à des situations sociales et culturelles. Toutefois, n’est histoire que ce qui est mis en mots, organisé et transmis par l’autorité d’une voix. Or la littérature et les arts du xx e et du xxi e siècles ont porté au jour des voix multiples, qui proposent, parallèlement à celle de l’historien, une lecture du passé. Ce développement semble lié à l’évolution de la discipline historique au cours du xx e siècle: de nombreux travaux historiographiques, en menant une réflexion féconde sur l’écriture de l’histoire, apportent un nouvel éclairage aux études sur les relations entre le récit historique et le récit de fiction. Dès lors, les théoriciens de la littérature insistent sur la légitimité des œuvres littéraires à représenter et à problématiser le passé. La voix doit être considérée selon plusieurs approches, étroitement liées à la représentation textuelle de l'oralité. Sans limiter sa définition au concept narratologique, il paraît cependant essentiel d’interroger le statut des narrateurs, personnages ou personae prenant en charge le récit des événements à l'intérieur du texte et du contexte socio-culturel dans lequel ils s'inscrivent, pour dégager la portée de leur voix. L’attention peut ensuite se concentrer sur la matérialité de la voix : y a-t-il une mise en scène de la parole retraçant un épisode historique, et dans quelle mesure la matérialité (texture de la voix, gestuelle de la figure qui parle) joue-t-elle un rôle dans la construction et la transmission de l'histoire? La question du destinataire, représenté ou non dans le texte, est également essentielle: s'il y a une transmission à l'intérieur du texte, des dialogues ou des échos entre plusieurs voix, comment s'organise la circulation entre elles et quel en est l’effet sur la construction d'une ou de plusieurs versions de l'histoire? Et dans un mouvement inverse et complémentaire, si les faits historiques nourrissent les littératures du xx e et du xxi e siècles, dans quelle mesure déstabilisent-ils l'écriture et les genres littéraires, et complexifient-ils l'émergence d'une voix pour les dire? Lorsque ces voix se donnent pour objectif de rompre les silences, par quel tour de force esthétique imposent-elles leur présence? Puisque toute écriture de l’histoire implique une sélection des faits et un point de vue organisateur, quel nouveau rapport établissent-elles entre ce qui doit être dit et ce qui sera tu? Il conviendra d’examiner les dimensions éthiques et politiques du texte qui découlent de la construction et de l’articulation des voix au sein des œuvres.
↧
Octave Mirbeau et la Bretagne
Appel à contributions Colloque Octave Mirbeau et la Bretagne , à l’occasion du centenaire de l’écrivain (16 février 1848-16 février 1917) Samedi 11 février 2017, Théâtre du pays de Morlaix Dans le cadre de la commémoration internationale du centième anniversaire de la mort de l’écrivain et critique d’art Octave Mirbeau (1848-1917), la Société Octave Mirbeau, association littéraire fondée en 1993, organise un colloque «Octave Mirbeau et la Bretagne», qui aura lieu à Morlaix (Finistère), dans l’enceinte du théâtre municipal, le samedi 11 février 2017. Certes, Mirbeau est Normand, et c’est la Normandie qu’il évoque le plus souvent dans ses contes et ses romans. Mais il a aussi beaucoup fréquenté la Bretagne: il a passé quatre ans chez les jésuites de Vannes, puis sept mois à Audierne en 1884, il a vécu trois ans à Kérisper, près d’Auray, et il a, un temps, cherché une maison à Belle-Île, où il a rejoint son ami Claude Monet en 1886. Et surtout c’est en Bretagne qu’il situe son roman Sébastien Roch (1890), ainsi que plusieurs chapitres du Calvaire (1886), plusieurs épisodes des 21 jours d’un neurasthénique (1901) et nombre de contes rédigés sur place; et c’est à Audierne qu’il fait naître la chambrière Célestine du Journal d’une femme de chambre (1900). Il n’est donc pas inutile de s’interroger sur les liens qui attachent l’écrivain à cette terre sur laquelle il revient avec prédilection. Espace de la fiction de nombre de ses romans, la Bretagne suscite chez lui des tendances contradictoires. Lieu de la retraite de personnages résolus à s’écarter de l’univers parisien, il est aussi celui que Mirbeau même élit pour trouver le calme et l’inspiration nécessaires à l’écriture; Kérisper, Belle-Île dans le Morbihan, seront propices à la fois à la création et à la rencontre privilégiée des grands artistes chers entre tous, Monet, Geffroy, Rodin. Tout un pan de la correspondance bretonne diffuse les encouragements, donnés ou… sollicités: Maupassant, Hervieu, Zola, Bourget sont tour à tour invités à rejoindre Mirbeau en une région dont il ne se lasse pas de vanter les beautés. Mais l’enthousiasme ne le cède en rien à l’acuité du regard et au verbe du pamphlétaire, quand la cohabitation avec les habitants se montre parfois difficile. Certes Mirbeau sait rendre hommage à la rudesse et à la simplicité qui président à la vie des paysans bretons. Pourtant la correspondance de l’écrivain, ou plus tard, un récit comme La 628E-8 , laissent s’épancher certain discours dirigé contre des travers qu’il estime typiquement bretons: «Quel sale pays que la Bretagne! », tempête-t-il dans ses lettres. Le Calvaire , Sébastien Roch , sauront restituer l’âpreté de paysages qui deviennent un cadre idéal à l’épanouissement des souffrances morales, affectives, physiques. Plus tard, le regard distancié de la Bretonne Célestine se fera témoin du phénomène social tel que Le Journal d’une femme de chambre le donne à lire. Mirbeau et la Bretagne, ou entre préjugés et analyse lucide… La singularité des paysages bretons n’inspire pas seulement sa plume, mais aussi le pinceau et la palette du peintre amateur qui sommeille en lui. Par surcroît, les peintres de Pont-Aven sauront exciter à leur manière la verve du critique d’art, fasciné par l’art de Gauguin, presque autant que par les toiles que Monet ramène de Belle-Île en 1886. Les coutumes bretonnes aiguillonnent sa curiosité, et les tableaux de Sainte-Anne d’Auray, l’éducation des jésuites, la paysannerie, le rôle et la place du clergé, sont autant de sujets qui irriguent l’œuvre du romancier et du nouvelliste. En 1899, lors du procès de Rennes, journaliste dévoué aux côtés du capitaine Dreyfus, Mirbeau n’est-il pas un peu chez lui? On le voit, les dimensions historique, artistique, littéraire, stylistique et sociologique gagneront à être abordées dans les diverses communications que nous sollicitons, pour mieux cerner la densité et l’ambiguïté des liens tissés entre Mirbeau et la Bretagne. L’approche biographique complètera au besoin l’analyse, tandis que la problématique esthétique achèvera de situer Mirbeau parmi les critiques d’art qui comptent. Les propositions de communication sont à adresser à Samuel Lair ( samuellair@sfr.fr ) avant le 30 novembre 2016 . Merci de joindre une version abrégée de votre CV.
↧
L. Chestov, Sur la balance de Job. Pérégrinations à travers les âmes
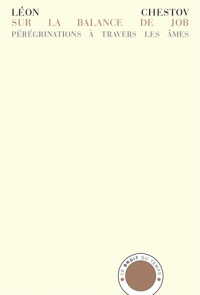 Sur la balance de Job. Pérégrinations à travers les âmes Léon Chestov Boris de Schloezer (Traducteur), Isabelle de Montmollin Date de parution : 16/04/2016 Editeur : Bruit du temps (Le) ISBN : 978-2-35873-097-6 EAN : 9782358730976 Format : Grand Format Présentation : Broché Nb. de pages : 600 p. VIIe tome des Œuvres complètes voulues par Léon Chestov, Sur la balance de Job regroupe, sous le signe de Job et de sa douleur "plus lourde que le sable de la mer", certaines des plus belles pages du philosophe russe. Autour des 52 aphorismes d'"Audaces et soumissions", ces "Pérégrinations à travers les âmes" nous conduisent en effet de Tolstoï et Dostoïevski - avec le livre Les Révélations de la mort, initialement paru chez Plon en 1923 - à Plotin et à ses "Discours exaspérés", en passant par Descartes, Spinoza ("Les favoris et les déshérités de l'histoire") et Pascal ("La nuit de Gethsémani"). *On peut lire sur enattendantnadeau.fr un article sur cet ouvrage : "Que veut Chestov ?", par Chr. Mouze.
Sur la balance de Job. Pérégrinations à travers les âmes Léon Chestov Boris de Schloezer (Traducteur), Isabelle de Montmollin Date de parution : 16/04/2016 Editeur : Bruit du temps (Le) ISBN : 978-2-35873-097-6 EAN : 9782358730976 Format : Grand Format Présentation : Broché Nb. de pages : 600 p. VIIe tome des Œuvres complètes voulues par Léon Chestov, Sur la balance de Job regroupe, sous le signe de Job et de sa douleur "plus lourde que le sable de la mer", certaines des plus belles pages du philosophe russe. Autour des 52 aphorismes d'"Audaces et soumissions", ces "Pérégrinations à travers les âmes" nous conduisent en effet de Tolstoï et Dostoïevski - avec le livre Les Révélations de la mort, initialement paru chez Plon en 1923 - à Plotin et à ses "Discours exaspérés", en passant par Descartes, Spinoza ("Les favoris et les déshérités de l'histoire") et Pascal ("La nuit de Gethsémani"). *On peut lire sur enattendantnadeau.fr un article sur cet ouvrage : "Que veut Chestov ?", par Chr. Mouze.
↧
↧
Journée Montaigne, Essais , livre III (Agrégation 2017)
Une journée d'étude, organisée par Stéphan Geonget (MCF HDR), consacrée au livre III des Essais de Montaigne (au programme de l'agrégation) aura lieu au Centre d'Études Supérieures de la Renaissance de Tours (salle Rapin) le samedi 8 octobre 2016.Jean Balsamo, Le livre III comme opus senile Marie-Luce Demonet, Potentiel, irréel et contrefactuel dans le livre IIIStéphan Geonget, « Le corps, duquel je n’ay non plus oublié le soing »Olivier Guerrier, Montaigne et la « reconnaissance »Déborah Knop, « Quand on m’a dit ou que moy-mesme me suis dict » : l’objection comme dynamique discursiveAlain Legros, Titres et commencementsEmmanuel Naya, « Combien peut le temps & l’exemple ? » La figure exemplaire dans le livre IIIBlandine Perona, La santé dans le livre III
↧
E. Kästner, Vers l'abîme
Vers l'abîme Erich Kästner Corinna Gepner (Traducteur) Date de parution : 14/01/2016 Editeur : Anne Carrière ISBN : 978-2-84337-760-0 EAN : 9782843377600 Format : Grand Format Présentation : Broché Nb. de pages : 275 p. Vers l'abîme est un roman miraculé. Censuré à sa parution, en 1931, par son éditeur que terrifie l'indécence des moeurs qu'il décrit. Vilipendé dès sa sortie par la critique, scandalisée à la lecture du miroir qu'il tend à la société allemande. Brûlé en 1933 dans les autodafés nazis qui voient en lui le symbole ultime de la "dégénérescence". Oublié au lendemain de la guerre parmi les ruines d'un pays incapable de supporter que certains de ses intellectuels aient fait preuve de tant de lucidité quand il était encore temps... Le voici enfin réédité dans son intégrale et radicale version originale. *L'Alamblog a consacré un billet à cette traduction : "Corinna Gepner nous propose de lire Vers l'abîme , grand moment de littérature due à un autre numéro du siècle dernier, Erich Kästner , parfait représentant lui aussi de l'Allemagne d'avant-guerre, ce monde tourbillonnant, qui peut nous paraître étrange. Même si on a bien étudié les films de Fritz Lang ou de Billy Wilder, voici un roman cinq étoiles que l'on vous conseille sans barguigner de dévorer, et shnell. La culture mittleuropa n'étant pas spécifiquement française, ces rappels à la réalité du monde germanophone est une bénédiction pour l'esprit. D'abord parce que l'imagination des écrivains de cette époque est délicieuse (voyez Arthur Schnitzler et sa Gloire tardive , une merveille de maîtrise et de subtilité), d'autre part parce que leur sens du burlesque est unique - en particulier chez le monteur de spectacles de cabaret que fut Kästner. - Car, de fait non, il ne fut pas seulement l'auteur d 'Emile et les détectives .Auteur avec Vers l'abîme d'une chronique burlesque, plutôt dépeignée et carrément inquiétante de l'Allemagne hirsute des années 1920-1930, il relate ce qui de la vie nocturne déraille étrangement et de la vie diurne vire au cynisme et à l'immoralité brutale et les compromis détestables (les affaires). Avec des éclats formidables, des sorties délicieuses et des échanges tonitruants, un monde désorienté coupé des principes moraux traditionnels galope vers le n'importe quoi et y parvient comme on a su clairement un petit peu plus tard. Pour son cas personnel, Kästner ne fut pas déçu non plus : il vit concrètement ses livres autodafés par les Nazis et dut se résoudre à l'effacement pour éviter le lynchage d'une foule déchaînée. Seul restait son Emile, ses détectives et, enfin redécouvert, son Jacob Fabian, dandy dont le nom évoque évidemment certain Britannique expert en "dérèglements" et débauches, et qui, en passant incapable d'intervenir concrètement face au naufrage de Weimar, observe la dinguerie collective au moment où elle vire à la sauvagerie. En somme, de quelque côté que l'on prenne l'affaire, il est beaucoup question de fessées dans ce livre."
↧
Figures de l'étudiant de l'Antiquité au XXI e s., entre communauté et marginalité (Lorien)
Figures de l'étudiant de l'Antiquité au XXI e siècle, entre communauté et marginalité .1er-2 décembre 2016, Université de Bretagne Sud Dans le sillage des récents et importants travaux de Jacques Verger sur la mobilité des étudiants au Moyen Âge, nous souhaiterions proposer une vaste réflexion au croisement des disciplines sur la figure de l'étudiant de l'Antiquité au XXI e siècle. Population née de migrations inter et intra nationales, de brassages et de recompositions, les étudiants constituent au fil des siècles des communautés spécifiques, parfois en marge de la société, parfois au coeur des changements sociologiques ou de l'action politique comme en atteste par exemple la fondation en 1935 de la revue L'Etudiant noir , par Aimé Césaire permettant l'émergence du mouvement littéraire et politique de la Négritude. Dans la littérature, de Villon à Jules Vallès, en passant par Hugo et Flaubert, l'étudiant constitue un type, traité au travers de diverses approches, figure de l'exclusion ou de l'intégration - balancement mis en question dès l 'Institution oratoire de Quintilien - , du changement ou de la reproduction sociale. Personnages privilégiés du roman de formation, les étudiants sont des êtres en devenir formant une communauté mouvante, aux frontières floues. Cette enquête croisera avec profit des approches variées, historiques, géographiques, juridiques, sociologiques, rhétoriques, littéraires, médicales notamment. Ce projet s'articule avec les axes de recherches que privilégie le projet IDENSO, à savoir la question de la marginalité, de la communauté et des territoires. Si ces axes d'études (qui ne sont pas restrictifs) vous intéressent, veuillez nous faire parvenir une proposition de communication pour le 15 juin. Pour les inscriptions, prière de nous contacter. Contacts: idurand@univ-ubs.fr; patricia.victorin@univ-ubs.fr; marie.bulte@univ-ubs.fr Isabelle Durand (PR Littérature comparée, HCTI), Patricia Victorin (PR Langue et Littérature médiévales, HCTI), Marie Bulté (ATER Littérature française, HCTI).
↧
La Fabrique des traducteurs / Une voix à traduire # 24, avec Delphine Minoui (Arles)
SOIRÉE LITTÉRAIRE -LUNDI 23 MAI 2016 ATLAS et le Collège International des traducteurs littéraires présentent 18h30 > Encres fraîches de l'atelier français//arabe de la Fabrique des traducteurs littéraires Après dix semaines d’atelier, six jeunes traducteurs présentent les textes qu’ils ont choisi de faire découvrir ou redécouvrir dans leur traduction. On entendra en français et en arabe des morceaux choisis des Fables de La Fontaine, de fictions contemporaines (Ali Bader, Delphine Minoui, Arezki Mellal), de théâtre algérien inédit des années 2000 (Nadjet Taïbouni et Omar Fetmouche), et d’un ouvrage présentant la création arabe des années 70 à 2000 en littérature pour la jeunesse (Mathilde Chèvre). Une occasion de rencontrer ceux qui demain nourriront la circulation des textes et des idées entre l’espace francophone et le monde arabe. Mise en voixpar Dominique Léandri Lecturespar les traducteurs : Rita Bariche, Bruno Barmaki, Chawki Benzehra, Amjad Etry, Maïté Graisse, Souria Grandi Initié par l’association ATLAS en 2010, la Fabrique des traducteurs est un programme qui donne à de jeunes traducteurs les moyens d’affirmer leur vocation. 19:30 > Une voix à traduire # 24 avec Delphine Minoui Delphine Minoui, auteur de Je vous écris de Téhéran (Le Seuil), dialoguera avec Rita Bariche, traductrice vers l’arabe de ce témoignage exceptionnel dans le cadre du programme LaFabrique des traducteurs. //L’auteur// De mère française et de père iranien, Delphine Minoui est lauréate du prix Albert Londres 2006 pour ses reportages en Iran et en Irak. Elle est grand-reporter, correspondante du Figaro au Moyen-Orient. Après Téhéran et Beyrouth, elle vit aujourd’hui au Caire. Elle est également l’auteur des Pintades à Téhéran (Jacob Duvernet), de Moi, Nojoud, dix ans, divorcée (Michel Lafon), et de Tripoliwood (Grasset). //Le roman// Sous la forme d’une lettre posthume à son grand-père, entremêlée de récits plus proches du reportage, Delphine Minoui raconte ses années iraniennes, de 1997 à 2009. Au fil de cette missive où passé et présent s’entrechoquent, la journaliste franco-iranienne porte un regard neuf et subtil sur son pays d’origine, à la fois rêvé et redouté, tiraillé entre ouverture et repli sur lui-même. Avec elle, on s’infiltre dans les soirées interdites de Téhéran, on pénètre dans l’intimité des mollahs et des miliciens bassidjis, on plonge dans le labyrinthe des services de sécurité, on suit les espoirs et les déceptions du peuple, aux côtés de sa grand-mère Mamani, son amie Niloufar ou la jeune étudiante Sepideh. La société iranienne dans laquelle se fond l’histoire personnelle de la reporter n’a jamais été décrite avec tant de beauté et d’émotion. [Éditions du Seuil] Depuis 2009, le cycle de rencontresUne Voix à traduireapour but deprésenter aux traducteurs résidents au CITL et au grand public des auteurs francophones non – ou peu – traduits en langue étrangère.
↧
↧
Situation du langage. Autour de Critiques de l'anglais. Poétique et politique d'une langue mondialisée de Claire Joubert (Reid Hall, Paris)
A l'occasion de la parution de Critiques de l'anglais. Poétique et politique d'une langue mondialisée (Claire Joubert, Limoges, Lambert-Lucas, 2015), Rencontre de présentation du livre et de réflexion, plus largement, sur la Situation du langage à Reid Hall, Columbia Global Center, 4 rue de Chevreuse, 75006 le lundi 30 mai à 18h30, salle des conférences. NB : pour des raisons de sécurité, l'entrée (libre) se fait sur réservation uniquement : rsvp en ligne : http://events.reidhall.com/en/?event=1461854555 Débat avec Catherine Bernard, Marc Arabyan et François Rastier, sur l'état de la question du langage dans la pensée critique, dans les disciplines, et dans l'édition. La rencontre se fait en collaboration avec le Columbia Global Center, les Editions Lambert-Lucas et la Librairie Tschann. Critiques de l'anglais. Poétique et politique d'une langue mondialisée, Claire Joubert Limoges, Lambert-Lucas, ISBN 978-2-35935-149-1, 13,5 x 21,5cm, 340 pages, 27 euros présentation de l'éditeur : http://www.lambert-lucas.com/critiques-de-l-anglais-poetique-et
↧
La littérature gambienne: bilan et perspectives
APPEL A CONTRIBUTIONS POUR OUVRAGE COLLECTIF La littérature gambienne: bilan et perspectives La Gambie est un petit Etat, situé autour du fleuve homonyme : sa longueur est de plus de trois cents kilomètres mais sa largeur ne dépasse pas, au mieux cinquante kilomètres. Enclavé dans le Sénégal, ce territoire est un espace dont les frontières n’ont été fixées arbitrairement entre deux puissances coloniales, le Royaume Uni et la France, qu’au début du XXème siècle – et qui ont encore donné lieu à de petites rectifications après l’indépendance. Etant donné l’étonnante exiguïté de l’espace, on se doute que la plupart des populations de ce pays sont communes avec celles du Sénégal. Pendant longtemps, l’existence ou non d’une littérature gambienne a alimenté les débats. Cependant, en dépit de ce qu’avancent les quelques rares critiques littéraires qui se sont intéressés à son cas, la production littéraire en Gambie, certes peu volumineuse sur le plan quantitatif, ne fait pas figure de parent pauvre sur le plan qualitatif du moins: « A distinctive literature in English is being created, a literature which - perhaps with a little poetic licence - can be understood as part of a cultural resistance to the political fiction that was a Senegambian state ». [1] La réflexion critique ne crée pas l’objet qu’elle étudie mais elle le reconnaît et le fait reconnaître. Or, même si, en l’état actuel des choses, la littérature écrite gambienne n’est pas considérable du point de vue quantité, elle est, du moins, en train de prendre corps. Et l’on comprend que, si nous nous proposons d’étudier des thèmes majeurs de la littérature gambienne, il faut déjà accepter qu’elle existe. La langue d’écriture, du fait de la colonisation britannique, est l’anglais. S’il existe des productions littéraires gambiennes écrites en d’autres langues (français, arabe, elles sont, pour l’instant, si minimes qu’elles ne peuvent être prises en considération). D’autre part, il va de soi que nous ne réduisons pas la littérature gambienne à la littérature écrite, d’autant qu’en Gambie la littérature orale est majeure et diverse (à la fois dans les langues et dans les genres de productions), mais simplement la littérature orale ne sera pas ici l’objet de notre étude. Les études qui seront rassemblées dans le 2 e numéro spécial de la Revue du Groupe GELL sur la littérature gambienne s’articuleront autour des thématiques suivantes:¬ Histoire et identité de la littérature gambienne¬ Littérature et nation¬ Littérature et altérité¬ Littérature et genre¬ Enseignement et recherche universitaire¬ Défis de la publication en Gambie¬ Expression littéraires dans la presse gambienne¬ Littérature et intertextualité La liste des thématiques n’est pas exhaustive et pour ce qui est des perspectives, d’autres pistes de recherche et d’approches peuvent être explorées par les chercheurs. Envoi des propositions de communications: Tous les résumés (environ 250 mots) devront être envoyés au plus tard le 3 1 juillet 2016 uniquement par mail aux adresses suivantes:¬ Pierre Gomez: pgomez@utg.edu.gm , Université de Gambie;¬ Sylvie Coly: scoly@utg.edu.gm , Université de Gambie; et¬ Boubacar Camara: boucamara2000@gmail.com , Université Gaston Berger, Sénégal. Pour les propositions retenues, date limite d’envoi des articles accompagnés d'un résumé de texte avec indication des mots clés (environ 15 pages): le 3 1 juillet 2016. Evaluation des propositions:du 1er au 25 août 2016 Publicationpar la revue GELL de l’Université Gaston Berger de St. Louis, Sénégal: décembre 2016 [1] BROWN (Stewart).- “ Gambian Fictions ” in Wasafiri, Spring 1992 N°15, p. 2
↧
L’écriture rhétorique des poètes augustéens (Clermont-Ferrand)
Colloque organisé les 3 et 4 novembre 2016 à la Maison des Sciences de l’Homme de Clermont-Ferrand par Hélène Vial CELIS (Centre de Recherches sur les Littératures et la Sociopoétique, EA 4280) Équipe «Écritures et représentations de l’Antiquité et du Moyen Âge» Comité scientifique:Hélène Casanova-Robin, professeur de latin à l’Université Paris-SorbonneAnne-Marie Favreau-Linder, maître de conférences de grec à l’Université Blaise Pascal de Clermont-FerrandLaurent Pernot, professeur de grec à l’Université de Strasbourg, membre de l’InstitutRémy Poignault, professeur de latin à l’Université Blaise Pascal de Clermont-FerrandHélène Vial, maître de conférences de latin à l’Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand Ce colloque constitue le deuxième volet d’un triptyque intitulé «La poésie de l’époque d’Auguste et la rhétorique» , dont l’objet est d’explorer dans tous ses aspects la relation d’influence réciproque entre la poésie augustéenne et le champ rhétorique:«La culture rhétorique des poètes augustéens» (5-6 novembre 2015)«L’écriture rhétorique des poètes augustéens» (3-4 novembre 2016)«Lectures rhétoriques des poètes augustéens» (novembre 2017) La première des trois rencontres visait à placer cette relation dans son contexte , en croisant histoire des idées et histoire des hommes. Qui étaient les grands orateurs et professeurs, grecs et romains, dont les poètes qui nous intéressent ont suivi ou pu suivre les leçons? en quoi consistaient leur pratique oratoire, leur enseignement? quelles œuvres théoriques, contemporaines ou antérieures, ont-ils étudiées ou pu étudier? Quelle image ces poètes ont-ils laissée, en tant qu’élèves de l’école du rhetor ou en tant que lecteurs d’ouvrages rhétoriques, à leurs contemporains (pensons notamment à Sénèque le Rhéteur évoquant Ovide)? Dans leur œuvre poétique, quelle attitude adoptent-ils vis-à-vis de leur propre apprentissage rhétorique, que celui-ci s’y trouve évoqué de manière directe ou, par exemple, à travers tel ou tel personnage? Ce deuxième colloque, «L’écriture rhétorique des poètes augustéens», consistera à analyser l’ œuvre même de ces poètes sous l’angle de la relation entre poétique et rhétorique, afin de tenter non seulement d’évaluer ce que leur manière d’écrire des poèmes doit à la rhétorique, mais aussi d’étudier les différentes manières dont ils mettent en scène la relation entre ces deux domaines (influence affichée, rivalité voire opposition réelles ou feintes) et ce que ces mises en scène nous apprennent sur leur relation à la culture de leur temps et leur conception de leur propre vocation poétique. Le troisième colloque, «Lectures rhétoriques des poètes augustéens», se veut une investigation portant, cette fois en «aval» –le premier pouvant se définir comme l’«amont»–, sur la réception rhétorique de la poésie augustéenne de l’Antiquité à nos jours, réception qui, si elle a parfois pu conduire à une surinterprétation, voire à une déformation, met aussi en lumière un aspect central de l’écriture de ces poètes. Les propositions de communication, composées d’un titre et d’un argumentaire d’une dizaine de lignes et accompagnées d’une courte biobibliographie, seront envoyées avant le 15 juin 2016 à l’adresse suivante: Helene.VIAL@univ-bpclermont.fr Remarque: si le troisième colloque du triptyque vous intéresse, vous pouvez d’ores et déjà le signaler.
↧
Eloge de la fiction (Tozeur)
Appel à communications Eloge de la Fiction Colloque international Organisé parL'Institut Supérieur des Etudes Appliquées en Humanités de Tozeur,L'Institut Supérieur des Langues de Gabès,L'Institut Supérieur des Sciences Humaines de Médenine Unité de Recherche en Littérature, Discours et Civilisation, Sfax (URLDC) 10-12 novembre 2016 Date limite pour l'envoi des propositions: 30 juin 2016 Le champ de la fiction recouvre une étonnante diversité de productions. En littérature, il s'étend des romans de kiosques de gare aux poésies de Mallarmé, d' A la recherche du temps perdu aux pièces de Samuel Beckett. On a par ailleurs longtemps opposé l'histoire fictive à l'histoire authentique issue des événements réels. Ce dualisme a hanté les réalistes dont la règle était de s'abriter derrière l'observation minutieuse du monde extérieur, de l'Histoire, de la société et de s'entourer de documents "authentiques". Cette séparation est loin de tenir compte de la spécificité de la littérature. Il convient mieux d'opposer non pas histoire fictive et histoire vraie - car tout roman comporte une part de vérité et une part de mensonge - mais fiction (histoire) et narration, énoncé et énonciation. C'est avec Flaubert, d'ailleurs, que le terme de fiction commence à désigner non plus la chose vue mais le sujet qui écrit. Le fameux projet du "livre sur rien", de l'écriture abstraite du "livre sans attache extérieure, qui se tiendrait de lui-même par la force du style" met en question l'histoire anecdotique et annonce la mort du romanesque que l'on se plaît à reprocher au "nouveau roman" contemporain pour qui le roman n'est plus, selon le mot de Ricardou, le récit d'une aventure, mais l'aventure d'un récit. La narrativité, sérieusement remise en question par les méandres associatifs du style proustien, débouche dans le roman moderne sur une confusion entre description créatrice et relation reproductrice : la généralisation d'un présent dont on ne sait s'il est narratif ou scénique en est un des indices. Le romanesque s'éloigne ainsi d'une prose transparente apte à véhiculer une fiction fertile en événements pour se rapprocher du lyrisme d'une écriture poétique ou blanche dont l'histoire n'existe pas en dehors des mots, des signes auxquels elle se réduit. L’un des paradoxes de la fiction tient à son objet d’analyse qui est à la fois précis et évanescent. En effet, la fiction n’obéit pas à des modes de production et de réception homogènes, figés. Certaines œuvres littéraires plongent le lecteur dans un univers imaginaire. Ils le conduisent à s’intéresser à la succession des évènements et à l’évolution de l’action. L’illusion qui se définit dans ce cas comme le fondement de la création de la fiction est déterminée par deux conditions: la première concerne le lecteur, la deuxième l’auteur. Si ce dernier s’applique à se rendre invisible c’est pour que l’adhésion du lecteur à l’univers fictif soit totale. Il dissimule les procédés narratifs qu’il utilise, élimine tous les indices qui pourraient manifester sa présence et se limite à mimer le réel qu’il représente si habilement que les événements paraissent se raconter eux-mêmes. Son objectif est de «piéger» le récepteur de ses œuvres, de l’engager dans son univers fictif, et de l’amener à s’identifier aux héros. Le lecteur se laisse prendre au «piège» de l’illusion car il est incapable de saisir le caractère imaginaire et artificiel du récit. Dans d’autres œuvres littéraires , la fiction «ne cache à aucun moment son caractère de fiction» ( Eloge de la fiction , Fayard, 1999, p.108). C’est l’écriture elle-même qui devient son sujet et son objet, le lecteur ne peut plus se laisser prendre au jeu de l’intrigue même la plus séduisante et la plus saisissante. L’auteur intervient constamment dans la fiction et affecte en conséquence l’illusion qui constitue le fondement de l’identification. Il n’est pas toujours facile de délimiter le domaine de la fiction et de définir ses frontières. Les textes de fiction dont la diffusion est massive sont maintenus par certains critiques à la périphérie de la littérature et sont rejetés par d’autres critiques et placés du coup en dehors de la création littéraire. Les romans policiers, les récits d’espionnage, d’épouvante, d’énigme, la science- fiction, la bande dessinée, les romans noirs, etc. sont désavoués par certains critiques, considérés comme une littérature de gare, «une mauvaise littérature» alors qu’ils sont des moyens d’expression de la fiction qui séduisent le grand public. S’interroger sur le statut de la fiction aujourd’hui, sur sa nature et ses moyens d’expression dans le système éditorial moderne, et dans le contexte culturel de l’ère industrielle, nous amène à remettre en question les frontières entre la littérature et la paralittérature. Ce rapport paradoxal entre les divers moyens d’expression de la fiction suscite plusieurs questions: les événements et les personnages imaginaires sont-ils pour autant irréels? Comment peut-on distinguer le fictionnel et l’irréel, le fictionnel et le fictif? La fiction doit-elle se fonder sur l’adhésion du lecteur pour s’imposer? Quelle est la nature de la relation entre la fiction et la paralittérature? Comment un auteur arrive-t-il à conduire le lecteur aujourd’hui à accepter et à vivre une fiction comme s’il s’agissait de la réalité? Les tentatives de certains auteurs contemporains de «défictionaliser» la littérature ont-elles échoué? Comment appréhender la fiction? Si «l’aventure est l’essence même de la fiction» comme l’affirme Jean-Yves Tadié ( Le Roman d’aventures , PUF, 1982, p. 5), la narratologie, la stylistique, la socio-critique, l’analyse structurale permettent-elles aujourd’hui d’appréhender efficacement les énoncés fictionnels, leurs structures internes, leurs modes de production et de réception? Le but de ce colloque est d’explorer ces questions, de repenser la fiction, et de redéfinir ses enjeux. Les communications pourraient s’inscrire dans les axes de réflexion suivants: - Fiction et genres littéraires - Fiction et «mauvais genres» - Histoire de la fiction - Fiction et pacte de lecture - L’identité paratextuelle de la fiction - Fiction et narratologie - Fiction et paralittérature - Stylistique de la fiction Bibliographie - R. Barthes, L. Bersani, Ph. Hamon, M. Riffaterre, I. Watt, Littérature et réalité, Seuil, 1982. - F. Berthelot, "Le débat fictionnel", Critique , numéro 635, Avril 2000, pp.312-323. - F. Berthelot, «la Nouvelle Fiction», Magazine littéraire , no392, novembre 2000, p.30-33. - B. Blanckeman, Les Fictions singulières , Prétexte Éditeur, 2002. - Christophe Donner, Contre l'imagination , Fayard, 1998. - E. Clémens, La Fiction et l'apparaître , 1993, Albin Michel. - A. Gefen et R. Audet (sous la dir.), « Comment définir la fiction? », in Frontières de la fiction , Québec/France, Nota Bene/Presses universitaires de Bordeaux, 2001, 3-13. - C. Gregory, The Nature of Fiction , New York, Cambridge University Press, 1990 - D. Cohn, Le Propre de la fiction , Paris, Seuil, 2001. - G. Genette, Fiction et diction , 1991, Seuil. - K. Hamburger, (1977), Logique des genres littéraires , Paris, Seuil, 1986. - P. Hébert, « Éloge de la fiction », Voix et Images , volume 17, n° 3, (51) 1992, p. 529-535. http://www.erudit.org/revue/VI/1992/v17/n3/200985ar.pdf - M. Macdonald, « Le Langage de la fiction », Poétique , 78, 1989, 219-235. - J-L. Moreau, La Nouvelle Fiction , Paris, Critérion, 1992. - R. Odin, De la fiction , Bruxelles, De Boeck Supérieur, 2000. - D. Rabaté, Vers une littérature de l'épuisement , José Corti, 1991. - A. Reboul, Rhétorique etstylistiquede lafiction , Presses universitaires de Nancy, 1992. -T. Pavel, (1986), Univers de la fiction , Paris, Seuil, 1988. - J-M. Schaeffer, Pourquoi la fiction? Paris, Seuil, 1999. -J. R. Searle, (1979), Le Statut logique du discours de la fiction,Sens et expression , Paris, Minuit, 1982. Les titres et résumés des communications, d’environ une demi-page, accompagnés d’une notice biographique sont à envoyer uniquement par voie électronique avant le 30 juin 2016 à: bkhairia_hassen@yahoo.fr Calendrier 30 juin 2016 : Réception des propositions de communication 30 juillet 2016: Notification aux auteurs 10-12 novembre 2016: Colloque international juin 2017: publication Responsables : Hassan Bkhairia , Arselène Ben Farhat et Mustapha Trabelsi
↧
↧
«Literary States of Consciousness» (Paris)
Journée d’étude «Literary States of Consciousness» 2 juin 2016 Institut du monde anglophone de la Sorbonne Nouvelle (5, rue de l'École de médecine, Paris) Organisateurs : Pierre-Louis Patoine et Deborah Jenson Avec le soutien du laboratoire PRISMES (EA 4398) et du Neurohumanities Research Group (Duke University). Cette journée se tiendra en anglais. Préinscription souhaitée avant le 30 mai / Please register here before May 30th : http://doodle.com/poll/tpxtkr59aa26hxwx PROGRAMME DE LA JOURNÉE 10:50 Opening 11:00–12:45 Embodied experience of fictional environments Alexa Weik Von Mossner (University of Klagenfurt) Embodied Simulation and Emotion in the Evocation of Literary Environments Dominique Makowski, Marco Sperduti, Pascale Piolino (Sorbonne Paris Cité / INSERM, Center for Psychiatry & Neuroscience,) The Sense of Realityas a feature of proto-Consciousness, its Alteration and Generation induced by Fictional Worlds Coline Joufflineau (Paris 1 / Paris8) Slow Times and Accelerated Transformations: to Read and to Meditate 12:45–13:45 Lunch 13:45–15:15 Duke Neurohumanities Summer School Student presentations 15:15–15:30 Coffee break 15:30–16:40 Meandering thoughts, streams of consciousness Jérôme Sackur (École des hautes études en sciences sociales / CNRS) Varieties of Access to the Stream of Consciousness: Descriptive Experience Sampling, Neurophenomenology and Automatic Writing Christof Diem (University of Innsbruck) “How Can I Return to Form, Now My Formal Thought Has Gone?” – Meandering Thought in Contemporary British Drama 16:40–16:50 Coffee break 16:50–18:00 Summoning the past, subverting the future through altered states of consciousness Christine Lehleiter (University of Toronto) Beyond Consciousness: Literary States of Memory Gilles Viennot (Université de Fayetteville) Novels from the Past: the Last Road Map Against Deathly Nonsense 18:00–18:30 Roundtable With Deborah Jenson and Leonard White (Duke University), Grazia Pulvirenti and Renata Gambino (Catania University) RÉSUMÉS DES PRÉSENTATIONS DISPONIBLES ICI .
↧
Flaubert, dernières publications sur le site du Centre Flaubert
Flaubert, dernières publications sur le site du Centre Flaubert, Centre Flaubert , université de Rouen, 2016. ÉDITIONS Flaubert, L’Éducation sentimentale , Michel Lévy, 1869. Édition numérique par Danielle Girard, pour le site Flaubert, 2016, avec un résumé du roman: http://flaubert.univ-rouen.fr/oeuvres/ES_1869.php Notes de Flaubert sur Plutarque et sur l’ouvrage Luxe des dames romaines Transcription et présentation par Atsuko Ogane d’un ensemble de notes prises par Flaubert vers 1857-1858 en vue de la rédaction de Salammbô .http://flaubert.univ-rouen.fr/manuscrits/plutarque.php ARTICLES INÉDITS Richard Brütting , «Amours et lieux dans Madame Bovary : recherches d’onomastique flaubertienne»: http://flaubert.univ-rouen.fr//article.php?id=46 Guillaume Cousin , «“Mon affaire est une affaire politique”: la Revue de Paris et le procès de Madame Bovary », communication au séminaire «Relire les classiques: Madame Bovary », Université de Rouen, 2 mars 2016: http://flaubert.univ-rouen.fr/article.php?id=43 Kayoko Kashiwagi , « Le Château des cœurs . Genèse et structure», version française de la présentation à Gustave Flaubert, Le Château des cœurs , grande féerie, traduction en japonais par Kayoko Kashiwagi du texte intégral avec toutes les illustrations, d’après l’édition originale de La Vie moderne (1880), Osaka University Press, 303 pages. Préface de Jeanne Bem: «Pour le lecteur japonais» (en japonais p.209-222, et en français, p.223-234): http://flaubert.univ-rouen.fr/article.php?id=44 François Lapèlerie , «“Là, tout n’est qu’ordre et beauté, Luxe, calme et volupté.” Salammbô dans la réclame de 1862 à nos jours»: http://flaubert.univ-rouen.fr/derives/sal_lapelerie_2016.pdf Pierre Macqueron , [ Souvenirs sur Flaubert ], 1951. Extraits d’une conférence inédite, communiqués par Jean-Luc Brière: http://flaubert.univ-rouen.fr/biographie/macqueron.php Tomoko Mihara , « Salammbô au croisement entre l’Antiquité et le moderne: la psychologie ou la fatalité»: http://flaubert.univ-rouen.fr/article.php?id=47 Steve Murphy , «Un plan sur la comète d’Yonville»: http://flaubert.univ-rouen.fr//article.php?id=45 MISE EN LIGNE DE PUBLICATIONS ANCIENNES Maxime Brenier de Montmorand , Éloge de Senard , discours prononcé le 28mars 1887, Paris, Alcan-Lévy, 1887. http://flaubert.univ-rouen.fr/article.php?id=42 Format pdf: http://flaubert.univ-rouen.fr/etudes/senard_brenier.pdf Colombine [Arthur de Boissieu] et Albert Wolf , Le Figaro , 21décembre 1862 [deux articles sur Salammbô ]: http://flaubert.univ-rouen.fr/etudes/salammbo/sal_wolf.php J. Félix , «Gustave Flaubert», discours à l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Rouen, 5août 1880. Extrait du Précis analytique des travaux de l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Rouen pendant l’année 1879-80 (p.5-32). [Document découvert par Marie-José Mainot, et saisi par Olivier Leroy, mars 2016.] http://flaubert.univ-rouen.fr/biographie/necro_felix.php Philippe Willemart , «Hérodias, le manuscrit, la psychanalyse et les sciences exactes», dans La chambre noire de l’écriture: Hérodias de Flaubert , Paratexte, 1996: http://flaubert.univ-rouen.fr/article.php?id=41
↧
Flaubert sans frontières : les traductions des oeuvres de Flaubert (Rouen)
Flaubert est l’un des écrivains les plus traduits dans le monde. Pendant deux ans, des chercheurs du monde entier ont alimenté une base de données sur les traductions de ses œuvres. Elle comprend actuellement 2400 références, et elle est consultable à l’adresse suivante: http://flaubert.univ-rouen.fr/jet/public/fsf/recherche.php .Ces chercheurs se sont donné rendez-vous à l’université de Rouen pour un colloque international, les jeudi 2 et vendredi 3juin, à la Maison de l’université du campus de Mont-Saint-Aignan. Le jeudi soir, Yves Chevrel prononcera une conférence à l’Alliance française, 80, bld de l’Yser, Rouen, à 20h 30. Programme en ligne: Colloque international 2-3 juin 2016, université de Rouen, Maison de l’université, Mont-Saint-Aignan Organisé par Florence Godeau (CERCC-ENS de Lyon, université de Lyon III) et Yvan Leclerc (CÉRÉdI, université de Rouen) Jeudi 2 juin 2016 Matin 9h Accueil 9h15 Propos de bienvenue par Jean-Claude Arnould, directeur du CÉRÉdI Présidence: Brigitte Le Juez 9h30 Éric Dayre (ENS Lyon), Conférence d’ouverture: «De la langue du faubourg de Carthage» 10h Florence Godeau (Lyon III) et Yvan Leclerc (Rouen): présentation du projet «Flaubert sans frontières» 10h30 Kalliopi Ploumistaki (Thessalonique, Grèce): «Flaubert re-traduit en grec» Pause 11h15 Arselène Ben Fahrat (Sfax, Tunisie): «Laréception des œuvres de Gustave Flaubert dans les pays arabes: traduire et adapter sans trahir?» 11h45 Emine Bogenç Demirel et Fulya Marmara (Istanbul, Turquie): «Les enjeux sociaux et politiques des traductions des œuvres de Flaubert en Turquie»; Lale Arslan Özcan: «Profil des maisons d'édition ayant publié les traductions des œuvres de Gustave Flaubert en Turquie», Pınar Güzelyürek Çelik: «Profil biobibliographique des traducteurs de Gustave Flaubert en Turquie» Après-midi Présidence: Robert Kahn 14h30 Alexandra Richter (Rouen): «Les stratégies éditoriales et les enjeux proprement littéraires des traductions de Flaubert en langue allemande» 15h Maaike Koffeman (Nijmegen Pays-Bas): «“Une rencontre presque physique.” Traduire Flaubert en néerlandais.» 15h30 Hans Färnlöf (Stockholm, Suède): «Un long fleuve tranquille – les traductions de Flaubert en Suède» Pause 16h15 Brigitte Le Juez (Dublin, Irlande): «La tentation de la reprise: traduction et réception de Flaubert en Irlande» 16h45 Giulia Marchina (Italie): « Trois contes traduit par trois poètes italiens: Sbarbaro, Raboni, Romano. Comparaison des traductions et recherche d’un rythme poétique» 20h30 Alliance française, 80, boulevard de l’Yser, Rouen Conférence d’Yves Chevrel: «Les œuvres traduites: objets de quelle(s) histoire(s)?» Vendredi 3 juin 2016 Matin Présidence: Éric Dayre 9h Lucia Amaral de Oliveira Ribeiro (São Paulo, Brésil): «Réflexions à partir d’entretiens avec des traducteurs de Flaubert au Brésil» 9h30 Carmen Ramirez Gomez (Séville, Espagne): «Traduction et réception de Flaubert dans la presse espagnole (XIX e-début XX e siècle)» 10h Felipe Moreno (Bogota, Colombie): «Les descriptions de Madame Bovary dans les traductions latino-américaines» Pause 10h45 Edi Zollinger (Munich): «Charbovari! – Schahbovarie!: Elisabeth Edl traduit Madame Bovary » (communication présentée par Florence Godeau) 11h15 Table ronde sur les premières pages de Madame Bovary , traduites en diverses langues. Animée par Anne-Laure Tissut et Miguel Olmos (Ériac) Pauline Doucet, agrégée d’espagnol; Anne-Marie Pugh, étudiante en Master 2 d’Anglais; Hélène Tessier, agrégée d´allemand et doctorante germaniste. Après-midi Présidence: Florence Godeau 14h Diana Rinciog (Ploiesti, Roumanie): «Problèmes des premières traductions de Flaubert dans la presse du XIXe siècle en Roumanie ( L’Époque et Le Contemporain ) – comparaison avec des éditions récentes pour les textes Hérodias et Salammbô (chapitre VIII)» 14h30 Tomoko Mihara (Gunma, Japon): «Deux stratégies de publication: Flaubert dans le Japon impérial (1889-1947) et dans le Japon de la haute croissance (1955-1973)» 15h Galyna Dranenko (Tchernivtsi, Ukraine): «Les implications poétiques et politiques des retraductions des œuvres de Gustave Flaubert en URSS» Pause 15h45 Jana Truhlarova (Bratislava, Slovaquie): «Le sort de Madame Bovary en Slovaquie. Trois traductions au XX esiècle» 16h15 Tomasz Swoboda (Gdansk, Pologne): «Retours à Emma. Traduire Flaubert en polonais» 16h45 Conclusion 18h15 Musée Flaubert et d’histoire de la médecine, Rouen «Il s’appellerait Georges…», pièce en trois actes, continuation de Madame Bovary , écrite et interprétée par l’Atelier théâtre du Musée Flaubert et d’histoire de la médecine. Visite guidée du Musée Flaubert et d’histoire de la médecine, par Sophie Demoy, conservateur.
↧
"Élections Paris 13: unefarce", par P. Dubois ( Histoires d'universités , mai 2016)
À Paris 13, le vice-président de l’équipe de direction sortante, présidée par Jean-Loup Salzmann, devrait être intronisé président lors du prochain CA, en dépit du fait qu’il a été battu par son adversaire Christophe Fouqueré dans les collèges des personnels. "Élections Paris 13: unefarce" Par PierreDubois, Histoires d'universités , 13 mai 2016. Suite de la chronique du 6 avril, Inénarrable Paris 13 .Pour le CA, pléthore de candidatures de personnalités extérieures issues de la société civile .30 candidatures reçues : 9 personnes assumant des fonctions de direction générale d’une entreprise, 4 représentants des organisations représentatives de salariés, 12 représentants d’une entreprise employant moins de cinq cents salariés, 4 représentants d’un établissement d’enseignement secondaire, 1 représentant du Crous de Créteil. Au CA du 3 mai, les 6 étudiants élus ont tous voté pour la liste de personnalités extérieures, constituée et présentée par Jean-Pierre Astruc, candidat à la présidence de l’université. Unanimité chez les élus étudiants (ensemble UNEF et UNI), ça ne s’est jamais vu ailleurs ! Lire la suite .
↧
↧
Habiter en étranger: quand le récit contemporain interroge notre rapport au monde (Paris)
Habiter en étranger: quand le récit contemporain interroge notre rapport au monde Vendredi 17 juin 2016 ,Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 Journée d’études organisée par Chloé Chouen-Ollier etSamuel Harvet, avec le soutien de l'équipe duCERACC, de THALIM et de l'École doctorale 120 de Paris 3 9h15 Accueil des participants 9h30 Mot d’ouverture : Chloé Chouen-Ollier, Samuel Harvet (Sorbonne Nouvelle) L’écriture à l’épreuve d’un monde bouleversé 9h45 Anne Cousseau (Université de Lorraine) «S’approcher de Lampedusa: l’écriture migrante de Maylis de Kerangal dans À ce stade de la nuit » 10h15 Claire Colard et Zoé Courtois (ENS -EHESS / Paris IV) «Habiter chez soi en étranger» 10h40 Discussion et pause-café L’identité au prisme de l’habiter 11h15 Stéphane André ( Sorbonne Nouvelle) « Suite à l'hôtel Crystal : la chambre obscure d'Olivier Rolin. Autoportrait à la faveur d'undépaysement géographique, fictionnel et intertextuel » 11h40 Tiphaine Samoyault (Sorbonne Nouvelle) Titre à préciser 12h30 Déjeuner Interroger les frontières 14h30 Myriam Suchet et Sarah Mekdjian (Sorbonne Nouvelle / Université de Grenoble) «Travaux en cours - pour une univerCité à vivre» 14h55 Aurore Labadie (Sorbonne Nouvelle) «Habiter en aliéné : roman d'entreprise et dévoilement des nouveaux espace-temps del'aliénation» 15h20 Johan Faerber( Sorbonne Nouvelle) «La grande étrangère ou la langue unanime du monde dans Autour du monde de LaurentMauvignier» 15h45 Discussion et pause-café 16h15 Laurent Mauvignier – Entretien Modération: Chloé Chouen-Ollier et Samuel Harvet 17h30 Clôture de la journée Adresse: Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, site Sorbonne, Salle Max Milner, 2 e étage escalier C,couloir de gauche, 17 rue de la Sorbonne, Paris, Métro Cluny Sorbonne. Organisation: Chloé Chouen-Ollier (docteure en Littérature française, Sorbonne Nouvelle),Samuel Harvet (doctorant en Littérature française, Sorbonne Nouvelle) Du mouvement, tout ce mouvement, il a du mal à comprendre. Comme s’il était étranger dans un pays dont la langue lui serait aussi inconnue que les coutumes. (Laurent Mauvignier, Des hommes )«Habiter en étranger»: l’expression semble paradoxale, car habiter suggère une familiarité avec l’espace vécu. Mais la littérature contemporaine ne cesse de défaire ce lien entre le sujet et son ancrage territorial, pour nous rappeler la fragilité de nos constructions identitaires, les illusions du chez-soi comme celles du voyage. L’individu qui habite un territoire perçu comme étranger fait face à diverses formes d’altérité: étranger à sa patrie, lorsque l’individu est exilé, déterritorialisé, contraint à migrer ou parti de son plein gré. Étranger aux autres, lorsqu’il n’est plus en adéquation avec le monde qui l’entoure. Étranger à soi, lorsque le moi réalise la césure qui l’habite, lorsqu’il ne parvient pas à réaliser cette «herméneutique du sujet» dont parle Michel Foucault. Dans le sillage de la pensée postcoloniale, il s’agit d’envisager, à travers différents prismes, les manières d’habiter en étranger dans le récit de langue française des années 1990 à nos jours. La migration d’un endroit à un autre, qui trouve une résonance toute particulière de nos jours, pose la question de la translation et des changements linguistiques, sociaux, culturels qu’elle peut entrainer; de cette traversée, le récit contemporain se fait l’écho, consignant à travers l’espace de la page ce qui ne peut oune veut être circonscrit. Habiter en étranger serait donc faire une expérience, au sens étymologique: il s’agit d’éprouver, de se mettre en danger, tant sur le plan diégétique que scriptural. Par son travail sur le langage et sur les représentations qu’il véhicule, la littérature contribue à déconstruire les discours essentialistes sur l’étranger et les visions simplistes qui méconnaissent la diversité de ses situations sociales, de l’émigration à l’exil ou à l’expatriation. Le récit, en tant que narration de trajectoires toujours singulières, constitue un espace privilégié pour rendre compte des modalités très diverses de cette expérience. Au-delà d’un habitat, c’est d’abord l’esprit d’un chez-soi que l’étranger tente de (se) recréer en habitant un nouveau milieu. Son itinéraire se fait alors quête, conquête d’un territoire qui pose tout à la fois la question de l’occupation et celle de la possession. Avec l’essor de la mondialisation et les transformations des paysages urbains contemporains, le regard porté sur une ville ou sur un pays n’est plus le même; il est transformé, déporté dans un ailleurs depuis lequel se tisse un écart entre ici et là-bas. Cette modification du centre de gravité engendre une représentation de l’espace différente, que cette géographie soit mentale ou réelle. L’ancrage spatial du récit permet d’explorer le rapport particulier que l’individu étranger entretient avec son nouveau milieu, selon un large spectre qui peut aussi bien faire du territoire d’arrivée un «non-lieu de l’exil» (Alexis Nouss 1) qu’un autre chez-soi. L’histoire personnelle de l’étranger s’apparente ainsi à un récit d’apprentissage, suivant un itinéraire qui complexifie ses représentations initiales. Cette proximité entre narration et délocalisation repose sur des affinités profondes: habiter en étranger se présente comme un réajustement continuel, par lequel l’individu apprend à reformuler ses repères sociaux et culturels dans le langage du milieu d’arrivée. Il s’agit d’étudier les récits qui explorent ce processus à travers des formes de vie singulières, en prêtant attention aux manières dont ces écritures problématisent et déconstruisent certaines représentations convenues de l’identité migrante ou du pathos de l’exilé. Ainsi, certains récits contemporains mettent en avant la question de la trace mémorielle du lieu quitté, aussi bien sur le mode d’une rupture salutaire que d’une perte nostalgique. Ces œuvres privilégient une manière d’habiter en étranger comme interaction entre identités culturelles d’origine et d’arrivée, et comme manière pour l’individu de négocier, au quotidien, ses appartenances multiples. Une autre série d’œuvres, rejetant l’idée d’une «identité-racine» (Glissant), valorise au contraire une conception transnationale de l’altérité, qui généralise l’expérience de l’étranger. L’ouverture de la littérature sur un monde en perpétuel mouvement pose également la question de la langue, des langues, et des manières de nommer. Le bouleversement de la syntaxe narrative, la polyphonie, le choix d’une langue première ou seconde, sont autant de manières d’exprimer ces tensions propres à l’acte d’habiter - l’épreuve de l’étranger ne faisant que rendre plus visible et sensible «l’hybridité culturelle» (Alfred Schütz 2) que chacun porte en soi. L’écriture permet aussi de contrer la «désignation politique» (Guillaume Le Blanc 3) potentiellement discriminante impliquée par l’utilisation du vocabulaire de l’étranger, et d’ouvrir la voie, pour le sujet vivant hors de son milieu originel, à une réappropriation de sa situation. Si l’écrivain est celui qui «invente dans la langue une nouvelle langue, une langue étrangère […] » ainsi que le formule Deleuze à propos de Proust, il apparaît ainsi comme celui qui peut imaginer et façonner une nouvelle façon d’habiter. 1Alexis Nouss, La Condition de l’exilé. Penser les migrations contemporaines, Paris, Maison des sciences de l’homme, 2015 2Alfred Schütz, L’Étranger (trad. Bruce Bégout), Paris, Allia, 2003 3Guillaume Le Blanc, Dedans, dehors: la condition d’étranger , Paris, Seuil, 2010
↧
Le mécénat littéraire aux XIXe et XXe siècles (Paris, Nanterre)
Le mécénat littéraire aux XIXe et XXe siècles Mercredi 22 juin 2016 A l’Institut national d’histoire de l’art, salle Walter Benjamin (6 Rue des Petits Champs ou 2 rue Vivienne, 75002 Paris) 14 h-14h15- Accueil des participants 14h15-14-30- Allocution d’ouverture I. Le Mécénat littéraire au XIXe siècle Présidence : Paolo TAMASSIA et Alejandro CANSECO-JEREZ 14h30 - 14h50 ̶ Anne JOURDAN (Université d’Amsterdam ) — Le mécénat littéraire de Napoléon. 14h50 - 15h10 ̶ Antonietta Angelica ZUCCONI ( Museo Napoleonico de Rome, Université «La Sapienza» de Rome ) - Les princes Bonaparte mécènes des gens de lettres sous le Second Empire. 15h10 - 15h30 ̶ Sébastien ROZEAUX (Casa de Velasquez, Madrid ) — Les ambitions contrariées du mécénat impérial au Brésil: la réception critique de l’épopée de Gonçalves de Magalhães, A Confederação dos Tamoyos (1856). 15h30 - 15h50 ̶ Pause-café 15h50 - 16h10 ̶ Andrea SCHELLINO (Université Paris-Sorbonne) — «Et charmer les loisirs d'un Mécène ou d'un prince.» Baudelaire et le mécénat cruel. 16h10 - 16h30 ̶ Vincent LAISNEY (Université Paris Ouest Nanterre La Défense) et Anthony GLINOER (Université de Sherbrooke) — Le mécénat littéraire de 1800 à 1914. 16h30 - 17h ̶ Débat et pause-café 17h ̶ Conférence de Mme Carole WEISWEILLER 18 h - 19 h ̶ Cocktail Jeudi 23 juin 2016 A l'université Paris Ouest Nanterre La Defense (200 avenue de la République, 92001, Nanterre) II. De la Belle-Epoque à l’entre-deux-guerres: figures de mécènes littéraires (1) Présidence: David WORRAL et Bruno CURATOLO 9h30 - 9h50 ̶ Roland KAMZELAK (Archives littéraires allemandes de Marbach ) — Le comte Harry Kessler. 9h 50 - 10h10 ̶ Paolo TAMASSIA (Université de Trente) — Marguerite Caetani (princesse de Bassiano) et les revues Commerce et Botteghe Oscure .10 h10 - 10h30 ̶ Masayuki TSUDA (Université d'Osaka ) — Aline Mayrisch et les revues La Nouvelle Revue Française, Hermès, Maß und Wert .10h30 - 10h50 ̶ Pause-café 10h50 - 11h10 ̶ Alejandro CANSECO-JEREZ (Université de Lorraine) — Eugenia Errazuriz, mécène de Blaise Cendrars. 11h10 - 11h30 ̶ Anne FOGARTY (UCD Research Centre for James Joyce Studies, Dublin ) — James Joyce et Harriet Shaw Weaver. 11h30 - 12h ̶ Débat 12 h - 14 h ̶ Déjeuner III. De la Belle-Epoque à l’entre-deux-guerres: figures de mécènes littéraires (2) Présidence: Sylvie DUCAS et Anne JOURDAN 14h - 14h20 ̶ Céline MALTERE (Agrégée de lettres classiques) — Violette Leduc et ses mécènes (entre autres Jacques Guérin). 14h20 - 14h40 ̶ Maxime MOREL (Université Paris I- Panthéon-Sorbonne) — Mécène et faiseur d’histoires, Jacques Doucet aux origines de l’historiographie surréaliste (1921-1929). 14h40 - 15h ̶ Julie VERLAINE (Université Paris I-Panthéon Sorbonne) — Mécènes des arts et des lettres dans l'Entre-deux-guerres : portraits croisés de femmes. 15h - 15h20 ̶ Anne STRUVE-DEBEAUX (Université Paris Ouest Nanterre La Défense) — Portrait du mécène littéraire de la Belle Epoque à l’entre-deux-guerres. 15h-20 - 15 h50 ̶ Débat 17h -19h ̶ Visite des appartements privés de Coco Chanel. Avec le soutien du Patrimoine Chanel. Vendredi 24 juin 2016 A l’université Paris Ouest Nanterre La Defense (200 avenue de la République, 92001, Nanterre) IV. Capitalisme et mécénat littéraire Présidence: Vincent LAISNEY et Anne FOGARTY 9h50 - 10h10 ̶ David WORRALL (Université de Notthingham Trent, Raymond Williams Centre for Recovery Research ) ̶ Raymond Williams, le mécénat et William Blake. 10h10 - 10h30 ̶ Marc VERON (Université Paris Ouest Nanterre La Défense) — L'actionnariat des sociétés liées au théâtre (1864-1914). 10h30 - 10h50 ̶ Pause-café 10h50 - 11h10 ̶ Myriam BOUCHARENC (Université Paris Ouest Nanterre La Défense) — Quand le commerce et l'industrie prennent le relais des mécènes : évolution du mécénat au siècle de la publicité. 11h10 - 11h30 ̶ Isabelle ANTONUTTI (Université Paris Ouest La Défense Nanterre) — Capitalisme et mécénat littéraire, à l’aune des prix Del Duca. 11h30 - 12h – Débat 12 h - 14 h ̶ Déjeuner V. Le mécénat littéraire institutionnel aujourd’hui. Présidence: Myriam BOUCHARENC et Marc VERON 14h - 14h20 ̶ Sylvie DUCAS (Université Paris Ouest Nanterre La Défense) — Le prix Goncourt. 14h20 - 14h40 ̶ Bruno CURATOLO (Université de Franche-Comté ) — «Un aspect du mécénat institutionnel: le Grand Prix du roman de l'Académie Française. De la gloire éphémère à la reconnaissance pérenne.» 14h40 - 15h -̶ Pause-café 15h - 15h20 ̶ Dominique BLANCHECOTTE (Fondation de la Poste) – Le mécénat littéraire de la Fondation de la Poste. 15h-20 - 15 h50 ̶ Flavie DEPREZ (Consultante) – Les mécénats littéraires des fondations d'entreprise et leur interaction avec le public. 15h50 - 16h20 ̶ Débat Clôture.
↧
R.-Cl.Breitenstein, La Rhétorique encomiastique dans les éloges collectifs de femmes imprimés de la première moitié du XVI e siècle
Renée-Claude Breitenstein, La Rhétorique encomiastique dans les éloges collectifs de femmes imprimés dans la première moitié du XVIe siècle (1493-1555) Hermann, coll. "Les collections de la République des Lettres",2016. EAN13: 9782705692315 348 p. - 34 € Présentation : Cette étude vise à définir les modalités argumentatives de la rhétorique encomiastique dans les éloges collectifs de femmes imprimés qui firent florès dans la première moitié du XVI e siècle, à travers les recueils de femmes illustres (qui célèbrent des figures exceptionnelles) et les apologies du sexe féminin (qui défendent l’ensemble des femmes par la louange). La perspective rhétorique adoptée s’appuie sur les manuels de composition et les traités de rhétorique anciens, ainsi que sur les théories récentes de l’argumentation. Ce livre montre comment –par quelles voies de l’invention et par quels dispositifs formels– s’élabora un discours de célébration à propos de la femme, alors même que cette dernière réunit des discours contradictoires. Il entend en outre mettre en évidence un aspect méconnu de l’éloge: sa fonction de redéfinition de l’objet célébré; il propose, dans une perspective de poétique des genres, une réflexion sur la rhétorique épidictique comme un espace propice à l’exploration d’enjeux éthiques, tels que la mise en vedette de figures féminines singulières, le façonnement de la persona auctoriale ou encore l’introduction d’objectifs secondaires porteurs de valeurs nouvelles. Au-delà de la volonté de célébrer les femmes, les éloges collectifs deviennent le creuset d’enjeux sous-jacents: louer les femmes fournit souvent un truchement pour parler d’autre chose. L'auteur : Renée-Claude Breitenstein est professeure agrégée au Département de langues, littératures et cultures modernes de l’université Brock (Ontario, Canada), où elle enseigne dans la section d’études françaises depuis 2009. Elle s’intéresse à la rhétorique et à l’argumentation, à la sociologie de la littérature, ainsi qu’à l’histoire du livre. Ses recherches les plus récentes portent sur les notions de public et de publication dans les éloges collectifs de femmes du XVI e siècle français (recueils de femmes illustres et apologies du sexe féminin), d’un point de vue discursif et matériel. Sommaire Remerciements ................................................................................................ VI Liste des abréviations ..................................................................................... VII Introduction ........................................................................................................ 1 PRÉAMBULES Chapitre 1. La rhétorique de l’éloge ................................................................ 17 I. Historique du genre épidictique .................................................................... 17 II. La représentation de l’homme dans l’éloge : enjeux éthiques et exemplarité.. 29 III. Les extrêmes comme « logique »de la rhétorique épidictique .................. 33 Chapitre 2. L’éloge et la femme :un porte-à-faux discursif ............................. 37 I. La femme à la croisée de discours discordants :problème de définition ..... 37 II. De l’amplification à la disputeà la « Querelle des femmes » ...................... 42 PREMIÈRE PARTIE : INVENTIO Chapitre 3. Les modalités de la prise de parole .............................................. 53 I. Aspects théoriques ....................................................................................... 53 II. Analyses textuelles ...................................................................................... 61 Chapitre 4. Les topoï des éloges collectifs de femmes .................................115 I. Les lieux de la personne ............................................................................. 117 II. Les principaux arguments des éloges collectifs de femmes..................... 142 DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIO Chapitre 5. La dispositio des éloges collectifsde femmes ........................... 169 I. Vers une définition de la dispositio : la notion de recueil ........................... 170 II. Éloge collectif et éloge individuel : la redistribution de la louange entre singulier etpluriel ........................................................................................................ 172 Chapitre 6. Les enjeux de la compilation ...................................................... 207 I. Autour d’Henri Corneille Agrippa ............................................................... 209 II. Émergence de la figure de l’auteur ........................................................... 236 Conclusion .................................................................................................... 277 Liste des chapitres ayant fait l’objet d’une publication ........................................................................................... 289 Bibliographie .................................................................................................. 291 Index des personnes, personnageset personnifications .............................. 317
↧