La faculté des Lettres et des Sciences Humaines, le Laboratoire: Langues, Cultures et Communication, et le Laboratoire: Littérature Générale et Comparée et Interculturalité organisent un colloque international le 13 et 14 novembre 2015 sous le thème: Voix et voies de l’interculturel: Carrefour entre littérature, traduction, didactique et arts. Lieu du colloque: Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Oujda. Royaume du Maroc. Nul doute que la question interculturelle est passée depuis quelque temps au premier plan de toutes les préoccupations. Aborder cette question, à notre sens, ne peut se faire sans interroger le rapport entre cultures puisque l’interculturel est construit sur la base du culturel. Ce rapport, ne l’oublions pas, peut être pris comme donnée positive car il libère le déterminisme des entités considérées comme figées en les transformant en structures ouvertes. L’interculturel ne se fait jamais sans conflits et contradictions car il a comme arrière plan des représentations et des valeurs différentes que nourrissent les porteurs de cultures. Hommes de lettres, traductologues, philosophes, pédagogues, cinéastes, artistes sont conscients de cet état de fait et agissent en conséquence sur les mentalitésfacilitant ainsi la compréhension et la communication interculturelle entre les uns et les autres. La recrudescence de la violence sous tous ses aspects, la montée des discours qui brandissent l’étendard de la haine de l’autre et les atteintes à la liberté d’expression et de religion nous font découvrir que ces malentendus ont souvent des soubassements culturels. C’est que de plus en plus les sociétés se referment sur elles-mêmes en ce siècle, le prétendu dialogue des civilisations et des religions est devenu un mirage voire une illusion qui se moque d’une humanité de plus en plus hostile à toute tentative de rapprochement. L’interculturel se laisse appréhender avec tout autant de difficultés; l’enchevêtrement du social, du politique et du culturel le rendent un exercice périlleux. Par ailleurs, La mondialisation donne à l’interculturel un tour médiatique au point que l’on peut se demander si l’on ne fait pas face à un phénomène de mode plutôt qu’une nécessité. Le texte littéraire renferme souvent une représentation du monde et véhicule des valeurs partagées d’une culture à une autre. La littérature permet une confrontation entre identité/ altérité et offre une pluralité de visions du monde. Elle est souvent un point d’appui pour l’étude des représentations des porteurs de cultures. Dans ce sens, le traducteur en tant qu’ambassadeur culturel participe à la rencontre du Moi avec l’Autre dans sa différence. Au delà des contraintes méthodologiques et philosophiques, la traduction est la preuve permanente d’une réalité interculturelle, elle est le baromètre des échanges et interactions entre les cultures, elle est l’outil avec lequel se concrétise le projet interculturel ouvert, respectueux et basé sur la compréhension mutuelle entre des individus et des groupes. La question interculturelle présente de même une dimension didactique. En effet, l’enseignement/apprentissage des langues s’avère d’une importance majeure non seulement pour développer des compétences langagières mais également des compétences interculturelles. Ces dernières nous permettent de s’ouvrir sur de nouvelles cultures et d’acquérir des savoirs riches et variés. L’enseignement/apprentissage des langues garantit la mise en place d’un multilinguisme équilibré facilitant la rencontre entre des systèmes langagiers différents. A travers l’apprentissage des langues, une communication interculturelle s’instaure permettant la gestion du rapport entre cultures et la réduction des tensions qui peuvent avoir lieu. Dans ce contexte didactique on ne peut occulter le rôle des technologies de l’information et de la communication éducatives notamment pour favoriser l’ouverture sur d’autres cultures. De ce fait, elles aident à développer une conscience interculturelle chez les apprenants leur permettant d’accéder à des univers culturels éloignés et élargir leurs représentations. Au-delà de la littérature, de la traduction, de l’enseignement des langues étrangères, le cinéma se veut pour sa part un outil précieux de médiation interculturelle étant donné qu’il permet de dialoguer, de témoigner, de raconter des histoires sur le différent et le semblable, ici et ailleurs. Le cinéma a cette possibilité de booster le dialogue interculturel. D’un film à l’autre, se constitue pour le pédagogue un formidable terrain d’observation d’un processus interculturel, c’est-à-dire d’un processus d’observation de ce qui se passe quand deux cultures différentes se trouvent en interférence, s’interpénètrent pour finir par constituer un entre- deux. Ce colloque pluridisciplinaire offrira donc l'occasion d'analyser, d’échanger et de partager des expériences interculturelles que le monde actuel est en train de vivre dans un contexte souvent marqué par les conflits notamment d’ordre culturel. Nous aspirons également à ce que cette première rencontre sur l’interculturel soit au-delà des échanges cognitifs, un message d’espoir et de paix. Pour ce faire, de nombreuses pistes de réflexion peuvent être empruntées: 1.Le texte littéraire comme vecteur de l'interculturel. 2.La traduction comme espace d'échange entre les cultures. 3.L'enseignement/ apprentissage des langues étrangères et l'acquisition des compétences interculturelles. 4.Les TICE comme moyen de rapprochement de cultures. 5.Pédagogie interculturelle et dialogue des cultures. 6.Le cinéma et les enjeux inetrculturels. Les propositions de communication (un titre, un abstract de 500 mots maximum, et 5 mots-clés en français, arabe ou en anglais) seront à envoyer pour le 20 septembre 2015, délai de rigueur, à l'adresse suivante: interculturelcolloque@gmail.com L’examen des propositions se fera le 30 septembre, le retour concernant les propositions reçues se fera la première semaine d’octobre 2015. L’envoi des communications complètes retenues est prévu pour le 20 octobre 2015. Les communications ne devront pas excéder 20 minutes afin que chaque intervention puisse donner lieu à une discussion ouverte. Les langues des communicants seront le français, l’arabe ou l’anglais. Une publication des actes du colloque est envisagée. Comité scientifique par ordre alphabétique: Abdellah Jarhnine, FLSH, Oujda. ; Abdelkhaleq Jayed, Université Ibn Zohr, Agadir. ; Afaf Zaid, FLSH, Oujda. ; Aicha Abdelouahed, FLSH, Oujda. ; Aminata Cecile MBaye, Université Bayreuth, Allemagne.; Awatif Beggar, Université Moulay Ismaël, Meknès.; Charles Bonn, Université Lyon 2.; Delphine Grass, Université Lancaster, Royaume-Uni. ; Françoise Naudillon, Université Concordia, Montréal, Canada. ; Jaouad Serghini, FLSH, Oujda. ; Maroua El Naggare, Université Bayreuth, Allemagne. ; Mohammed Kembouche, FLSH, Oujda. ; Mustapha Tijjini, FLSH, Oujda. ; Ouafae Tangi, FLSH, Oujda. ; Papa Samba Diop, Université Paris-Est Créteil. ; Souad Masmoudi, FLSH, Oujda. ; Thierno Ibrahima Dia, Université Bordeaux Montaigne. Comité d’organisation: Mohammed Kembouche, Abdellah Jarhnine, Aicha Abdelouahed, Mustapha Tijjini, Souad Masmoudi, Jaouad Serghini. RESPONSABLES: Jaouad Serghini, FLSH, UMP ; Mustapha Tijjini, FLSH, UMP ; ADRESSE : Oujda-Maroc.
 Sommaire, RHLF, 2015, n°2 (juin 2015) NicolasLe Cadet: «Beuveurs tresillustres, et vous verolez tresprecieux»: Rabelais et les anagnostes SabineBiedma: Comment composer avec la polygraphie? L’œuvre de Guillaume Colletet (1616-1659) LucianoPellegrini: Épreuves d’enfance. La poésie de Victor Hugo de 1815 à 1817 Jean-LouisBenoît: Pour une relecture de Génie de Rimbaud StéphaneIschi: Une énigme littéraire: le comte Didier de Chousy LucaBarbieri: Ce qu’un arbre veut dire: lecture du Banyan de Paul Claudel MaudGonne: Recyclages, croisements et transferts dans l’œuvre de Georges Eekhoud SylvieVignes: Pierre Michon et le «désir de prodige» AudreyCamus: Choir avec Chevillard : la lecture comme exercice utopique Notes et documents WendyPrin-Conti: Sur les traces de Noir et Blanc , pièce de jeunesse inédite de Jean Cocteau JeanyvesGuérin: Correspondance d’Audiberti et de Jacques Lemarchand Comptes rendus In memoriam Table des matières 2014
Sommaire, RHLF, 2015, n°2 (juin 2015) NicolasLe Cadet: «Beuveurs tresillustres, et vous verolez tresprecieux»: Rabelais et les anagnostes SabineBiedma: Comment composer avec la polygraphie? L’œuvre de Guillaume Colletet (1616-1659) LucianoPellegrini: Épreuves d’enfance. La poésie de Victor Hugo de 1815 à 1817 Jean-LouisBenoît: Pour une relecture de Génie de Rimbaud StéphaneIschi: Une énigme littéraire: le comte Didier de Chousy LucaBarbieri: Ce qu’un arbre veut dire: lecture du Banyan de Paul Claudel MaudGonne: Recyclages, croisements et transferts dans l’œuvre de Georges Eekhoud SylvieVignes: Pierre Michon et le «désir de prodige» AudreyCamus: Choir avec Chevillard : la lecture comme exercice utopique Notes et documents WendyPrin-Conti: Sur les traces de Noir et Blanc , pièce de jeunesse inédite de Jean Cocteau JeanyvesGuérin: Correspondance d’Audiberti et de Jacques Lemarchand Comptes rendus In memoriam Table des matières 2014
 Sommaire, RHLF, 2015, n°2 (juin 2015) NicolasLe Cadet: «Beuveurs tresillustres, et vous verolez tresprecieux»: Rabelais et les anagnostes SabineBiedma: Comment composer avec la polygraphie? L’œuvre de Guillaume Colletet (1616-1659) LucianoPellegrini: Épreuves d’enfance. La poésie de Victor Hugo de 1815 à 1817 Jean-LouisBenoît: Pour une relecture de Génie de Rimbaud StéphaneIschi: Une énigme littéraire: le comte Didier de Chousy LucaBarbieri: Ce qu’un arbre veut dire: lecture du Banyan de Paul Claudel MaudGonne: Recyclages, croisements et transferts dans l’œuvre de Georges Eekhoud SylvieVignes: Pierre Michon et le «désir de prodige» AudreyCamus: Choir avec Chevillard : la lecture comme exercice utopique Notes et documents WendyPrin-Conti: Sur les traces de Noir et Blanc , pièce de jeunesse inédite de Jean Cocteau JeanyvesGuérin: Correspondance d’Audiberti et de Jacques Lemarchand Comptes rendus In memoriam Table des matières 2014
Sommaire, RHLF, 2015, n°2 (juin 2015) NicolasLe Cadet: «Beuveurs tresillustres, et vous verolez tresprecieux»: Rabelais et les anagnostes SabineBiedma: Comment composer avec la polygraphie? L’œuvre de Guillaume Colletet (1616-1659) LucianoPellegrini: Épreuves d’enfance. La poésie de Victor Hugo de 1815 à 1817 Jean-LouisBenoît: Pour une relecture de Génie de Rimbaud StéphaneIschi: Une énigme littéraire: le comte Didier de Chousy LucaBarbieri: Ce qu’un arbre veut dire: lecture du Banyan de Paul Claudel MaudGonne: Recyclages, croisements et transferts dans l’œuvre de Georges Eekhoud SylvieVignes: Pierre Michon et le «désir de prodige» AudreyCamus: Choir avec Chevillard : la lecture comme exercice utopique Notes et documents WendyPrin-Conti: Sur les traces de Noir et Blanc , pièce de jeunesse inédite de Jean Cocteau JeanyvesGuérin: Correspondance d’Audiberti et de Jacques Lemarchand Comptes rendus In memoriam Table des matières 2014
 Images d’auteurs. De la fabrique de soi au façonnement de l’autre Jeudi 21 et vendredi 22 mai 2015 Université de Lausanne, Extranef, salle 110 Colloque international organisé en partenariat par la Formation doctorale interdisciplinaire de la Faculté des lettres, la Section de français (UNIL) et le groupe MDRN (KU Leuven) Org. resp. : Prof. Jérôme Meizoz (UNIL) et Prof. David Martens (KU Leuven) Ce colloque s'inscrit dans le cadre des recherches du groupe MDRN (www.mdrn.be) de l'Université de Louvain (KU Leuven), notamment dans le Pôle d'attraction interuniversitaire Literature and Media Innovations (lmi.arts.kuleuven.be), financé par la Politique scientifique fédérale belge (www.belspo.be), ainsi qu'au sein du projet de recherche « La Fabrique du patrimoine littéraire », financé par le FWO (Fonds de la recherche scientifique, Flandre). PROGRAMME Jeudi 21 mai 2015 8h30-8h45 : Introduction Jérôme MEIZOZ, UNIL, & David MARTENS, KU Leuven - MDRN 8h45-9h30 : Dominique M AINGUENEAU , Univ. Paris-Sorbonne, Fabrique de soi et image d’auteur : la paratopie deJosé-Maria de Heredia 9h30-10h10 : Maël G OARZIN , UNIL & EPHE, Paris, Plotin par lui-même et Plotin par Porphyre. L’image de Plotindans l’introduction de Porphyre aux Ennéades 10h10-10h30 Pause 10h30-11h10 : Laurence D AUBERCIES , Univ. de Liège, La parodie dramatique : une mise en abyme déformante del’identité auctoriale ? Le cas de l’image voltairienne dans Tancrède jugée par ses soeurs (1760) 11h10-11h50 : Joëlle L ÉGERET , UNIL, Histoire(s) de famille. (Im)postures d’auteurs dans les Kinderund Hausmärchen, gesammelt durch die Brüder Grimm 11h50-12h30 : Fanny G UEX , UNIL, Entre la disciple des maîtres de l’Inde et l’exploratriceintrépide : l’image d’Ella Maillart12h30-14h15 Pause-repas 14h15-15h00 : Michel L ACROIX , UQAM, Montréal, Images d’auteur et images de groupe : négociations et usagesdans les collections de biographies illustrées 15h00-15h40 : Mathilde L ABBÉ , Univ. Sorbonne Nouvelle –Paris 3, Dialogue de l’écrivain et du critique dans les collections patrimoniales« Poètes d’aujourd’hui » et « Écrivains de toujours » 15h40-16h20 : Marcela S CIBIORSKA , KU Leuven – MDRN, Les Albums de la Pléiade : le patrimoine littéraire en images 16h20-16h40 Pause 16h40-17h20 : Marie-Pier L UNEAU , Univ. de Sherbrooke, « X, dans son verger du Mont-St-Hilaire ; Y, au cours d’unvoyage aux Îles Mingan » : la représentation de l’écrivainquébécois dans la collection Écrivains canadiens d’aujourd’hui (1963-1975) 17h20-18h00 : Sylvestre P IDOUX , UNIL, Image éditoriale de l’auteur : le cas de Blaise Cendrars Vendredi 22 mai 2015 8h30-9h15 : Ruth A MOSSY , ADARR, Univ. de Tel-Aviv, Écrits posthumes, intimité de l’homme et image d’auteur :le cas de Roland Barthes 9h15-9h55 : Guillaume W ILLEM , KU Leuven - MDRN & Univ.de Louvain, Louvain-la-Neuve, « Si j’ai une légende, je n’y suis pour rien ! » Les entretiensd’Ostende de Michel de Ghelderode de la radio au livre 10h00-10h20 Pause 10h20-11h00 : Fanny L ORENT , Univ. de Liège, Alain Robbe-Grillet face à l’entretien journalistique : para doxes 11h00-11h40 : Galia Y ANOSHEVSKY , ADARR, Univ. Bar-Ilan, De l’image d’auteur à l’image du patrimoine culturel et national : les archives du XXe siècle de Jean José Marchand etles recueils d’entretiens de Jean Royer 11h40-13h45 Pause-repas 13h45-14h25 : Marie-Clémence R ÉGNIER , Univ. Sorbonne Nouvelle – Paris 3, « Dans le silence du cabinet ». De Gustave Flaubert à l’« ermitede Croisset » 14h25-15h05 : Claude M EYER , UNIL, Le canotier, l’aliéné et l’artiste vénéré. Maupassant, entre auto ethétéro-représentation 15h05-15h25 Pause 15h25-16h05 : Véronique R OHRBACH , UNIL, Le vedettariat de l’écrivain : Simenon vu par ses lecteurs 16h05-16h45 : Matthias DE J ONGHE , Univ. de Louvain,Louvain-la-Neuve & KU Leuven, Pierre Guyotat. Du poète maudit au moi spectral. Évocationdiachronique d’une posture auctoriale Télécharger le programme en PDF...
Images d’auteurs. De la fabrique de soi au façonnement de l’autre Jeudi 21 et vendredi 22 mai 2015 Université de Lausanne, Extranef, salle 110 Colloque international organisé en partenariat par la Formation doctorale interdisciplinaire de la Faculté des lettres, la Section de français (UNIL) et le groupe MDRN (KU Leuven) Org. resp. : Prof. Jérôme Meizoz (UNIL) et Prof. David Martens (KU Leuven) Ce colloque s'inscrit dans le cadre des recherches du groupe MDRN (www.mdrn.be) de l'Université de Louvain (KU Leuven), notamment dans le Pôle d'attraction interuniversitaire Literature and Media Innovations (lmi.arts.kuleuven.be), financé par la Politique scientifique fédérale belge (www.belspo.be), ainsi qu'au sein du projet de recherche « La Fabrique du patrimoine littéraire », financé par le FWO (Fonds de la recherche scientifique, Flandre). PROGRAMME Jeudi 21 mai 2015 8h30-8h45 : Introduction Jérôme MEIZOZ, UNIL, & David MARTENS, KU Leuven - MDRN 8h45-9h30 : Dominique M AINGUENEAU , Univ. Paris-Sorbonne, Fabrique de soi et image d’auteur : la paratopie deJosé-Maria de Heredia 9h30-10h10 : Maël G OARZIN , UNIL & EPHE, Paris, Plotin par lui-même et Plotin par Porphyre. L’image de Plotindans l’introduction de Porphyre aux Ennéades 10h10-10h30 Pause 10h30-11h10 : Laurence D AUBERCIES , Univ. de Liège, La parodie dramatique : une mise en abyme déformante del’identité auctoriale ? Le cas de l’image voltairienne dans Tancrède jugée par ses soeurs (1760) 11h10-11h50 : Joëlle L ÉGERET , UNIL, Histoire(s) de famille. (Im)postures d’auteurs dans les Kinderund Hausmärchen, gesammelt durch die Brüder Grimm 11h50-12h30 : Fanny G UEX , UNIL, Entre la disciple des maîtres de l’Inde et l’exploratriceintrépide : l’image d’Ella Maillart12h30-14h15 Pause-repas 14h15-15h00 : Michel L ACROIX , UQAM, Montréal, Images d’auteur et images de groupe : négociations et usagesdans les collections de biographies illustrées 15h00-15h40 : Mathilde L ABBÉ , Univ. Sorbonne Nouvelle –Paris 3, Dialogue de l’écrivain et du critique dans les collections patrimoniales« Poètes d’aujourd’hui » et « Écrivains de toujours » 15h40-16h20 : Marcela S CIBIORSKA , KU Leuven – MDRN, Les Albums de la Pléiade : le patrimoine littéraire en images 16h20-16h40 Pause 16h40-17h20 : Marie-Pier L UNEAU , Univ. de Sherbrooke, « X, dans son verger du Mont-St-Hilaire ; Y, au cours d’unvoyage aux Îles Mingan » : la représentation de l’écrivainquébécois dans la collection Écrivains canadiens d’aujourd’hui (1963-1975) 17h20-18h00 : Sylvestre P IDOUX , UNIL, Image éditoriale de l’auteur : le cas de Blaise Cendrars Vendredi 22 mai 2015 8h30-9h15 : Ruth A MOSSY , ADARR, Univ. de Tel-Aviv, Écrits posthumes, intimité de l’homme et image d’auteur :le cas de Roland Barthes 9h15-9h55 : Guillaume W ILLEM , KU Leuven - MDRN & Univ.de Louvain, Louvain-la-Neuve, « Si j’ai une légende, je n’y suis pour rien ! » Les entretiensd’Ostende de Michel de Ghelderode de la radio au livre 10h00-10h20 Pause 10h20-11h00 : Fanny L ORENT , Univ. de Liège, Alain Robbe-Grillet face à l’entretien journalistique : para doxes 11h00-11h40 : Galia Y ANOSHEVSKY , ADARR, Univ. Bar-Ilan, De l’image d’auteur à l’image du patrimoine culturel et national : les archives du XXe siècle de Jean José Marchand etles recueils d’entretiens de Jean Royer 11h40-13h45 Pause-repas 13h45-14h25 : Marie-Clémence R ÉGNIER , Univ. Sorbonne Nouvelle – Paris 3, « Dans le silence du cabinet ». De Gustave Flaubert à l’« ermitede Croisset » 14h25-15h05 : Claude M EYER , UNIL, Le canotier, l’aliéné et l’artiste vénéré. Maupassant, entre auto ethétéro-représentation 15h05-15h25 Pause 15h25-16h05 : Véronique R OHRBACH , UNIL, Le vedettariat de l’écrivain : Simenon vu par ses lecteurs 16h05-16h45 : Matthias DE J ONGHE , Univ. de Louvain,Louvain-la-Neuve & KU Leuven, Pierre Guyotat. Du poète maudit au moi spectral. Évocationdiachronique d’une posture auctoriale Télécharger le programme en PDF...
 Pierre Barbéris, lecteur militant, par Gérard Gengembre en ligne sur laviedesidees.fr, le 8 mai 2015. Introducteur de la critique marxiste en France, Pierre Barbéris, disparu l’an dernier, avait renouvelé la connaissance des modernités littéraires. Les propositions de ce pédagogue engagé, défendant le retour au texte, ont stimulé toute une génération de lecteurs. Pierre Barbéris (3 mai 1926-8 mai 2014) fut l’un des meilleurs représentants d’une critique universitaire combinant plusieurs approches du texte littéraire empruntées aux sciences humaines, en même temps qu’un professeur d’exception, militant pour une réforme de l’enseignement du français qui reste à accomplir. Il renouvela l’approche de la modernité littéraire, notamment du XIXe siècle, grâce à un ensemble d’ouvrages décisifs sur Balzac, Chateaubriand ou Stendhal, les enjeux idéologiques du romantisme, la question du réalisme, mais aussi à des cours dont a bénéficié toute une génération de spécialistes. Cet orateur de grand charisme tenait au pas de charge un discours qui vous prenait , sans hésitation ni ralentissement, alternant formules pétaradantes, remarques fulgurantes et pointes d’humour, sans négliger de moquer ou d’enterrer sous ses sarcasmes les propositions tièdes de tel critique. C’est que P. Barbéris ne pouvait concevoir son enseignement différemment de sa recherche, autrement dit engagé. Non pas partisan au sens étroit du terme, mais ancré dans une conception du texte littéraire liée à une cohérence idéologique. Il était marxiste et ne s’en cachait pas. Il avait médité Lukács et, sans sectarisme, sachant éviter dogmatisme et schématisme, il appliquait avec talent une théorie. Nul esprit de système cependant, car, dans le respect des textes, il combinait différentes grilles de lecture, notamment le structuralisme et l’utilisation d’outils de la linguistique. Il prenait son bien partout où il lui semblait que tel aperçu, tel concept, tel angle d’attaque permettait de tirer plus que des lectures limitées, timorées et réductrices, dépassées ou datées. Lire la suite ou télécharger l'article sur laviedesidees.fr…
Pierre Barbéris, lecteur militant, par Gérard Gengembre en ligne sur laviedesidees.fr, le 8 mai 2015. Introducteur de la critique marxiste en France, Pierre Barbéris, disparu l’an dernier, avait renouvelé la connaissance des modernités littéraires. Les propositions de ce pédagogue engagé, défendant le retour au texte, ont stimulé toute une génération de lecteurs. Pierre Barbéris (3 mai 1926-8 mai 2014) fut l’un des meilleurs représentants d’une critique universitaire combinant plusieurs approches du texte littéraire empruntées aux sciences humaines, en même temps qu’un professeur d’exception, militant pour une réforme de l’enseignement du français qui reste à accomplir. Il renouvela l’approche de la modernité littéraire, notamment du XIXe siècle, grâce à un ensemble d’ouvrages décisifs sur Balzac, Chateaubriand ou Stendhal, les enjeux idéologiques du romantisme, la question du réalisme, mais aussi à des cours dont a bénéficié toute une génération de spécialistes. Cet orateur de grand charisme tenait au pas de charge un discours qui vous prenait , sans hésitation ni ralentissement, alternant formules pétaradantes, remarques fulgurantes et pointes d’humour, sans négliger de moquer ou d’enterrer sous ses sarcasmes les propositions tièdes de tel critique. C’est que P. Barbéris ne pouvait concevoir son enseignement différemment de sa recherche, autrement dit engagé. Non pas partisan au sens étroit du terme, mais ancré dans une conception du texte littéraire liée à une cohérence idéologique. Il était marxiste et ne s’en cachait pas. Il avait médité Lukács et, sans sectarisme, sachant éviter dogmatisme et schématisme, il appliquait avec talent une théorie. Nul esprit de système cependant, car, dans le respect des textes, il combinait différentes grilles de lecture, notamment le structuralisme et l’utilisation d’outils de la linguistique. Il prenait son bien partout où il lui semblait que tel aperçu, tel concept, tel angle d’attaque permettait de tirer plus que des lectures limitées, timorées et réductrices, dépassées ou datées. Lire la suite ou télécharger l'article sur laviedesidees.fr…
 Référence bibliographique : Despoina Nikiforaki, Émergences de la théâtralité. Eschyle, Sénèque, Gabily , Presses Universitaires du Midi, collection "Cribles", 2015. EAN13 : 9782810703111. Description: «Pour la première fois, je crois, cette capacité propre au spectacle à créer du temps dans son jeu tendu avec ce qui n'est pas vu, a été pensée et explorée dans ce livre de Despoina Nikiforaki. Nouveau, inhabituel dans sa démarche, il s'appuie sur une définition forte de la "théâtralité". Ce n'est pas, dit le livre, un "en plus" du texte ou de l'action [...]. Elle est matériellement dans le texte, qui commande ainsi sa mise en scène. Elle est le travail, de phrase en phrase, qui à la fois "donne à voir" par les mots et fait des mots des instruments qui mettent en mouvement, en temps, ce qui est physiquement perçu. La philologie, comme étude serrée des textes, joue alors pleinement son rôle, ce qui est déjà nouveau, mais de manière à ne pas figer, à ne pas accumuler des "représentations" qui se substitueraient au sens. Comme le montrent les études très précises et innovantes des scènes, elle veille à ouvrir le langage à l'événement qu'il produit sans le commander, puisqu'il est toujours confronté à la présence, précaire mais évidente, de ceux qui le tiennent. Si le théâtre réfléchit concrètement sur le rapport entre présence et absence, il le fait toujours de manière située, historique.». Pierre Judet de La Combe
Référence bibliographique : Despoina Nikiforaki, Émergences de la théâtralité. Eschyle, Sénèque, Gabily , Presses Universitaires du Midi, collection "Cribles", 2015. EAN13 : 9782810703111. Description: «Pour la première fois, je crois, cette capacité propre au spectacle à créer du temps dans son jeu tendu avec ce qui n'est pas vu, a été pensée et explorée dans ce livre de Despoina Nikiforaki. Nouveau, inhabituel dans sa démarche, il s'appuie sur une définition forte de la "théâtralité". Ce n'est pas, dit le livre, un "en plus" du texte ou de l'action [...]. Elle est matériellement dans le texte, qui commande ainsi sa mise en scène. Elle est le travail, de phrase en phrase, qui à la fois "donne à voir" par les mots et fait des mots des instruments qui mettent en mouvement, en temps, ce qui est physiquement perçu. La philologie, comme étude serrée des textes, joue alors pleinement son rôle, ce qui est déjà nouveau, mais de manière à ne pas figer, à ne pas accumuler des "représentations" qui se substitueraient au sens. Comme le montrent les études très précises et innovantes des scènes, elle veille à ouvrir le langage à l'événement qu'il produit sans le commander, puisqu'il est toujours confronté à la présence, précaire mais évidente, de ceux qui le tiennent. Si le théâtre réfléchit concrètement sur le rapport entre présence et absence, il le fait toujours de manière située, historique.». Pierre Judet de La Combe
 Littérature , n°177, mars 2015 : "Baudelaire hors de lui" Numéro dirigé par Marielle Macé & Matthieu Vernet EAN 9782200929640. 118 p. Prix 18EUR Présentation de l'éditeur : Réflexions critiques sur l'invention des formes littéraires anciennes et contemporaines, cette revue est un pôle de réflexion sur le rôle inventif de la littérature dans l'évolution des sociétés et des cultures. Au croisement des sciences humaines et des arts, les collaborateurs venus de nombreux pays entretiennent le dialogue avec un lectorat international et abordent parfois le champ de l'histoire des sciences et des idées. Sommaire : Présentation. Baudelaire hors de lui, Marielle MACÉ & Matthieu VERNET ( Lire le résumé )Entretien avec Michel DEGUY et Pierre PACHET, par Laurent JENNY, Marielle MACÉ & Matthieu VERNET ( Lire le résumé )Le cadre infini – sur la poétique baudelairienne, Martin RUEFF ( Lire le résumé) Enfance contre poncif : théâtre et banalité, Julien ZANETTA ( Lire le résumé )Venger Baudelaire ? Une économie du sacrifice et de la dette, Mathilde LABBÉ ( Lire le résumé )Baudelaire, « le plus peuple des poètes », Matthieu VERNET ( Lire le résumé )S’absenter de son siècle : le Baudelaire de Philippe Muray, Alexandre DE VITRY ( Lire le résumé )Michel Deguy, lecteur-héritier de Baudelaire, Clélia VAN LERBERGHE ( Lire le résumé )Le Navire Baudelaire : imagination et hospitalité Marielle MACÉ ( Lire le résumé )
Littérature , n°177, mars 2015 : "Baudelaire hors de lui" Numéro dirigé par Marielle Macé & Matthieu Vernet EAN 9782200929640. 118 p. Prix 18EUR Présentation de l'éditeur : Réflexions critiques sur l'invention des formes littéraires anciennes et contemporaines, cette revue est un pôle de réflexion sur le rôle inventif de la littérature dans l'évolution des sociétés et des cultures. Au croisement des sciences humaines et des arts, les collaborateurs venus de nombreux pays entretiennent le dialogue avec un lectorat international et abordent parfois le champ de l'histoire des sciences et des idées. Sommaire : Présentation. Baudelaire hors de lui, Marielle MACÉ & Matthieu VERNET ( Lire le résumé )Entretien avec Michel DEGUY et Pierre PACHET, par Laurent JENNY, Marielle MACÉ & Matthieu VERNET ( Lire le résumé )Le cadre infini – sur la poétique baudelairienne, Martin RUEFF ( Lire le résumé) Enfance contre poncif : théâtre et banalité, Julien ZANETTA ( Lire le résumé )Venger Baudelaire ? Une économie du sacrifice et de la dette, Mathilde LABBÉ ( Lire le résumé )Baudelaire, « le plus peuple des poètes », Matthieu VERNET ( Lire le résumé )S’absenter de son siècle : le Baudelaire de Philippe Muray, Alexandre DE VITRY ( Lire le résumé )Michel Deguy, lecteur-héritier de Baudelaire, Clélia VAN LERBERGHE ( Lire le résumé )Le Navire Baudelaire : imagination et hospitalité Marielle MACÉ ( Lire le résumé )
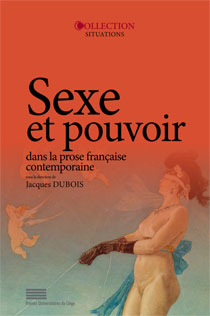 Sexe et pouvoir dans la prose contemporaine Sous la direction de Jacques Dubois Lièges : Presses universitaires de Liège, coll. "Situations", 2015. EAN 9782875620644. 224 p. Prix 23EUR Présentation du volume Amour et pouvoir. Sexe et révolte. Éros et Polis. Autant de duos thématiques qui passent pour difficiles à intégrer de façon couplée à une fiction romanesque. Stendhal en proscrivait l’alliance, tenant que les affaires publiques, toujours plus ou moins vulgaires, n’avaient pas à être mêlées aux affaires privées, plus raffinées. Et pourtant, tout au long du XXe siècle et selon des formules variables, le roman de langue française n’a guère cessé de mettre en scène ces deux registres éminents de l’activité humaine, tantôt pour les unir et tantôt pour les mettre en conflit. À chaque fois l’entreprise avait quelque chose de risqué : bien souvent on y touchait à des tabous et quelques-unes des oeuvres qui sont ici commentées ont choqué ou fait scandale. Le volume commence avec Proust, Desnos et Aragon, pour arriver à Ernaux, Houellebecq, Chessex et Carrère. Avec des textes de Danielle Bajomée, Jean-Pierre Bertrand, Benoît Denis, Laurent Demoulin, Laure Depretto, Paul Dirkx, Jacques Dubois, Pascal Durand, Karen Haddad, Maya Lavault, Jeannine Paque, Pierre Popovic, Dominique Rabaté, Matthieu Vernet. Jacques DUBOIS est professeur émérite de l’Université de Liège. Spécialiste du roman français moderne et de la sociologie de la culture, il a donné dans l’esprit déjà du présent ouvrage Pour Albertine. Proust et le sens du social (Seuil, 1997) et Figures du désir. Pour une critique amoureuse (Les Impressions Nouvelles, 2011). Sommaire : 1. Marcel Proust, À la recherche du temps perdu (1913-1927) 2. Robert Desnos, La Liberté ou l'Amour ! (1927) 3. Louis Aragon, La Défense de l'infini et le Con d'Irène (1928) 4. Louis Aragon, Les Cloches de Bâle (1934) 5. Georges Bataille, Le Bleu du ciel (1935/1957) 6. Pierre Drieu la Rochelle, Une femme à sa fenêtre (1929), Rêveuse bourgeoisie (1937) et Gilles (1939) 7. Jean Genet, Pompes funèbres (1948) 8. Simone de Beauvoir, Les Mandarins (1954) 9. Pierre Klossowski, La Révocation de l'Édit de Nantes (1959) 10. Marguerite Duras, L'Été 80 (1980) 11. Jacques Chessex, Judas le transparent (1982) 12. Michel Houellebecq , Extension du domaine de la lutte (1994) 13. Claude Simon, Le Jardin des Plantes (1997) 14. Annie Ernaux, Les Années (2008) 15. Emmanuel Carrère, Limonov (2011)
Sexe et pouvoir dans la prose contemporaine Sous la direction de Jacques Dubois Lièges : Presses universitaires de Liège, coll. "Situations", 2015. EAN 9782875620644. 224 p. Prix 23EUR Présentation du volume Amour et pouvoir. Sexe et révolte. Éros et Polis. Autant de duos thématiques qui passent pour difficiles à intégrer de façon couplée à une fiction romanesque. Stendhal en proscrivait l’alliance, tenant que les affaires publiques, toujours plus ou moins vulgaires, n’avaient pas à être mêlées aux affaires privées, plus raffinées. Et pourtant, tout au long du XXe siècle et selon des formules variables, le roman de langue française n’a guère cessé de mettre en scène ces deux registres éminents de l’activité humaine, tantôt pour les unir et tantôt pour les mettre en conflit. À chaque fois l’entreprise avait quelque chose de risqué : bien souvent on y touchait à des tabous et quelques-unes des oeuvres qui sont ici commentées ont choqué ou fait scandale. Le volume commence avec Proust, Desnos et Aragon, pour arriver à Ernaux, Houellebecq, Chessex et Carrère. Avec des textes de Danielle Bajomée, Jean-Pierre Bertrand, Benoît Denis, Laurent Demoulin, Laure Depretto, Paul Dirkx, Jacques Dubois, Pascal Durand, Karen Haddad, Maya Lavault, Jeannine Paque, Pierre Popovic, Dominique Rabaté, Matthieu Vernet. Jacques DUBOIS est professeur émérite de l’Université de Liège. Spécialiste du roman français moderne et de la sociologie de la culture, il a donné dans l’esprit déjà du présent ouvrage Pour Albertine. Proust et le sens du social (Seuil, 1997) et Figures du désir. Pour une critique amoureuse (Les Impressions Nouvelles, 2011). Sommaire : 1. Marcel Proust, À la recherche du temps perdu (1913-1927) 2. Robert Desnos, La Liberté ou l'Amour ! (1927) 3. Louis Aragon, La Défense de l'infini et le Con d'Irène (1928) 4. Louis Aragon, Les Cloches de Bâle (1934) 5. Georges Bataille, Le Bleu du ciel (1935/1957) 6. Pierre Drieu la Rochelle, Une femme à sa fenêtre (1929), Rêveuse bourgeoisie (1937) et Gilles (1939) 7. Jean Genet, Pompes funèbres (1948) 8. Simone de Beauvoir, Les Mandarins (1954) 9. Pierre Klossowski, La Révocation de l'Édit de Nantes (1959) 10. Marguerite Duras, L'Été 80 (1980) 11. Jacques Chessex, Judas le transparent (1982) 12. Michel Houellebecq , Extension du domaine de la lutte (1994) 13. Claude Simon, Le Jardin des Plantes (1997) 14. Annie Ernaux, Les Années (2008) 15. Emmanuel Carrère, Limonov (2011)