Lu sur ActuaLitté (10/12/12): De l'art de finir de lire les livres achetés, ou pas Kobo brosse le tableau d'un lecteur d'ebook et de ses comportements de lecture Les lecteurs sont des créatures contrariantes, quand on mène des études. Une précédente analyse avait démontré que le livre de Donna Tartt figurait parmi les ouvrages les plus lus, dans leur intégralité. Le chiffre était avancé par Amazon, mais Kobo vient de diffuser une enquête, qui démontre... l'inverse. Situé à la 37e position des meilleures ventes de l'année dans l'ebookstore du Canadien, le livre n'a été achevé que par 44,4 % des lecteurs britanniques qui l'ont acheté. Selon le libraire, cela prouverait « probablement qu'ils ont été intimidés, pour certains, en raison de la longueur du roman », qui contient près de 800 pages. Dans le bilan 2014 de ses ventes, la plateforme Kobo enregistre plus de 4,2 millions de titres, et Michael Tamblyn, le PDG se frotte les mains. « Dans l'ensemble, le marché du livre numérique représente environ 14,5 milliards de dollars de vente à l'échelle mondiale, et devrait atteindre plus de 22 milliards $ en 2017. Les progrès que nous constatons d'année en année sont incroyables, avec plus d'éditeurs et d'utilisateurs et des nouvelles technologies qui changent la face de l'industrie à un rythme sans précédent. » La liste des meilleures ventes ainsi présentée, ne démontre toutefois pas que les lecteurs sont allés au bout de leur ouvrage, poursuit Tamblyn. « Beaucoup de lecteurs ont plusieurs romans en cours à un moment donné, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas toujours lire un livre du début à la fin, avant de se lancer dans leur prochaine histoire. » Pour le territoire britannique, Kobo montre que 62 % des lecteurs de romans d'amour finissent leurs livres, puis viennent les crimes et thrillers avec 61 % et la fantasy, avec 60 %. Du côté européen, les romans d'amour sont lus intégralement par 74 % des Italiens, 67 % des Néerlandais et 62 % des Britaninques. En revanche les Français achèvent à 70 % des livres de mystère, contre 64 % chez les Australiens et Néo-Zélandais, et 44 % chez les Américains. Via les outils implémentés dans les appareils de lecture, Kobo est en effet en mesure de contrôler, de même que toutes les autres sociétés – avec un paroxysme quand on parle des abonnements illimités – la manière dont les lecteurs interagissent avec leur livre. Non seulement on peut mesurer quelle quantité du livre est consultée, mais également la vitesse de lecture, et par conséquent définir les centres d'intérêt. Et chez les Frenchies ? Plus spécifiquement, les lecteurs français auraient tendance à achever leurs livres : 90 des 100 best-sellers achetés sont achevés par au moins la moitié des lecteurs. « On note également que certains succès de librairie qui ont occupé l'espace médiatique ne sont pas toujours lus jusqu'au bout ! Ainsi, près d'un tiers des utilisateurs Kobo qui ont acheté Merci pour ce moment de Valérie Trierweiler (11e meilleure vente) ne l'ont pas terminé, et seulement 7,3 % des lecteurs sont allés au bout du polémique Le Suicide Français d'Éric Zemmour, qui arrive en toute fin de classement des best-sellers à la 99e place », précise Kobo. En France, le top 15 des meilleures ventes 2014 fait la part belle aux auteurs français, bien que le Nobel de littérature, Patrick Modiano ne soit classé qu'en 70e position. Central Park - Guillaume Musso Muchachas 1 — Katherine Pancol Muchachas 2 — Katherine Pancol Les gens heureux lisent et boivent du café — Agnès Martin-Lugand La Faiseuse d'anges — Camilla Läckberg Muchachas 3 — Katherine Pancol Cinquante nuances de Grey — E L James La Vie en mieux — Anna Gavalda Six ans déjà — Harlan Coben L'héritage de tata Lucie — Philippe Saimbert Merci pour ce moment — Valérie Trierweiler Une autre idée du bonheur — Marc Levy Cinquante nuances plus sombres — E L James Cinquante nuances plus claires — E L James En finir avec Eddy Bellegueule — Edouard Louis La collecte de données a été effectuée entre janvier et novembre 2014, auprès de plus de 21 millions d'utilisateurs dans plusieurs pays. Récemment, la firme a sorti son dernier lecteur ebook, le Aura H2O, étanche, qui représentent environ 20 % des ventes globales de ereaders, assure Tamblyn. En partenariat avec le fabricant, ActuaLitté avait réalisé des vidéos démontrant la fiabilité du produit.
↧
Lire jusqu'au bout? "De l'art de finir de lire les livres achetés, ou pas" (ActuaLitté)
↧
Le siècle de la légèreté : émergences d’un paradigme du XVIII e s. français
Le siècle de la légèreté : émergences d’un paradigme du XVIII e siècle français Journée d’études, Maison française d’Oxford, 15 mai 2015 Organisée parMarine Ganofsky (University of St Andrews) &Jean-Alexandre Perras (MFO-Voltaire foundation, Oxford) Tandis que Voltaire écrivait à propos des Français que «la légèreté et l’inconstance ont fait le caractère de cette aimable nation», Caraccioli remarquait qu’«il y a longtemps qu’on accuse les Français de légèreté», mais «il y a longtemps qu’ils ne cherchent pas à s’en corriger». Si la légèreté devient une question nationale pour la France du XVIII e siècle, c’est surtout afin de promouvoir les «vertus civiles» dont elle serait le lieu par excellence. La nation française serait trop inconstante pour être sérieusement mauvaise. Cependant, cette légèreté du siècle ne fait pas l’unanimité, loin s’en faut, et plusieurs auteurs condamnent l’inconséquence d’esprit propre à leur siècle, faisant de la légèreté l’un des paradigmes autour duquel tout un siècle se définit, ou contre lequel il s’insurge. Mais cette notion ne concerne pas uniquement ces questions de morale, et s’applique à tous les domaines des connaissances humaines. Les amateurs louent la légèreté des œuvres qu’ils commentent, les auteurs allègent leur plume afin de la faire mieux courir, les scientifiques s’interrogent sur cette qualité de la matière… Enfin, couronnant le siècle de la légèreté, le ballon des frères Montgolfier et autres aérostats flottent dans l’azur et enchantent en les survolant les foules enthousiastes. Le siècle le plus léger est aussi celui qui s’est le premier élevé jusqu’aux cieux. Propre à la façon dont le siècle se construit et se perçoit, la légèreté du XVIII e siècle habite encore l’historiographie de la période. Pour ses successeurs, les représentations du XVIII e siècle ne se limitent pas à un siècle des Lumières sérieux et progressiste, mais construisent aussi un siècle de la Légèreté, futile et immoral. Entre la bourgeoisie industrieuse du XIX e siècle considérant avec quelque nostalgie les voluptés des fêtes galantes, et l’intérêt de notre époque célébrant la frivolité (et la commercialité) du siècle de Marie-Antoinette et de Fragonard, il est certain que le XVIII e siècle en sa légèreté n’a jamais cessé de séduire. Enfin, depuis quelques décennies, l’intérêt des universitaires, des romanciers, des cinéastes et des artistes pour cet aspect du XVIII e siècle a beaucoup contribué à la pérennité, auprès d’un public de plus en plus vaste, du fantasme d’un dix-huitième siècle frivole, galant, voluptueux, riant: léger. Ainsi, qu’elle soit l’objet d’une conquête (scientifique, morale, esthétique, etc.) ou de constructions historiques, la légèreté du XVIII e siècle s’impose comme un paradigme dont il s’agira de soulever les enjeux, dans une perspective critique et historiographique. Cette démarche sera l’objet d’une journée d’études interdisciplinaire, qui aura lieu à la Maison française d’Oxford, le 15 mai 2015.Quels liens les développements des belles-lettres françaises au XVIII e siècle entretiennent-ils avec la notion de légèreté ? Dans quelle mesure l’opposition à la gravitas des Anciens a-t-elle contribué à définir une certaine légèreté stylistique correspondant aux modes littéraires et permettant d’explorer de nouvelles possibilités littéraires ? Par ailleurs, plusieurs genres littéraires étaient accusés de publier une dangereuse futilité et une frivolité coupable : ainsi des contes et des romans ; dans quelle mesure les auteurs ont-ils répondu à ces accusations ? Ou encore, la littérature française abonde en personnages légers, depuis les petits-maîtres jouisseurs et inconstants jusqu’aux sylphes et autres personnages plus ou moins palpables, en passant par les femmes et les petits abbés «à vapeurs».Les mémoires et les correspondances des contemporains abondent en commentaires et en réflexions faisant état de la légèreté du siècle. Quelles représentations ont inspiré pareils discours? Dans quelle mesure ont-ils contribué à façonner la postérité d’un XVIII e siècle comme siècle de la légèreté?Dans le domaine de la philosophie, plusieurs essais ont été écrits qui mettent en scène la frivolité, la joie, le plaisir sous un jour avantageux, tandis que la morale elle-même, peut-être en cherchant l’équilibre entre le docere et le placere , a été absorbée dans des récits plaisants et d’apparence superficielle, en cherchant à s’exprimer à travers des contes faits à plaisir et autres fables légères.Dans les arts visuels et la critique d’art naissante, la légèreté peut être vue comme une qualité essentielle du peintre, tout en se faisant sujet de ses compositions, dont les «fêtes galantes» de Watteau, la Bulle de savon de Chardin, l’ Escarpolette de Fragonard ou l’ Oiseau mort de Greuze peuvent être des représentants exemplaires (pour les contemporains comme pour la postérité) de la légèreté morale du siècle.En architecture, la légèreté a été définie comme «le peu de matière» et l’ouverture de la structure. Comment ces qualités ont-elles été interprétées par rapport aux différents styles architecturaux comme le gothique, le rococo, etc.?En musique, dans quelle mesure la légèreté est-elle une caractéristique du style français; en quoi, par exemple, est-elle un enjeu de la Querelle des Bouffons?En histoire des sciences et de la médecine, entre la théorie des vapeurs et les ballons des frères Montgolfier, comment la légèreté devient-elle un élément central dans les efforts accomplis pour comprendre ou maîtriser la nature?Enfin, d’un point de vue historiographique, quelle fortune critique la légèreté du XVIIIe siècle a-t-elle connu au cours des siècles suivants? Comment les différentes nations d’Europe, de même que les périodes suivantes se sont-elles définies à travers ou par opposition à la légèreté du XVIII e siècle français ? Qu’indiquent ces représentations quant aux cultures et aux époques qui les ont façonnées? Nous invitons les personnes intéressées à nous faire parvenir une proposition de communication d’environ 300 mots, ainsi qu’une courte bio-bibliographie, avant le 15 février 2015, aux adresses suivantes: Mg216@st-andrews.ac.uk jean-alexandre.perras@mod-langs.ox.ac.uk Avec le soutien de: Society for French Studies TORCH (The Oxford Research Centre in the Humanities) The Voltaire Foundation *** The Age of Lightness: Emergences of a Paradigm of the French Eighteenth-century One-day conference to be held at the Maison française of Oxford, 15 May 2015 Conveners: Dr Marine Ganofsky (University of St Andrews) & Dr Jean-Alexandre Perras (MFO-Voltaire Foundation, Oxford) Whilst Voltaire observed that ‘lightness and fickleness shaped the character of that agreeable nation’ (none other than France), Caraccioli remarked that ‘for a long time, French people have been accused of lightness, and for a long time they have not cared to mend their ways’. If lightness became such a crucial national issue in eighteenth-century France, it is in great part because of its connection with ‘civic virtues’ which were then thought to depend upon this inconstancy. The French nation would be too fickle to be seriously evil. However, the alleged lightness of the ‘siècle’ was far from inspiring unanimous praise. Many would rather condemn the inconsequential spirit of the times. Lightness thus emerged from all these discussions as one of the paradigms around or against which the entire century was defining itself. Furthermore, this interest for the question of lightness did not concern debates on morals alone, but reappeared instead in all fields of human knowledge. Whereas ‘amateurs’ or art critics extolled the ‘lightness’ of certain paintings, scientists investigated lightness as a potential property of matter. And, at the end of this Age of Lightness, the Montgolfier brothers’ balloons and others aerostats could be seen floating weightlessly over enchanted and enthusiastic crowds. The lightest century is also the one who first lifted itself to the sky. Significantly, from the Revolution of 1789 onwards, subsequent periods would also define themselves in relation to this paradigm, thereby resuming the construction of the French eighteenth century not just as the Age of Enlightenment, but instead as the Age of Lightness. From the bourgeois nineteenth century nostalgically dreaming of bygone fêtes galantes to our own early twenty first century celebrating the frivolity (and marketability) of Marie-Antoinette’s and Fragonard’s images, the last century of the Ancien Régime has never ceased to exert its charms upon the public. Now more than ever, the fascinated focus of scholars, novelists, filmmakers and artists has brought to the fore that particular aspect of eighteenth-century France: the delightfully hedonistic, fickle, witty and frivolous siècle des Lumières that they give us to see spurs the ever-expanding diffusion of this representation of history. Thus the lightness of the French eighteenth century not only appears to be the object of a multi-faceted conquest (at once scientific, moral, aesthetic, …); it also imposes itself as an historically constructed paradigm giving rise to many questions that we propose to explore from a critical and historiographical point of view during a study-day to be held at the Maison française d’Oxford on May, 15 2015. We welcome papers which examine the alleged lightness of the French eighteenth century from the perspectives of various disciplines:In literature, the rise of the ‘French’ novel is inseparable from this notion of lightness. The authors’ opposition to the gravitas of the Ancients conceptualised lightness in style as a way to comply with contemporary literary aesthetics whilst exploring new expressive possibilities. Besides, the novel itself was accused of being a dangerously idle genre. French literature was for instance trifling with characters who, from hedonists to immaterial sylphs to featherbrained ladies, were defined by their lightness.In contemporary memoirs and correspondences, observations of and reflections on the so-called lightness of the French nation abound. What inspired such remarks? To what extent did they craft the posterity of the eighteenth century as the age of lightness?In the domain of moral philosophy, numerous essays were written on frivolity, happiness, pleasure, whilst philosophy itself, aiming both to teach and to please, was channelled through entertaining and superficially light fables and tales.In visual arts and the arising art criticism, lightness is a quality of the painter’s style as well as the subject of the composition, as epitomised by Watteau’s ‘fêtes galantes’, Chardin’s La Bulle de savon , Fragonard’s L’Escarpolette , or Greuze’s L’Oiseau mort . Such works have often been regarded (especially in the nineteenth century but also already in their own time) as artefacts of the Lumières’ moral lightness.In architecture, lightness is defined as ‘the scarcity of material’ ( Encyclopédie ) and the openness of structures. How have these qualities been interpreted relatively to different architectural styles such as the baroque, the gothic, the rococo or Neoclassicism.In music, to what extent does lightness characterizes the French style? What part did the notion of lightness play in the Querelle des Bouffons for instance?In the history of sciences, from the field of medicine (through the theories on vapours) to the Montgolfier brothers, lightness (or air) appears as a crucial element to know and to master. The conquest of the sky and its representations is of particular interest to the present reflection.Finally, to promote a critical/historiographical approach of these reflections, we will also welcome papers addressing more specifically the synchronic and diachronic representations of this alleged lightness. How did other nations and subsequent periods construct themselves through their conceptualisation of the French eighteenth century as ‘light’? What can discourses on the French eighteenth century’s alleged lightness disclose about the place and time which produce these discourses? 300 words proposals (with ashort bio-bibliography) should be sent to the following addresses by February, 15 2015: mg216@st-andrews.ac.uk jean-alexandre.perras@mod-langs.ox.ac.uk With the support of: Society for French Studies TORCH (The Oxford Research Centre in the Humanities) The Voltaire Foundation
↧
↧
Enquête sur le lecteur de polar (Babelio)
 Lecteur hors norme, l'amateur de polar a été soumis à enquête et filature par le réseau social du livre, Babelio: le rapport était présenté le 11 décembre 2014 au Centre national du livre. Près de 3700 répondants ont permis d'établir un portrait-robot du lecteur de polars en France. Lire les résultats de l'enquête … L'analyse proposé sur le site ActuaLitté…
Lecteur hors norme, l'amateur de polar a été soumis à enquête et filature par le réseau social du livre, Babelio: le rapport était présenté le 11 décembre 2014 au Centre national du livre. Près de 3700 répondants ont permis d'établir un portrait-robot du lecteur de polars en France. Lire les résultats de l'enquête … L'analyse proposé sur le site ActuaLitté…
↧
Table ronde sur La Boétie (Agrégation)
TABLE RONDE D’AGREGATION SUR DE LA SERVITUDE VOLONTAIRE D’E. DE LA BOETIE Mercredi 7 janvier 2015, 13h30-16h Université de Toulouse Jean Jaurès, UFR de Lettres, Philosophie et Musique (5, Allées Antonio Machado 31058 Toulouse – Métro Mirail Université) Salle 280 Coordination : O. Guerrier, A. Rees 13h30-13h50 : Stéphane Macé (Université Grenoble III – IUF) : «L'écriture de l'analogie dans le DSV » 14h00-14h20 : Agnès Rees (Université de Toulouse Jean Jaurès) : «La question du pathos dans le DSV » Pause 14h40-15h : Bérengère Basset (Université de Toulouse Jean Jaurès) : «Animaux et animalité dans le DSV » 15h10-15h30 : Olivier Guerrier (Université de Toulouse Jean Jaurès) : «Rhétorique et recherche» 15h40-16h : Laurent Gerbier (CESR, Université F. Rabelais - Tours) : «Assurance et endurance. La Boétie et les formes morales de la durée» Contact: olivier.guerrier@wanadoo.fr
↧
Romain Rolland & l'Inde
«Romain Rolland et l’Inde: un échange fructueux» Célébration du Centenaire du prix Nobel de Littérature décerné à Romain Rolland en 1915 Colloque organisé par l’Ambassade de l’Inde en France et l’Association Romain Rolland avec le soutien des Archives de France 17 et 18 juin 2015 à Paris Sorbonne - Ambassade de l’Inde sous le Haut Patronage de son Excellence Arun K.Singh et du Recteur François Weil, Chancelier des Universités de Paris président d'honneur du Colloque : professeur Bernard Duchatelet président du Comité scientifique : Roland Roudil Comité scientifique : Azarie Aroulandom président de l'Association Tagore Sangam Guillaume Bridet, professeur de Littérature française à l’Université de Dijon Chinmoy Guha, professeur, université de Calcutta et traducteur émérite Jean Lacoste, philosophe Michaël de Saint-Cheron, philosophe des religions, écrivain Apoorva Srivastava, conseiller (Presse, Information et Culture) de l’Ambassade de l’Inde en France Dr Henri Vermorel, psychanalyste Archives de France. Mission aux Commémorations nationales Philippe-Georges Richard, Conservateur général Coordination des manifestations : Martine Liégeois, présidente de l’Association Romain Rolland Viviane Tourtet, Assistante de Rédaction des Nouvelles de l’Inde (Service Presse, Information et Culture) Actes du colloque publiés par l’Association Romain Rolland sous la direction de Roland Roudil * Appel à contribution Présentation Dès ses années de formation à l’Ecole Normale supérieure, Rolland s’intéresse aux religions d’Asie que lui fait découvrir le romantisme français et allemand. Le thème de l’Orient est d’ailleurs plusieurs fois abordé dans Jean-Christophe .Très impliqué, après la guerre, dans le débat Orient-Occident, Rolland s’intéresse à Mohandas K. Gandhi et son satyagraha comme moyen non-violent de libération des peuples. Suite à l’invitation de Rabindranath Tagore, l’écrivain est même tenté par le voyage vers les «hauts plateaux de l’Himalaya», «berceau de l’Humanité» à ses yeux. Le dialogue avec l’Orient doit permettre à l’Europe de sortir des ténèbres dans lesquelles l’a plongée la guerre et de concilier les «deux hémisphères» de l’esprit, même si rationalisme et spiritualisme ne recoupent pas les deux continents géographiques. Sa profession de foi universaliste lui fait ainsi relier la mystique hindoue (Sri Ramakrishna et Swami Vivekananda) et la mystique des chrétiens d’Europe (Maître Eckhart, Saint-Jean de la Croix); le Brahmo Samaj réalise ce renouveau religieux qu’il appelait de ses vœux lorsqu’il évoquait dans Jean-Christophe la «petite légion des modernistes» de l’Eglise catholique. Ses convictions d’intellectuel engagé n’entrent pas alors en contradiction avec l’affirmation du pouvoir des forces spirituelles («L’Annonciatrice», dernière partie de l’Âme enchantée ). L’attente du grand Soir se confond avec l’espoir d’une Cité idéale construite par la foi en la fraternité des hommes, celle à laquelle s’intéressent le néo-vedanta, mais aussi Léon Tolstoï et Walt Whitman, ou les transcendantalistes américains comme Ralph Waldo Emerson et Henry David Thoreau. Proposition de thèmes Les contributions pourront porter sur les points suivants: Dans l’imaginaire géographique de Rolland, quelles places tiennent l’Orient, l’Asie et l’Inde? D’un point de vue idéologique, que peut le recours à la culture de ces continents pour sauver l’Occident d’un déclin confirmé par le conflit européen ? Les thèmes à explorerpeuvent porter sur l’Inde scientifique (J. C. Bose et la foi en la science); l’Inde philosophique et religieuse par la mise en résonance des mystiques hindoue et chrétienne, et la confrontation, dans la suite de l’éclair de Spinoza, de la sensation océanique et du vedanta (relation épistolaire Romain Rolland-Sigmund Freud). D’un point de vue littéraire, la présence de l’Inde peut être relevée dans l’œuvre romanesque ( Jean-Christophe et l’Âme enchantée ), tout comme la place de ses écrits dans le champ littéraire de «l’indianisme» de l’entre-deux-guerres, aux côtés de René Daumal, René Guénon ou Sylvain-Lévi. A ce propos le rôle majeur de la reconnaissance de Tagore dans la France littéraire et intellectuelle des années 1920 est à souligner. La réception de Gandhi en Europe, qui alimente le débat sur la non-violence dans la lutte révolutionnaire, peut permettre une approche de l’Inde vue sous l’angle politique. Cet «Appel de l’Orient» ( Cahiers du Mois, mars-avril 1925), intimement lié à la faillite spirituelle de l’Europe, conduit à des prises de position anticolonialistes dont témoignent les «Courriers de l’Inde», dans la revue Europe .Dans le domaine musicologique, la conception de la création musicale de Rolland peut être confrontée à celle de Tagore (ou de Gandhi) telles qu’elles se dégagent de leurs discussions sur ce sujet, et compte tenu du rôle particulier joué en Europe par la musique et la danse indienne dans l’entre-deux-guerres (UdayShankar, l’amitié d’Alain Daniélou et de Tagore). A cela s’ajoutent, du point de vue relationnel, les amitiés que surent nouer l’écrivain et les intellectuels Indiens, que ce soit Tagore, J. C. Bose ou Kalidas Nag, autour de la musique, de la peinture, de la science ou de la littérature. La présence de Rolland en Inde – lui qui a su faire redécouvrir les mystiques indiens dans leur propre pays – peut retenir l’attention. On pourrait souligner ainsi la place occupée par Rolland au Bengale, et plus largement, l’importance de la culture européenne à Calcutta, ville cosmopolite depuis la fin du XVIIIe siècle, siège d’une culture à la fois indienne et nourrie de l’étranger (de l’Angleterre notamment), culture hybride propice à la rencontre avec l’Occident. L’inventaire des ouvrages de la bibliothèque indienne de l’écrivain à la BnF et l’étude des dédicaces donnent à ce propos un aperçu de cette réception, mais aussi des goûts de l’auteur pour tout ce qui venait de cet orient asiatique qu’il vénéra dans les années 20 et au début des années 30. Soumission Les propositions d’environ 250 mots suivis d’une brève bibliographie sont à envoyer pour le 30 janvier 2015 à: Roland Roudil (r-roudil@orange.fr). Calendrier: Les candidats retenus en seront avisés: fin février 2015. *
↧
↧
Philosophie & littérature: l'attention au particulier
Philosophie & littérature: l'attention au particulier Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne EA 3562 - Centre de philosophie contemporaine de la Sorbonne Axe EXeCOEn collaboration avec le CURAPP-ESSDans le cadre du GDRI «PloCo» (INSHS CNRS) Organisé par Pierre Fasula (Paris 1/PhiCo), Sandra Laugier (Paris 1/PhiCo) et Layla Raïd (UPJV / CURAPP-ESS) La dernière décennie a montré un vif intérêt pour les rapports entre philosophie et littérature, en provenance de plusieurs courants philosophiques variés. En témoigne la publication d’un nombre important d’ouvrages et de collectifs (J.Bouveresse, La connaissance de l’écrivain ; S. Laugier, Éthique, littérature, vie humaine ; D.Lorenzini et A.Revel, Le travail de la littérature ; P.Sabot, Philosophie et littérature ; C. Dumoulié, Littérature et philosophie. Le gai savoir de la littérature ; K.Dauber et W.Jost, Ordinary Language Criticism. Literary Thinking after Cavell after Wittgenstein ; T. Moi, Simone de Beauvoir: The Making of an Intellectual Woman ). Cf .aussi la publication de nombreuses traductions (C.Diamond, L’importance d’être humain ; M.Nussbaum, La connaissance de l’amour ; S.Cavell, Dire et vouloir dire )Ces travaux ont mis en évidence la pertinence de la littérature en philosophie: comment elle est porteuse d´une forme de connaissance ou de productivité philosophique, comment elle contribue à la réflexion morale. La thématique est abordée via un cycle annuel de journées d’étude, commencé en 2013. Pour mémoire, les thématiques de l’atelier 2013 étaient: l’expérience de la littérature; scepticisme et tragédie.L’ atelier 2015 aura pour objet l’attention au particulier , au cœur des philosophies contemporaines de la littérature, notamment:L’ Ordinary Language Criticism , héritée de Wittgenstein et Cavell;Le particularisme moral de Nussbaum, construit sur un héritage aristotélicien;La critique élaborée depuis l’œuvre de Foucault. Signalons l’importance croissante de deux figures nouvelles: Iris Murdoch, philosophe et romancière, et Carol Gilligan, figure des éthiques du care , romancière également, dont les travaux sur la littérature se rattachent à la critique féministe. Selon Nussbaum, la littérature donne à la philosophie morale une profondeur que ne permet pas le travail académique traditionnel, dont les «exemples» transmettent leurs étroites limites à la réflexion elle-même. Limites qu’un bon usage philosophique de la littérature permet de dépasser. En tant que réservoir de pensées concrètes, la littérature serait ainsi à même de rendre visible la réalité de la vie morale, tâche qu’en général la philosophie sans l’art serait incapable de réaliser. Une série de problèmes apparaît dès lors, qui dessinent un visage différent de la philosophie morale et de son objet, selon qu’on acquiescera ou non au principe d’une telle communication entre littérature et philosophie: comment la philosophie discute-t-elle de la vie humaine, avec quels outils, capables d’en représenter quelles dimensions? Comment se rapporte-t-elle au particulier des vies humaines ? Programme Vendredi 9 janvier 2015 -Salle 216 du Centre Panthéon 9h30: Accueil et présentation Présidence: Pierre Fasula 9h45: Piergorgio Donatelli (Université de Rome La Sapienza) «Literature, Imagination and Moral Progress» 10h45: Daniele Lorenzini (Université Paris-Est Créteil) «L’attention au particulier comme pratique de l’ordinaire» 12h: Layla Raïd (Université Picardie Jules Verne) «Anesthésie émotive et cécité morale. Une lecture de Jean Rhys, Good Morning, Midnight » Présidence: Layla Raïd 14h45: Pierre Fasula (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) «L’homme sans particularités» 15h45: Thibaut Sallenave (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) «Le reste et le particulier. Le problème du “sujet” chez Jean Paulhan» 17h: Patricia Paperman (Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, LEGS) «Refus du particulier: les réponses de Ruth Kluger ( Weiter Leben ,Perdu en chemin )» Samedi 10 janvier 2015 -Salle Lalande du Centre Sorbonne 9h15: Emmanuel Halais (Université Picardie Jules Verne) «Philosophie et littérature chez Iris Murdoch» 10h15: Miranda Boldrini (Université de Rome La Sapienza) «Iris Murdoch sur éthique et littérature : l’imagination, la tragédie et la mort» 11h30: Philippe Sabot (Université Lille 3) «Harry Crews et l'ordinaire du mal» 14h: Judith Revel (Université Paris Ouest Nanterre La Défense) «Pour une nouvelle écriture du quotidien: du réel des objets au réel des pratiques» 15h: Sandra Laugier (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) «Care et littérature: un nouveau paradigme» 16h15: Ariane Revel (Université Paris-Est Créteil) «D’une voix l'autre : attester et rapporter l’expérience particulière dans quelques textes de W.G. Sebald»
↧
Michel Chaillou: l’écriture fugitive
Michel Chaillou: l’écriture fugitive 25-26 février 2016 UNIVERSITE DU LITTORAL COTE D’OPALE En partenariat avec l’université d’Angers Michel Chaillou a produit, au cours de ces dernières décennies, une œuvre considérable, exigeante, protéiforme et cependant d'une facture inimitable, semblant constamment réinventer la langue à mesure qu'elle en exploite les virtualités. Ce colloque se propose d'en explorer les thèmes majeurs, d'en dégager les lignes de force. Voici quelques objets possibles d'étude, mais d'autres perspectives ne sont pas à exclure: - Le nomadisme: goût jamais démenti du voyage (voyage effectif, intérieur, ou temporel), ancrage de l'écriture dans des espaces de prédilection, cartographie intime, exploration sous forme de creusée dans les différentes strates du paysage... - L'Histoire: histoire des hommes et histoire personnelle, écriture de soi entremêlant investigations généalogiques, autobiographie intellectuelle, transpersonnelle, autofiction; réflexion sur le fonctionnement de la mémoire et la reconstruction/invention du passé… - Fiction et érudition: dialogue constant avec des œuvres antérieures, emprunts, citations, etc. Inscription dans une tradition littéraire et culturelle, jeux de miroir, mise en relation des activités parallèles que sont la lecture et l'écriture… - L'écriture: hybridation générique, stylistique. Effets de composition alliant déstructuration et travail harmonique. Part d'énigme du texte, son obscurité, ses lignes de fuite, ce que l'écrivain nomme "esthétique du flou"… Modalités de soumission Les propositions de communications (titre et résumé d’environ 250 mots, bref curriculum vitae) devront être adressées au plus tard le 30 avril 2015 aux deux adresses suivantes: francois.berquin@univ-littoral.fr catherine.haman@orange.fr Organisation: François Berquin et Catherine Haman (HLLI)
↧
F. Coblence, M. Enaudeau (dir.), Lyotard et les arts
 Lyotard et les arts Françoise Coblence, Michel Enaudeau dir. Collectif DATE DE PARUTION : 15/11/14 EDITEUR : Klincksieck COLLECTION : Esthétique ISBN : 978-2-252-03953-3 EAN : 9782252039533 PRÉSENTATION : Broché NB. DE PAGES : 295 p. Sous des formes les plus diverses - catalogues d'expositions, monographies, livres, films, vidéos - Jean-François Lyotard a consacré une part importante de son travail de philosophe à la réflexion sur les arts - musique, cinéma, peinture. Outre la publication d'un entretien inédit à propos de la manifestation "Les Immatériaux" (Centre Georges-Pompidou, 1985), le présent volume propose, pour la première fois, un ensemble conséquent d'études consacré à l'archipel lyotardien des arts. Des lecteurs avertis de la pensée de Lyotard et de plus jeunes chercheurs découvrant l'importance de cette oeuvre philosophique ont été sollicités. Ils donnent ici leur contribution. Leurs études s'attachent à éclairer, à éprouver les concepts - "figurai", "libidinal", "sublime", "immatériau", "matière", "imprésentable", "affect", "écriture" - par lesquels Lyotard rompt avec l'esthétique au sens académique du terme et fait droit à l'occurrence de la couleur ou du son. Avec ces concepts, il indique une constante de sa pensée : résister à la restauration de toute totalisation de l'expérience. Sommaire : I. BOULEVERSEMENTS DANS L'ESTHÉTIQUE - Ouverture : Jean-François Lyotard : La Condition d'amour (La Madone de Monterchi) Jean-Michel Rey : De Freud à Kant Christine Buci-Glucksmann : L'œil aveuglé de l'art Jean-Patrice Courtois : Abstraction, Matière, Matériau et Immatériau chez Jean-François Lyotard Claire Pagès : Lyotard et la sculpture Maud Pouradier : Le signe de l'opéra. Remarques sur la théâtralité de la musique chez Jean-François Lyotard Gérald Sfez : Autrement qu'être en art Jean-François Nordmann : Anamnèse et création : les deux voies finales de sortie de l’esthétique chez Jean-François Lyotard II. ARTS, POLITIQUE - Ouverture Michel Enaudeau : La Fontaine de René Guiffrey Lettre de Jean-François Lyotard à René Guiffrey Gaëlle Bernard : Art et épokhè. Le doute de Lyotard Frédéric Fruteau de Laclos : Lyotard contre Lyotard. Politiques de la sensibilité Jean-Loup Thébaud : Lyotard lecteur d’Adorno Elisabeth de Fontenay : Un généreux coup de force : Le Malraux de Lyotard III. MATÉRIAUX ET PRATIQUES - Ouverture : Bernard Blistène : Conversation avec Jean-François Lyotard Anne Cauquelin : Les Machines Lyotard Jérôme Glicenstein : Les Immatériaux : exposition, œuvre, événement Evelyne Toussaint : Lyotard avec Duchamp. La condition post-esthétique Claudine Eizykman et Guy Fihman : Aperçus sur la pratique postmoderne de Jean-François Lyotard Jean-Claude Rolland : L’inconscience de la langue. L’apport de Discours, figure à la théorie analytique. IV. APPENDICES Note sur Jean-François Lyotard : Écrits sur l’art contemporain et les artistes / Writings on Contemporary Art and Artits édition bilingue (français-anglais) Leuven Universiy Press (2009-2013) sous la direction de Herman Parret. Gaëlle Bernard : Bibliographie de Jean-François Lyotard
Lyotard et les arts Françoise Coblence, Michel Enaudeau dir. Collectif DATE DE PARUTION : 15/11/14 EDITEUR : Klincksieck COLLECTION : Esthétique ISBN : 978-2-252-03953-3 EAN : 9782252039533 PRÉSENTATION : Broché NB. DE PAGES : 295 p. Sous des formes les plus diverses - catalogues d'expositions, monographies, livres, films, vidéos - Jean-François Lyotard a consacré une part importante de son travail de philosophe à la réflexion sur les arts - musique, cinéma, peinture. Outre la publication d'un entretien inédit à propos de la manifestation "Les Immatériaux" (Centre Georges-Pompidou, 1985), le présent volume propose, pour la première fois, un ensemble conséquent d'études consacré à l'archipel lyotardien des arts. Des lecteurs avertis de la pensée de Lyotard et de plus jeunes chercheurs découvrant l'importance de cette oeuvre philosophique ont été sollicités. Ils donnent ici leur contribution. Leurs études s'attachent à éclairer, à éprouver les concepts - "figurai", "libidinal", "sublime", "immatériau", "matière", "imprésentable", "affect", "écriture" - par lesquels Lyotard rompt avec l'esthétique au sens académique du terme et fait droit à l'occurrence de la couleur ou du son. Avec ces concepts, il indique une constante de sa pensée : résister à la restauration de toute totalisation de l'expérience. Sommaire : I. BOULEVERSEMENTS DANS L'ESTHÉTIQUE - Ouverture : Jean-François Lyotard : La Condition d'amour (La Madone de Monterchi) Jean-Michel Rey : De Freud à Kant Christine Buci-Glucksmann : L'œil aveuglé de l'art Jean-Patrice Courtois : Abstraction, Matière, Matériau et Immatériau chez Jean-François Lyotard Claire Pagès : Lyotard et la sculpture Maud Pouradier : Le signe de l'opéra. Remarques sur la théâtralité de la musique chez Jean-François Lyotard Gérald Sfez : Autrement qu'être en art Jean-François Nordmann : Anamnèse et création : les deux voies finales de sortie de l’esthétique chez Jean-François Lyotard II. ARTS, POLITIQUE - Ouverture Michel Enaudeau : La Fontaine de René Guiffrey Lettre de Jean-François Lyotard à René Guiffrey Gaëlle Bernard : Art et épokhè. Le doute de Lyotard Frédéric Fruteau de Laclos : Lyotard contre Lyotard. Politiques de la sensibilité Jean-Loup Thébaud : Lyotard lecteur d’Adorno Elisabeth de Fontenay : Un généreux coup de force : Le Malraux de Lyotard III. MATÉRIAUX ET PRATIQUES - Ouverture : Bernard Blistène : Conversation avec Jean-François Lyotard Anne Cauquelin : Les Machines Lyotard Jérôme Glicenstein : Les Immatériaux : exposition, œuvre, événement Evelyne Toussaint : Lyotard avec Duchamp. La condition post-esthétique Claudine Eizykman et Guy Fihman : Aperçus sur la pratique postmoderne de Jean-François Lyotard Jean-Claude Rolland : L’inconscience de la langue. L’apport de Discours, figure à la théorie analytique. IV. APPENDICES Note sur Jean-François Lyotard : Écrits sur l’art contemporain et les artistes / Writings on Contemporary Art and Artits édition bilingue (français-anglais) Leuven Universiy Press (2009-2013) sous la direction de Herman Parret. Gaëlle Bernard : Bibliographie de Jean-François Lyotard
↧
J.-F. Lyotard, L'inhumain. Causeries sur le temps
 L'inhumain - Causeries sur le temps Jean-François Lyotard Gaëlle Bernard (Préfacier) DATE DE PARUTION : 25/08/14 EDITEUR : Klincksieck COLLECTION : Continents philosophiques ISBN : 978-2-252-03942-7 EAN : 9782252039427 PRÉSENTATION : Broché NB. DE PAGES : 201 p. Recueil de "causeries" pour la plupart destinées à un large public. Quelques prolongements à l'idée de post-moderne. Les humains emportés dans le développement inhumain, qu'on n'ose plus appeler le progrès. La disparition d'une alternative humaine, politique et philosophique, à ce processus. Seule possible encore, une résistance, appuyée sur l'autre inhumain : la dépossession de soi qui sommeille en chacun, son enfance indomptable. Banalité écrasante, médiatique, des néo-humanismes, qui, aujourd'hui, relèvent la tête. Questions décisives : le temps, la mémoire, la matière. Comment la "vie administrée" (Adorno) les anéantit en les programmant. Comment les arts de la vue, du son et de la pensée en préservent la vérité paradoxale. Jean-François Lyotard, né à Versailles le 10 août 1924 et mort à Paris le 21 avril 1998, est un philosophe français associé au post-structuralisme et surtout connu pour son usage critique de la notion de postmoderne. Aux éditions Klincksieck ont été publiés : Discours, Figure (2002) ; Rudiments païens (2011) ainsi que, sur sa pensée, Lyotard à Nanterre (2010). Sommaire: SI L'ON PEUT PENSER SANS CORPS REECRIRE LA MODERNITE MATIERE ET TEMPS LOGOS ET TEKNE OU LA TELEGRAPHIE LE TEMPS AUJOURD'HUI L'INSTANT NEWMAN LE SUBLIME ET L'AVANT GARDE QUELQUE CHOSE COMME COMMUNICATION SANS COMMUNICATION REPRESENTATION, PRESENTATION, IMPRESENTABLE LA PAROLE, L'INSTANTANE
L'inhumain - Causeries sur le temps Jean-François Lyotard Gaëlle Bernard (Préfacier) DATE DE PARUTION : 25/08/14 EDITEUR : Klincksieck COLLECTION : Continents philosophiques ISBN : 978-2-252-03942-7 EAN : 9782252039427 PRÉSENTATION : Broché NB. DE PAGES : 201 p. Recueil de "causeries" pour la plupart destinées à un large public. Quelques prolongements à l'idée de post-moderne. Les humains emportés dans le développement inhumain, qu'on n'ose plus appeler le progrès. La disparition d'une alternative humaine, politique et philosophique, à ce processus. Seule possible encore, une résistance, appuyée sur l'autre inhumain : la dépossession de soi qui sommeille en chacun, son enfance indomptable. Banalité écrasante, médiatique, des néo-humanismes, qui, aujourd'hui, relèvent la tête. Questions décisives : le temps, la mémoire, la matière. Comment la "vie administrée" (Adorno) les anéantit en les programmant. Comment les arts de la vue, du son et de la pensée en préservent la vérité paradoxale. Jean-François Lyotard, né à Versailles le 10 août 1924 et mort à Paris le 21 avril 1998, est un philosophe français associé au post-structuralisme et surtout connu pour son usage critique de la notion de postmoderne. Aux éditions Klincksieck ont été publiés : Discours, Figure (2002) ; Rudiments païens (2011) ainsi que, sur sa pensée, Lyotard à Nanterre (2010). Sommaire: SI L'ON PEUT PENSER SANS CORPS REECRIRE LA MODERNITE MATIERE ET TEMPS LOGOS ET TEKNE OU LA TELEGRAPHIE LE TEMPS AUJOURD'HUI L'INSTANT NEWMAN LE SUBLIME ET L'AVANT GARDE QUELQUE CHOSE COMME COMMUNICATION SANS COMMUNICATION REPRESENTATION, PRESENTATION, IMPRESENTABLE LA PAROLE, L'INSTANTANE
↧
↧
TDC , n° 1085, déc. 2014: Le voyage imaginaire
 TDC , n° 1085, 1er décembre 2014 – Le voyage imaginaire Le voyage littéraire est souvent une traversée de l’imaginaire : découverte de terres inconnues, exploration spatiale ou temporelle, description de sociétés étranges, idéales ou terrifiantes, les écrivains ont sillonné les territoires les plus insolites. Mais les mondes imaginaires, et en particulier les utopies, sont aussi l’occasion d’un voyage intérieur. « L’Odyssée » d’Homère, l’ « Utopia » de Thomas More, mais aussi les « Voyages extraordinaires » de Jules Verne ou les romans d’anticipation en apportent la preuve : le plaisir de la fiction n’exclut pas, pour le lecteur comme pour l’auteur, la réflexion et l’introspection. Découvrir le sommaire… Aller sur le site de l'éditeur (CNDP)…
TDC , n° 1085, 1er décembre 2014 – Le voyage imaginaire Le voyage littéraire est souvent une traversée de l’imaginaire : découverte de terres inconnues, exploration spatiale ou temporelle, description de sociétés étranges, idéales ou terrifiantes, les écrivains ont sillonné les territoires les plus insolites. Mais les mondes imaginaires, et en particulier les utopies, sont aussi l’occasion d’un voyage intérieur. « L’Odyssée » d’Homère, l’ « Utopia » de Thomas More, mais aussi les « Voyages extraordinaires » de Jules Verne ou les romans d’anticipation en apportent la preuve : le plaisir de la fiction n’exclut pas, pour le lecteur comme pour l’auteur, la réflexion et l’introspection. Découvrir le sommaire… Aller sur le site de l'éditeur (CNDP)…
↧
Transformations du récit de filiation au Québec et en France
Transformations du récit de filiation au Québec et en France Coordin.Katerine Gosselin et Thuy Aurélie Nguyen (Univ. du Québec à Rimouski) Colloque dans le cadre du 83 e congrès de l’ACFAS Université du Québec à Rimouski 27 et 28 mai 2015 Résumé Cinq ans après la parution des principaux travaux sur les récits de filiation contemporains (Dominique Viart, Laurent Demanze, Marine-Emmanuelle Lapointe), ce colloque s’assigne pour objectif de réinterroger la catégorie critique du récit de filiation en regard des transformations récentes du genre et de ses appropriations par une pluralité de formes artistiques narratives au Québec et en France. Argumentaire Ce colloque veut revenir sur une catégorie de récits contemporains définie par la critique universitaire française et québécoise depuis le tournant des années 2000, soit le récit de filiation. Les travaux de Dominique Viart ( États du roman contemporain , 1999; La littérature française au présent , 2008), de Laurent Demanze ( Encres orphelines , 2008) et de Martine-Emmanuelle Lapointe ( Figures de l’héritier dans le roman contemporain , en codirection avec Laurent Demanze, 2009; Transmission et héritages de la littérature québécoise , en codirection avec Karine Cellard, 2012) ont permis de situer cette nouvelle catégorie de récits dans un «renouvellement des formes autobiographiques et des écritures de l’intime» (Demanze et Lapointe, 2009). Les récits de filiation contemporains se présentent ainsi, pour reprendre l’expression de Dominique Viart (2008), comme une investigation détournée «de l’intériorité vers l’antériorité», dans laquelle le sujet contemporain «se construit dans le détour de l’autre, en assimilant à l’intérieur de soi la communauté des ascendants» (Demanze et Lapointe, 2009). En s’appuyant sur ces travaux, ce colloque veut poursuivre et surtout élargir l’étude des récits de filiation contemporains par la prise en compte d’un plus vaste corpus d’œuvres, défini selon de nouveaux critères. Cinq ans après le numéro d’ Études françaises dirigé par Laurent Demanze et Martine-Emmanuelle Lapointe sur les figures de l’héritier dans le roman contemporain, il apparaît nécessaire de réévaluer, à la lumière des parutions récentes, l’état des lieux produit alors. Au Québec, des romans comme L’Énigme du retour de Dany Laferrière (Boréal, 2009) et La Ballade d’Ali Baba de Catherine Mavrikakis (Héliotrope, 2014), de même que, en France, des romans comme Trois femmes puissantes de Marie Ndiaye (Gallimard, 2009) ou Ceux qui reviennent de Maryline Desbiolles (Seuil, 2014), semblent porter un regard renouvelé sur la filiation, qui s’éloigne de l’enquête pour décupler les ressources de la fiction. Ce que Dominique Viart a appelé «le silence des pères» (dans Demanze et Lapointe, 2009) devient dès lors un prétexte pour investir le passé par l’imaginaire, aux limites du fantastique, brouillant les frontières entre les temps, les espaces et les générations. La fortune critique des travaux sur les récits de filiation contemporains a pu avoir pour effet de restreindre le genre à certaines œuvres qui ont contribué à le définir, mais qui n’en épuisent pas pour autant les possibilités et les enjeux. Les différentes études produites à ce jour sur les récits de filiation, de fait, portent sur des corpus qui tendent à se recouper, et qui demeurent relativement homogènes, renvoyant par exemple à une même génération d’écrivains, et rarement d’écrivaines par ailleurs, ou à des pratiques narratives similaires. Nous posons que la filiation et l’enjeu narratif qui lui est associé sont au cœur de plusieurs œuvres contemporaines que les études sur le récit de filiation n’ont pas encore considérées, et qui renouvellent pourtant significativement le genre. Axes et thématiques Cette proposition prend appui sur un numéro récent de Temps zéro , dirigé par Anne Martine Parent et Karin Schwerdtner, intitulé Lacunes et silences de la transmission (2012). Portant sur la figuration et la métaphorisation de l’échec de la transmission dans la littérature contemporaine, ce numéro proposait un élargissement de la notion de transmission, postulant que celle-ci se joue au-delà de l’espace générationnel, «autant dans l’espace du rêve et du fantasme que dans celui des mots et des écrits, tant dans les lectures et les rencontres […] que devant la caméra et sur la scène théâtrale». Ce colloque souhaite montrer comment, dans cet élargissement contemporain de la représentation de la transmission, la quête de filiation générationnelle est elle-même devenue l’objet de multiples métamorphoses et ouvertures, par le métissage culturel et esthétique et le dialogue établi entre les différentes pratiques narratives. Il s’agit de remettre en jeu les acquis des études sur les récits de filiation dans une approche pluridisciplinaire, permettant de comprendre les enjeux communs que soulèvent, dans l’exploration contemporaine de la filiation, les différentes formes d’éclatement des modalités narratives et des espaces de représentation. Les communications de ce colloque s’appuieront ainsi sur la notion de récit de filiation pour prendre en compte différentes œuvres susceptibles d’en élargir et d’en redéfinir les contours, soit (la liste n’est pas exhaustive):qu’elles sont le fait d’une nouvelle génération d’écrivains ou plus spécifiquement d’écrivaines;qu’elles font intervenir conjointement d’autres questionnements contemporains tels l’exil et la migration;qu’elles intègrent le travail narratif à une autre pratique artistique telle le théâtre, la bande dessinée ou le cinéma. Modalités pratiques Les propositions de communication d’environ 300 mots, accompagnées d’une courte notice bio-bibliographique, sont à envoyer conjointement à Katerine Gosselin (katerine_gosselin@uqar.ca) et Thuy Aurélie Nguyen (thuyaurelie.nguyen@uqar.ca) avant le 6 février 2015 . Les auteur-e-s seront informé-e-s de la décision du comité organisateur le 20 février 2015. À noter . L’inscription au congrès de l’ACFAS est obligatoire pour tous les conférenciers (www.acfas.ca/evenements/congres). Aucun remboursement des frais n’est prévu pour le moment.
↧
Cl. Gaetzi, L’art de déjouer le témoignage par la fiction."Verre Cassé" d’Alain Mabanckou
 Claudine Gaetzi L’art de déjouer le témoignage par la fiction. "Verre Cassé" d’Alain Mabanckou Postface de Christine Le Quellec Cottier Lausanne: Archipel Essais, vol. 20, 2014 116 p. ISBN: 9782940355198 18 CHF Présentation de l'éditeur: En affirmant que « la préoccupation de l’auteur africain n’est pas son rapport avec le continent noir », mais qu’elle est « avant tout littéraire, comme pour tout écrivain », Alain Mabanckou partage la position des écrivains de la Migritude et rompt avec les choix des générations précédentes. Désormais, il ne s’agit plus de faire connaître les particularités d’une culture, ni de dénoncer les violences subies, mais de trouver comment exister, en tant qu’écrivain, dans un « entre-deux » instable et délié du territoire géographique, où l’imaginaire est confronté à une permanente circulation des références culturelles. Situation complexe, dont l’ambivalence est redoublée par celle du système littéraire francophone, car la reconnaissance des écrivains émigrés reste attachée, très souvent, à des marqueurs signalant leur altérité ou leur situation périphérique. Cet essai entend saisir de quelle manière Alain Mabanckou parvient à gérer ces attentes en plaçant, au cœur de sa pratique scripturale, la volonté de s’en libérer. L’étude de ses romans, et notamment de Verre Cassé , montre comment l’écrivain construit des intrigues qui, tout en semblant rendre compte de réalités africaines, mettent à mal les codes de représentation réaliste, par leurs scénographies ou par des narrateurs à la parole peu fiable. Alors que certains personnages affirment la nécessité du témoignage – topos de la littérature africaine impliquant engagement et vérité –, le récit déjoue simultanément cette décision. Il se veut, avant tout, une fiction – une feintise.
Claudine Gaetzi L’art de déjouer le témoignage par la fiction. "Verre Cassé" d’Alain Mabanckou Postface de Christine Le Quellec Cottier Lausanne: Archipel Essais, vol. 20, 2014 116 p. ISBN: 9782940355198 18 CHF Présentation de l'éditeur: En affirmant que « la préoccupation de l’auteur africain n’est pas son rapport avec le continent noir », mais qu’elle est « avant tout littéraire, comme pour tout écrivain », Alain Mabanckou partage la position des écrivains de la Migritude et rompt avec les choix des générations précédentes. Désormais, il ne s’agit plus de faire connaître les particularités d’une culture, ni de dénoncer les violences subies, mais de trouver comment exister, en tant qu’écrivain, dans un « entre-deux » instable et délié du territoire géographique, où l’imaginaire est confronté à une permanente circulation des références culturelles. Situation complexe, dont l’ambivalence est redoublée par celle du système littéraire francophone, car la reconnaissance des écrivains émigrés reste attachée, très souvent, à des marqueurs signalant leur altérité ou leur situation périphérique. Cet essai entend saisir de quelle manière Alain Mabanckou parvient à gérer ces attentes en plaçant, au cœur de sa pratique scripturale, la volonté de s’en libérer. L’étude de ses romans, et notamment de Verre Cassé , montre comment l’écrivain construit des intrigues qui, tout en semblant rendre compte de réalités africaines, mettent à mal les codes de représentation réaliste, par leurs scénographies ou par des narrateurs à la parole peu fiable. Alors que certains personnages affirment la nécessité du témoignage – topos de la littérature africaine impliquant engagement et vérité –, le récit déjoue simultanément cette décision. Il se veut, avant tout, une fiction – une feintise.
↧
G. Toniutti, Pour une poétique de l’implicitation. "Cristal et Clarie" ou l’art de faire du neuf avec de l’ancien
 Géraldine Toniutti Pour une poétique de l’implicitation. "Cristal et Clarie" ou l’art de faire du neuf avec de l’ancien Préface de Barbara Wahlen Lausanne: Archipel Essais, vol. 19, 2014 176 p. ISBN: 9782940355181 18 CHF Présentation de l'éditeur: Pour le moins atypique, le roman de Cristal et Clarie se distingue par l’abondance et lavariété des citations, souvent littérales, qui tissent sa trame narrative. Puisées dans la littérature en vers des XII e et XIII e siècles, ces reprises, harmonieusement intégrées au récit, ne sont signalées ni typographiquement, ni par une mention explicite. Dès lors, cet ouvrage, souvent accusé de n’être qu’un simple plagiat, a suscité un intérêt mitigé de la part de la critique. La présente étude se propose de démontrer que les « implicitations » – ou citations cachées – de ce roman témoignent au contraire d’une poétique réfléchie propre à l’auteur. Loin d’être la conséquence d’un prétendu manque d’imagination, les passages empruntés sont prétextes à des détournements parodiques et signifiants. Révélant un vaste réseau de sens, leur analyse fait ainsi apparaître la finesse du projet intertextuel à l’œuvre dans Cristal et Clarie : entre héritage et création.
Géraldine Toniutti Pour une poétique de l’implicitation. "Cristal et Clarie" ou l’art de faire du neuf avec de l’ancien Préface de Barbara Wahlen Lausanne: Archipel Essais, vol. 19, 2014 176 p. ISBN: 9782940355181 18 CHF Présentation de l'éditeur: Pour le moins atypique, le roman de Cristal et Clarie se distingue par l’abondance et lavariété des citations, souvent littérales, qui tissent sa trame narrative. Puisées dans la littérature en vers des XII e et XIII e siècles, ces reprises, harmonieusement intégrées au récit, ne sont signalées ni typographiquement, ni par une mention explicite. Dès lors, cet ouvrage, souvent accusé de n’être qu’un simple plagiat, a suscité un intérêt mitigé de la part de la critique. La présente étude se propose de démontrer que les « implicitations » – ou citations cachées – de ce roman témoignent au contraire d’une poétique réfléchie propre à l’auteur. Loin d’être la conséquence d’un prétendu manque d’imagination, les passages empruntés sont prétextes à des détournements parodiques et signifiants. Révélant un vaste réseau de sens, leur analyse fait ainsi apparaître la finesse du projet intertextuel à l’œuvre dans Cristal et Clarie : entre héritage et création.
↧
↧
Nuno Júdice,le «littoral du poème»
Nuno Júdice, le «littoral du poème» Journée d’étude 8 avril 2015 École Normale Supérieure de Lyon «Venho então para o litoral do poema, debruço-me atento para o movimento inútil das palavras sobre as palavras. Durmo na perpétua imobilidade do poema, nos recantos esquecidos de uma praia inacessível, litoral eterno de viajantes sem navio. E o poema é essa casa abandonada, o rosto belíssimo de imagens mortas.» A Noção de Poema (1972) Argument Nuno Júdice, né en 1949 en Algarve, est considéré comme l’une des voix majeures de la littérature portugaise contemporaine. Entré en écriture au début des années 1970, époque de l’effervescence de la théorie littéraire et d’une conception «objectiviste» séparant le sujet du poème, prônant la réalité matérielle du texte (le langage) et actant la «mort de l’auteur», mais aussi moment de relâchement du régime salazariste et de démembrement de l’empire colonial au Portugal, il publie son premier recueil, A Noção de Poema [La notion de poème] , en 1972. En quatre décennies, et parallèlement à une intense activité critique, essayistique et universitaire, Nuno Júdice est devenu l’auteur d’une œuvre dense, forte et originale, aux croisements des genres (poète, il écrit également de la fiction et pour le théâtre) et des traditions, qui n’a de cesse de se questionner et de se renouveler – en témoigne l’un de ses derniers recueils, Fórmulas de uma Luz Inexplicável , paru en 2012. Signe d’une reconnaissance croissante au-delà des frontières, il devient, en 2013, le second poète portugais à recevoir le prestigieux Prix Reina Sofía de poésie ibéro-américaine décerné en Espagne par l’Université de Salamanque. Son œuvre est traduite dans plus de quinze langues et de vingt pays, en particulier en France, dont il connaît bien la langue et la littérature (il fut conseiller culturel à l'Ambassade du Portugal et directeur du Centre culturel de l'Institut Camões de Paris). Comme celle d’Al Berto, elle fit l’objet, très tôt, d’un intérêt éditorial spécifique, notamment sous l’impulsion de Michel Chandeigne. Il devient ainsi, en 1996, le deuxième auteur portugais à être publié dans la collection «Poésie» des éditions Gallimard, après Fernando Pessoa. Paradoxalement, peu de travaux et d’événements universitaires lui ont été jusqu’à présent consacrés. Cette journée d’étude propose ainsi de porter, en France, un premier regard sur le territoire poétique de l’œuvre judicienne. Après quatre décennies d’écriture et près d’une trentaine de recueils, semble en effet se dessiner un premier itinéraire, une cartographie provisoire de l’œuvre poétique. Si A Noção de Poema [La notion de poème] pose en 1972 le principe d’une écriture métapoétique et spéculative, «fille de 68» et du textualisme, rejetant le «je» pour un monde de langage, une réorientation s’opère au cœur des années 1980 vers un dire ancré dans l’existence et chargé de l’expérience, avec Lira de Líquen [Lyre de lichen] en 1985 et l’élaboration d’une première anthologie poétique, pour se confronter, ensuite, à la matière temporelle et mémorielle par une véritable archéologie intérieure, à partir de Um Canto na Espessura do Tempo [Un chant dans l’épaisseur du temps] en 1992 et Meditação sobre Ruínas [Méditation sur des ruines] en 1995. Cette inflexion témoigne d’une réarticulation lyrique: le poème réinterroge alors le «je» et dialogue avec la tradition élégiaque. Elle s’accompagne d’une écriture crépusculaire pour décrire monde et langage – comme «dévastation de syllabes» ou «corruption du dit» – sous la forme d’un chant ruiné, désenchanté. Il semble que la parole singulière de Júdice, entre hauteur mythique et sobriété de ton, quête métaphysique et narration du quotidien, soit habitée par un tremblement. Selon lui, le langage poétique permet de «mettre en contact plusieurs mondes» et d’en traverser les frontières, «entre l'obscurité de l'intérieur et la lumière du dehors». Le langage apparaît comme un lieu de passage, un intervalle, une forme de «littoralité». Littoralité du poème, seuil vacillant entre intériorité et extériorité; du langage, frôlant parfois la littéralité de la surface; littoralité, bien physique, de la côte portugaise, lieu de saudade et matrice de l’origine; et celle, temporelle, de la trace, d’une voix crépusculaire et tardive. Cette journée comptera sur la présence exceptionnelle du poète et se prolongera par un moment de lectures (dans le cadre de La Scène Poétique, cycle de poésie parlée). Pistes de réflexion Voici quelques pistes de réflexion qui ne sont que des suggestions. Nous encourageons tout particulièrement les approches comparatistes et celles qui chercheront à situer l’œuvre judicienne par rapport aux littératures portugaises et européennes.formes et frontières poétiques: le travail de l’écritureécriture de la ruine et poétique du fragment; un «poème continu»?la question du vers, du maintien de la forme poétiquele poème comme «matière», comme «matière-émotion»rapports aux autres arts, poétique de l’ ekphrasisliens entre l’écriture poétique et le reste de l’œuvre (prose, roman, théâtre)mouvements et pensées du poèmele «je» et l’Histoire, politiques du poèmepoétique des savoirs, sciences et poésiemémoire, nostalgie et mélancolie; une écriture «décadente»?une écriture, une énonciation«lyriques»?; l’amour, la poésie: un renouvellement de la lyrique amoureuse?orientations et cartographies du poèmehéritages et réceptions de l’œuvrerapports aux romantismes (allemand, notamment)traditions et (post)modernités, la tradition comme innovationles traces surréalistestraductions et réceptions de l’œuvre judicienneNuno Júdice et la FranceModalités de participation Les propositions de communication, d’une longueur de 300 mots maximum et accompagnées d’une brève présentation bio-bibliographique, sont à envoyer avant le 25 janvier 2015 à l’adresse suivante: vincent.zonca@ens-lyon.fr . Les langues des communications seront le français (de préférence), ainsi que le portugais, l’espagnol et l’anglais. Organisation Vincent Zonca (ENS de Lyon). Avec le soutien du Centre d’Études et de Recherches Comparées sur la Création (CERCC, EA 1633) de l’ENS de Lyon: http://cercc.ens-lyon.fr .Lieu École Normale Supérieure de Lyon, 15 parvis René Descartes, 69007 Lyon (France).
↧
A. Glinoer, Le littéraire et le social . Bibliographie générale 2014 (site Socius)
Référence bibliographique : Anthony Glinoer, Bibliographie générale Le littéraire et le social , , 2014. Parution de la Bibliographie générale Le littéraire et le social d’Anthony Glinoer sur le site Socius (http://ressources-socius.info) Adresse de consultation : http://ressources-socius.info/index.php/bibliographies/25-bibliographie-generale/135-bibliographie-generale .La Bibliographie générale Le littéraire et le social compte plus de 2000 entrées et, en comptant les tables des matières des ouvrages collectifs et numéros de revues, près de 7000 références d’articles et de livres. De 1904 à 2014, plus d’un siècle de recherches sociales sur le littéraire, du contexte au texte et retour, ont été recensées. Les travaux référencés ont été écrits en français mais aussi en anglais, en allemand, en espagnol, en italien ou encore en néerlandais, sans restriction géographique ou chronologique dans les sujets traités. Un outil de recherche en plein texte permet de retrouver à même la Bibliographie générale les références à des auteurs, des œuvres, des maisons d’édition, etc. Il est aussi possible de faire une recherche générale dans l’ensemble des ressources du site Socius, notamment dans les bibliographies et les bibliographies et les rééditions d’articles. La Bibliographie générale Le littéraire et le social rend disponibles les références à tout ce dont les étudiants et les chercheurs ont besoin pour leur enseignement et leur recherche en sociologie de la littérature, sociocritique, sociopoétique, etc.
↧
Litteraturesmodesdemploi.org: un espace d’exposition numérique
Un espace d’exposition numérique Le site littératuresmodesdemploi.org se présente comme un espace d’exposition numérique. Il a pour vocation d’accueillir et d’archiver des expositions en ligne relatives à la littérature ainsi que leur catalogue le cas échéant. Son objectif est de favoriser la mise en valeur du patrimoine littéraire et la connaissance de l’histoire de la littérature. Il se donne pour finalié d’assurer, de façon non lucrative, la promotion et la diffusion du savoir universitaire relatif à la littérature à l’intention d’un large public. Les expositions hébergées au sein littératuresmodesdemploi.org sont de deux types: - des expositions ayant été précédemment montées dans une institution ; - des expositions inédites, spécifiquement réalisées pour le site. Ce projet, rendu possible par l’obtention d’un prix du Fonds Wernaers pour la vulgarisation scientifique ( Fonds de la recherche scientifique – FNRS ) pour la recherche et la diffusion des connaissances, vise à constituer une plateforme qui tienne lieu d’interface dynamique entre les institutions scientifiques et muséales, les chercheurs et le public. En offrant de nouvelles possibilités de développement à l’exposition de la littérature, ce site est destiné à présenter et interroger les diverses formes de la vie littéraire au cours des siècles, en offrant en libre accès des expositions en ligne. À partir du premier quadrimestre 2015, il présentera également une section destinée à accueillir des comptes rendus d’expositions consacrées à la littérature. Origine du projet Ce site résulte de la collaboration entre des personnalités du monde muséal et des universitaires autour d’un projet commun: la médiation de la connaissance et de la recherche littéraire actuelle par des objets et des documents. L’exposition « Ecrivains: modes d’emploi. De Voltaire à bleuOrange (revue hypermédiatique) », organisée au Musée royal de Mariemont (Belgique) de novembre 2012 à février 2013, a été la première matérialisation de ce projet. Comme le laisse entendre l’adjectif «hypermédiatique», présent dans le titre de cette exposition, la question du numérique est non seulement au cœur de nombre de pratiques culturelles et littéraires contemporaines, mais elle constitue aussi un objet d’interrogation central pour de nouveaux domaines de recherche inscrits au sein du mouvement des Humanités numériques (Digital Humanities). Cette plateforme d’exposition s’inscrit dans cette dynamique. Le caractère prospectif de ce site implique en effet le recours à des technologies hypermédiatiques, et par conséquent une adaptation constante aux nouvelles possibilités qu’elles offrent pour rendre compte des réalités exposées et les donner à appréhender de façon optimale. Le site a donc vocation à évoluer régulièrement afin d’exploiter au mieux les mutations technologiques les plus récentes. Proposer une exposition Si vous souhaitez proposer une exposition, il convient de faire parvenir un projet détaillé aux directeurs du site. Ce projet ne dépassera pas deux pages (1500 mots). Il décrira synthétiquement la teneur de l’exposition ainsi que son contexte scientifique et institutionnel. Il comprendra en outre une estimation aussi précise que possible du nombre de pièces à exposer ainsi que, s’il y a lieu, la forme que revêtira le catalogue. S’il est approuvé par le comité de direction du site, le projet sera soumis à l’évaluation de deux membres du comité scientifique ou, selon les spécialisations, à des évaluateurs externes. Toutes les autorisations de reproduction de documents sur le site devront être obtenues par les commissaires de l’exposition.
↧
Le dialogue de la littérature et des arts: croisements, interférences, mutations
Journée d’études en littérature organisée le samedi 10 janvier 2015 (10h-16h30) Médiathèque L’Astrolabe 25 rue du Château 77008 Melun Le dialogue de la littérature et des arts: croisements, interférences, mutations Organisée par Manuelle DUSZYNSKI (PRAG, Doctorante UPEC) et Karine GROS (Maître de Conférences UPEC) La littérature et les arts ont établi des liens privilégiés, inscrits très tôt dans la formule d’Horace, «Ut pictura poiesis». La peinture, en particulier, a donc très tôt constitué un modèle, une référence pour les hommes de Lettres. En prenant en compte les nouveaux champs d’étude comme l’intertextualité et l’intermédialité, notre intention est de dégager les nouveaux motifs et les nouvelles modalités de dialogue entre la littérature et les arts dans la multiplicité et l’hétérogénéité des courants artistiques du vingtième siècle et de l’époque contemporaine. La réflexion portera sur différents axes de ce dialogue: on pourrait envisager d’abord les interférences entre le texte littéraire et les arts sous les aspects de la «citation» (au sens large) et les effets qui en découlent. Ainsi, par exemple, N. Arambasin envisage-t-elle l’art contemporain en soulignant que «La peinture fait écrire et c’est en retour cette écriture qui devient la condition de lisibilité de la peinture» («Le parallèle arts et littérature», Revue de Littérature Comparée , 2, 2001). Il serait intéressant d’observer également les convergences entre formes artistiques et formes littéraires: des courants récents, comme l’art minimal par exemple, ont-ils pu influencer des courants, sinon des formes littéraires? De manière plus générale, dans quelle mesure les écritures contemporaines, françaises comme étrangères, se trouvent-elles en dialogue avec les arts (ses formes, son statut, ses enjeux), et favorisent-elles une interrogation neuve du monde, de soi et d’autrui? Enfin, nous souhaitons mener la réflexion jusqu’aux mutations récentes du livre: comment littérature et arts se rencontrent-ils dans l’objet même qui porte le texte? Quels modes de lecture cette rencontre induit-elle? L’album graphique, le livre d’artiste, le livre numérique permettront d’interroger les frontières entre littérature et arts. Contact: Karine GROS, Maître de conférences UPEC, karine.gros@u-pec.fr Manuelle DUSZYNSKI, doctorante, UPEC, manuelle.duszynski@u-pec.fr Bibliographie: Sabrinelle Bedrane, Françoise Revaz, Michel Viegnes (dir.), Le récit minimal, du minime au minimalisme: littérature, arts, média , Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2012. Danier Bergez, Littérature et peinture, A. Colin, 2004. Gérard Denizeau, Le dialogue des arts: architecture, peinture, sculpture, littérature, musique, Larousse, 2008.Sophie Van der Linden, Album[s] , DeFacto-Actes Sud, 2013. Yves Michel Ergal et Michèle Fink (dir.), Littérature comparée et correspondance des arts , Presses universitaires de Strasbourg Karine Gros (dir.) Reflets, costumes et illusions, Les habits d’emprunt dans la création contemporaine, 2014, Presses Universitaires de Rennes, 2014. Yves Peyré, Peinture et poésie, Le dialogue par le livre , Gallimard, 2001. Laurence Richer (dir.), Le dialogue des arts , CEDIC, diffusion Librairie Champion, 2002. Programme de la Journée D’études 10h: Ouverture par Manuelle DUSZYNSKI et Karine GROS 10h 15 :Gérard Denizeau (historien d’art, musicologue et écrivain français): Introduction à la problématique de la journée d’études 10h40: Saïm Voussad (maître de conférences à l'ENS de Bouzaréah, Alger): « La couleur ou l’autre manière de s’écrire: l’exemple de Yacine Kateb» Discussion (10mn) 11h10: Leo Lecci (professeur-chercheur à l'Université de Gênes, Italie): « Italo Calvino et l’art figuratif» 11h30: Marc Bubert (Lycée français du Luxembourg): ALS IXH XAN, Quand se dessine un triptyque sous la plume de Marguerite Yourcenar Discussion (10mn) Pause Déjeuner(12h15-14h) 14h: Aurélia GOURNAY (Université Paris III, Sorbonne Nouvelle): «Postérité littéraire du Don Giovanni de Mozart: entre intermédialité et critique créative» 14h20: Margaux VAN UYTVANCK (Master en Histoire de l'Art et Archéologie de l'Université libre de Bruxelles, Maître en Etudes Culturelles, KU Leuven): «Entre lisibilité et visibilité, le mot chez Marcel Broodthaers et Stéphane Mallarmé» Discussion (10mn) 14h50 : Alice RIME (Doctorante, Université Paris 8): «Lieu d’une rencontre entre danse et littérature: Livres d’artistes chorégraphiques» 15h10 : Marie KONDRAT (Ecole Normale Supérieure, Paris): «Narration cinéphile: reconfigurations du rapport texte/image dans la fiction contemporaine» Discussion (10mn) 15h40: Visite de la Médiathèque L’Astrolabe 16h20-16h30: Clôture de la journée d’études
↧
↧
Les mondes de Labiche
Colloque international «Les mondes de Labiche» (dans le cadre du bicentenaire de la naissance d’Eugène Labiche) Paris, les 8-10 octobre 2015 Organisé par :Olivier Bara, université Lyon 2 Violaine Heyraud, université Sorbonne-Nouvelle Jean-Claude Yon, université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines Avec le soutien des équipes de recherche: UMR 5611 LIRE, CRP19 (Sorbonne Nouvelle), CHCSC (UVSQ) Et des institutions: BnF, SACD, théâtre du Palais-Royal Comité scientifique : Olivier Bara, université Lyon 2, Patrick Besnier, université du Maine, Barbara T.Cooper, université du New Hampshire, Joël Huthwohl, Bibliothèque nationale de France, Violaine Heyraud, université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, Roxane Martin, université de Lorraine, Isabelle Moindrot, université Paris 8-Vincennes-Saint-Denis, Jean-Claude Yon, université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. Appel à communication Il y a deux cents ans, le 6 mai 1815, Labiche venait au monde dans un siècle d’intense activité théâtrale. Il s’empare de la comédie et du vaudeville et occupe bientôt, dès le début des années 1850, une place de premier plan dans le paysage littéraire et dramatique. Labiche reste, jusqu’à aujourd’hui, l’une des plus illustres figures du répertoire léger, par une production aussi décisive que féconde,dont la publication de ses œuvres «complètes», une fois sa carrière terminée en 1878-1879, n’offre qu’une sélection. À l’occasion de ce bicentenaire, notre colloque se propose de réexaminer la place et l’influence de Labiche dans l’histoire du théâtre mais aussi dans l’histoire culturelle du xix e siècle. S’inscrivant dans la lignée du colloque Scribe, organisé en 2011 pour les 150 ans de la mort du l’auteur de L’Ours et le Pacha , et du colloque Feydeau organisé en 2012 pour les 150 ans de la naissance de l’auteur d’ Un fil à la patte , ce colloque du bicentenaire Labiche entend poursuivre la redécouverte de ces trois maîtres du vaudeville dont les répertoires sont désormais un sujet d’étude légitime au sein de l’histoire des spectacles. Il peut être tentant de considérer le théâtre de divertissement comme un monde étriqué, limité à la représentation de bourgeois bien-pensants, replié sur son public, garrotté par les contraintes génériques d’un vaudeville bien français. Pourtant, le théâtre de Labiche est au centre d’enjeux historiques, économiques, politiques et esthétiques fondamentaux pour comprendre le xix esiècle; bien plus, il rayonne au-delà des frontières, inspire d’autres artistes. Concentrant autour de lui des collaborateurs de talent, Labiche se prête aux expérimentations comiques. Entouré d’acteurs fidélisés, il encourage aussi aux variations dans le jeu vaudevillesque. Son théâtre reflète un goût pour l’ailleurs: ses bourgeois voyagent, se rêvent Incas, ou hors-la-loi. Ce dramaturge s’est aussi tourné vers la critique, a endossé des responsabilités politiques, a obtenu la reconnaissance institutionnelle. Comment revendiquer l’influence d’Eugène Scribe dans l’art de la comédie et du vaudeville tout en participant à la rénovation des formes dramatiques? Comment multiplier les «pochades» à succès au Palais-Royal tout en rêvant de laisser une grande comédie de mœurs au répertoire du Théâtre-Français? Comment faire rire ses contemporains quand on subit la concurrence de l’opéra-bouffe offenbachien? Quel discours la comédie tient-elle alors sur les mœurs, sur le monde économique, social, politique? Quels différents mondes ce «voyage autour de Labiche» permet-il de toucher? Voici quelques unes des questions que ce colloque se propose de soulever, dans une perspective pluridisciplinaire. Les contributions pourront s’inscrire dans les axes suivants: I- Les mondes fréquentés par Labiche : ses collaborateurs, ses acteurs, les directeurs de théâtre, ses confrères fréquentés à la SACD, les écrivains de son temps, les académies et les mondes littéraires, journalistiques ou artistiques, le monde politique parisien et provincial. II- Les mondes représentés par Labiche : les types et les caractères, les classes sociales et les milieux (la bourgeoisie, le peuple), les stéréotypes nationaux et culturels, la République (pièces de 1848-1849), le Second Empire, l’argent, le mariage, l’amour, le crime. III- Les mondes créés par Labiche : les genres et les sous-genres dramatiques, les formes et les dramaturgies, la langue, la mise en scène, la décoration et la scénographie, les costumes et le jeu d’acteur (notamment à travers les dessins de Lhéritier). IV- Labiche à travers le monde : en province, en français à l’étranger, en traduction à l’étranger, dans la critique de son temps. V- Le monde après Labiche : les adaptations lyriques, les adaptations cinématographiques, le devenir éditorial de l’œuvre, la présence dans les manuels scolaires. Les propositions de communication devront nous parvenir, sous la forme d’un titre provisoire et d’un résumé d’une quinzaine de lignes, avec un CV d’une demi-page, pour le 15 février 2015 . Elles seront examinées par le comité scientifique. Adresses: bara.olivier@wanadoo.fr , violaine.heyraud@univ-paris3.fr , jeanclaudeyon@wanadoo.fr
↧
Laurent Zimmermann (dir), L’Anticipation (revue Textuel )
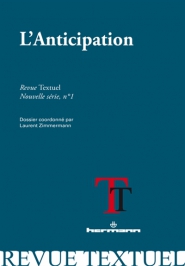 Laurent Zimmermann (dir), L’Anticipation Revue Textuel , nouvelle série, n°1 Editions Hermann 2014 208 p. ISBN : 978-2-7056-8950-6 Comment penser le rapport des arts à l’anticipation, leur capacité d’anticipation et ce qu’ils peuvent anticiper? Comment penser ou mettre en jeu ce pas en avant qui permet de saisir le réel autrement que selon les lois du présent? Ce volume éclaire le déploiement de l’anticipation dans ses formes (la prolepse, la prophétie, la prédiction…), dans ses objets (que peut-on anticiper?), mais aussi et surtout dans ses enjeux poétiques, esthétiques et philosophiques. Hélène BATY-DELALANDE, Entretien avec François Hartog du 13 mars 2014: «La stupeur contre l’anticipation, un présent bloqué?» Laurent ZIMMERMANN, Dossier Anticipation , présentation Michel DEGUY, «Le siècle sera scientifique… et ne sera pas» Christophe KIHM et Peter SZENDY, «Dialogue sur l’art extraterrestre» Alexandre GEFEN, «Ce qu’il y a d’ancien dans Internet» Laurent ZIMMERMANN, «Tempelhof pour l’instant. Mémoire et anticipation» Lise CHARLES, « Les incertitudes de l’anticipation» Hélène BATY-DELALANDE, «Anti-mémoire, sur 14 de Jean Echenoz» Laure DEPRETTO, «Le moment venu» Enrique SCHMUKLER, «Un cimetière, une paupière et un œil: anticipations du roman 2666 dans l’œuvre de Roberto Bolaño» Simon BREAN, «Les récits d’anticipation, des prophéties fictionnelles?» Philippe BECK, «Boustrophe, science-fictionet regret du futur : le Dépaysan» Sébastien RONGIER, «Les corps fantômes de Derrida» Céline BARRAL, «L’anticipation réticente du polémiste» Véronique TRAVERSO, «La projection, un processus d'anticipation moteur dans l'interaction» Sylvie PATRON, «Linguistique et littérature: dissiper les idées reçues» Shlomith RIMMON-KENAN, «Quand le modèle néglige le médium. Réflexions sur le langage, la linguistique et la crise de la narratologie»
Laurent Zimmermann (dir), L’Anticipation Revue Textuel , nouvelle série, n°1 Editions Hermann 2014 208 p. ISBN : 978-2-7056-8950-6 Comment penser le rapport des arts à l’anticipation, leur capacité d’anticipation et ce qu’ils peuvent anticiper? Comment penser ou mettre en jeu ce pas en avant qui permet de saisir le réel autrement que selon les lois du présent? Ce volume éclaire le déploiement de l’anticipation dans ses formes (la prolepse, la prophétie, la prédiction…), dans ses objets (que peut-on anticiper?), mais aussi et surtout dans ses enjeux poétiques, esthétiques et philosophiques. Hélène BATY-DELALANDE, Entretien avec François Hartog du 13 mars 2014: «La stupeur contre l’anticipation, un présent bloqué?» Laurent ZIMMERMANN, Dossier Anticipation , présentation Michel DEGUY, «Le siècle sera scientifique… et ne sera pas» Christophe KIHM et Peter SZENDY, «Dialogue sur l’art extraterrestre» Alexandre GEFEN, «Ce qu’il y a d’ancien dans Internet» Laurent ZIMMERMANN, «Tempelhof pour l’instant. Mémoire et anticipation» Lise CHARLES, « Les incertitudes de l’anticipation» Hélène BATY-DELALANDE, «Anti-mémoire, sur 14 de Jean Echenoz» Laure DEPRETTO, «Le moment venu» Enrique SCHMUKLER, «Un cimetière, une paupière et un œil: anticipations du roman 2666 dans l’œuvre de Roberto Bolaño» Simon BREAN, «Les récits d’anticipation, des prophéties fictionnelles?» Philippe BECK, «Boustrophe, science-fictionet regret du futur : le Dépaysan» Sébastien RONGIER, «Les corps fantômes de Derrida» Céline BARRAL, «L’anticipation réticente du polémiste» Véronique TRAVERSO, «La projection, un processus d'anticipation moteur dans l'interaction» Sylvie PATRON, «Linguistique et littérature: dissiper les idées reçues» Shlomith RIMMON-KENAN, «Quand le modèle néglige le médium. Réflexions sur le langage, la linguistique et la crise de la narratologie»
↧
Skén&Graphie , n°2, "Paroles de danseurs et de chorégraphes"
 Référence bibliographique : Skén&Graphie , n°2, "Paroles de danseurs et de chorégraphes", Presses Universitaires de Franche-Comté, collection "Annales Littéraires de Franche-Comté", 2015. EAN13 : 9782848674957. avec un dossier critique coordonné par Pauline Chevalier et Delphine Vernozy, numéro sous la direction de Pascal Lécroart et Julia Peslier 216 pages. Bon de souscription courant jusqu'au 20 janvier 2015 [pièce jointe ci-dessous] Prix en souscription : 9,60 euros (en envoyant le formulaire joint aux Annales littéraires de Franche-Comté) Prix public 12 euros (à partir du 20 janvier) Skén&Graphie , dans son n° 2, poursuit sa traversée pluridisciplinaire et comparatiste des écritures de et pour la scène. Le Cahier Critique est consacré à la place du discours et du geste dans le travail chorégraphique, qu’il s’agisse des mots que le chorégraphe utilise pour guider ses interprètes, de ceux par lesquels chorégraphes et danseurs font retour sur leurs expériences, de ceux encore qui cherchent à orienter la réception. Il présente quelques perspectives sur l’actualité critique en ligne et en librairie. Le Cahier de la Création donne à découvrir deux inédits : la pièce radiophonique Le Kojiki de Yan Allegret et Carleton de Thomas Hürlimann dans la traduction de Maurice Taszman. Le Cahier des Spectacles et des Professionnels accueille les chroniques des spectacles suivants: Le Voyage d’hiver de Fanny de Chaillé d’après G. Perec et Twelfth Night monté par Bérangère Jannelle, et poursuit, avec Puck , son étude des revues de théâtre. Avec les contributions de : David Ball, Pauline Chevalier, Aurore Després, Dominique Dupuy, Mariem Guellouz, Chantal Lapeyre-Desmaison, Pascal Lécroart, Anaïs Loison, Catherine Mazellier-Lajarrige, Cécile Obligi, Julia Peslier, Stéphane Piochaud, Marie Quiblier, Cécile Schenck, Claude Sorin, Maurice Taszman (traducteur), Laura Soudy, Delphine Vernozy ----------------------------------- Sommaire Édito 5 Carnet critique Dossier. «Le mot et le geste: paroles de danseurs et de chorégraphes» Coordonné par Pauline Chevalier et Delphine Vernozy Chantal Lapeyre-Desmaison , «Nick Nguyen, Les Folies d’Espagne: Dire la danse perdue» Mariem Guellouz , «La métaphore à l’épreuve de la danse contemporaine» Dominique Dupuy , Entretien, propos recueillis par Laura Soudy Marie Quiblier , « Ob-scène ou l’expérience de l’interprète mise à l’essai» Claude Sorin , «Les Voix de la danse. Paroles de radio – archives de danses» Pauline Chevalier , «“Concepts in performance”: écrire et décrire la danse, contre l’interprétation» Anaïs Loison , «Avertir, déconseiller, interdire : ambiguïtés du discours du chorégraphe sur son œuvre» Actualité critique. Le Web et la Librairie. Cécile Obligi , «Les archives du web à la BnF: un formidable gisement à venir exploiter» Aurore Després , «Regards sur l'archive audiovisuelle dans la critique et la recherche en danse. Sur la création de «FANA Danse Contemporaine» Julia Peslier , «Ponctuer/Respirer: une mise au point» [À propos de Tsai Ming-liang, Les Chiens errants et de Peter Szendy, À coups de points. La ponctuation comme expérience ]Cahier photo Joanne Leighton , Exquisite Corpse (2012) Carnet de la création Inédit Yan Allegret , Le Kojiki. Demande à ceux qui dorment [Extraits]. Création radiophonique pour France Culture - Julia Peslier , «Présentation de la pièce radiophonique Le Kojiki » - Scène 2 «Avant le ventre des mères»; scène 5 «Faire l’amour au monde» et scène 6 «Nommer le monde» Traduction Thomas Hürlimann , Carleton , traduction de Maurice Taszman - Catherine Mazellier-Lajarrige , «Présentation de la pièce Carleton » - ActeI. «Le Libretto»; ActeII. «La plaine crie famine», scènes1 et 7; ActeIII. «Le voyage en Russie», scène1; ActeVII. «Adieu» Carnet des spectacles et des professionnels Chroniques Cécile Schenck , «Fanny de Chaillé, Le Voyage d’hiver : mots croisés avec Georges Perec » David Ball ,« Twelfth Night monté par Bérangère Jannelle: une mise en scène économe et inventive» Vie des compagnies Joseph Melcore , Entretien, propos recueillis par David Ball Histoire des revues Stéphane Piochaud , «La revue Puck : la recherche au service d’un art» Liste des contributeurs
Référence bibliographique : Skén&Graphie , n°2, "Paroles de danseurs et de chorégraphes", Presses Universitaires de Franche-Comté, collection "Annales Littéraires de Franche-Comté", 2015. EAN13 : 9782848674957. avec un dossier critique coordonné par Pauline Chevalier et Delphine Vernozy, numéro sous la direction de Pascal Lécroart et Julia Peslier 216 pages. Bon de souscription courant jusqu'au 20 janvier 2015 [pièce jointe ci-dessous] Prix en souscription : 9,60 euros (en envoyant le formulaire joint aux Annales littéraires de Franche-Comté) Prix public 12 euros (à partir du 20 janvier) Skén&Graphie , dans son n° 2, poursuit sa traversée pluridisciplinaire et comparatiste des écritures de et pour la scène. Le Cahier Critique est consacré à la place du discours et du geste dans le travail chorégraphique, qu’il s’agisse des mots que le chorégraphe utilise pour guider ses interprètes, de ceux par lesquels chorégraphes et danseurs font retour sur leurs expériences, de ceux encore qui cherchent à orienter la réception. Il présente quelques perspectives sur l’actualité critique en ligne et en librairie. Le Cahier de la Création donne à découvrir deux inédits : la pièce radiophonique Le Kojiki de Yan Allegret et Carleton de Thomas Hürlimann dans la traduction de Maurice Taszman. Le Cahier des Spectacles et des Professionnels accueille les chroniques des spectacles suivants: Le Voyage d’hiver de Fanny de Chaillé d’après G. Perec et Twelfth Night monté par Bérangère Jannelle, et poursuit, avec Puck , son étude des revues de théâtre. Avec les contributions de : David Ball, Pauline Chevalier, Aurore Després, Dominique Dupuy, Mariem Guellouz, Chantal Lapeyre-Desmaison, Pascal Lécroart, Anaïs Loison, Catherine Mazellier-Lajarrige, Cécile Obligi, Julia Peslier, Stéphane Piochaud, Marie Quiblier, Cécile Schenck, Claude Sorin, Maurice Taszman (traducteur), Laura Soudy, Delphine Vernozy ----------------------------------- Sommaire Édito 5 Carnet critique Dossier. «Le mot et le geste: paroles de danseurs et de chorégraphes» Coordonné par Pauline Chevalier et Delphine Vernozy Chantal Lapeyre-Desmaison , «Nick Nguyen, Les Folies d’Espagne: Dire la danse perdue» Mariem Guellouz , «La métaphore à l’épreuve de la danse contemporaine» Dominique Dupuy , Entretien, propos recueillis par Laura Soudy Marie Quiblier , « Ob-scène ou l’expérience de l’interprète mise à l’essai» Claude Sorin , «Les Voix de la danse. Paroles de radio – archives de danses» Pauline Chevalier , «“Concepts in performance”: écrire et décrire la danse, contre l’interprétation» Anaïs Loison , «Avertir, déconseiller, interdire : ambiguïtés du discours du chorégraphe sur son œuvre» Actualité critique. Le Web et la Librairie. Cécile Obligi , «Les archives du web à la BnF: un formidable gisement à venir exploiter» Aurore Després , «Regards sur l'archive audiovisuelle dans la critique et la recherche en danse. Sur la création de «FANA Danse Contemporaine» Julia Peslier , «Ponctuer/Respirer: une mise au point» [À propos de Tsai Ming-liang, Les Chiens errants et de Peter Szendy, À coups de points. La ponctuation comme expérience ]Cahier photo Joanne Leighton , Exquisite Corpse (2012) Carnet de la création Inédit Yan Allegret , Le Kojiki. Demande à ceux qui dorment [Extraits]. Création radiophonique pour France Culture - Julia Peslier , «Présentation de la pièce radiophonique Le Kojiki » - Scène 2 «Avant le ventre des mères»; scène 5 «Faire l’amour au monde» et scène 6 «Nommer le monde» Traduction Thomas Hürlimann , Carleton , traduction de Maurice Taszman - Catherine Mazellier-Lajarrige , «Présentation de la pièce Carleton » - ActeI. «Le Libretto»; ActeII. «La plaine crie famine», scènes1 et 7; ActeIII. «Le voyage en Russie», scène1; ActeVII. «Adieu» Carnet des spectacles et des professionnels Chroniques Cécile Schenck , «Fanny de Chaillé, Le Voyage d’hiver : mots croisés avec Georges Perec » David Ball ,« Twelfth Night monté par Bérangère Jannelle: une mise en scène économe et inventive» Vie des compagnies Joseph Melcore , Entretien, propos recueillis par David Ball Histoire des revues Stéphane Piochaud , «La revue Puck : la recherche au service d’un art» Liste des contributeurs
↧