Référence bibliographique : P. Bayle, Dictionnaire historique et critique , Belles lettres, 2014. Dictionnaire historique et critique Pierre Bayle, éd. Alexandre Laumonier Date de parution : 14/11/14 Editeur : Belles Lettres Collection : Graphê ISBN : 978-2-251-15003-1 EAN : 9782251150031 Nb. de pages : 300 p. Le Dictionnaire historique et critique de Pierre Bayle est un monument éditorial souvent cité mais peu lu. Cette réédition partielle (avec la mise en page tabulaire originelle) contient 39 entrées concernant la philosophie et la religion. Le Dictionnaire historique et critique de Pierre Bayle a marqué son époque en raison du travail titanesque de Pierre Bayle pour corriger les erreurs historiques contenues dans les précédents dictionnaires d'envergure qui furent publiés au XVIIe siècle. L'objectif de Pierre Bayle est donc de corriger et de commenter les propos tenus par d'autres auteurs, mais aussi d'y apporter un appareil critique conséquent. Ce travail historiographique – qui concerne principalement les religions et la philosophie – aboutira à la première édition du Dictionnaire en 1697, sous forme de deux volumes. Pierre Bayle continuera ensuite à corriger ses propres erreurs, jusqu'à la cinquième édition du Dictionnaire en 1734, considérée comme l'édition définitive (les éditions suivantes sont soit des copies, soit ne comportent pas la mise en page originelle). Le travail historiographique de Pierre Bayle prend la forme d'une mise en page complexe, où se déploie l'érudition et le travail de critique de Bayle. Le texte principal est souvent composé d'une ou deux lignes en haut de la page, prenant toute la largeur de la page. En dessous de ce texte principal, en deux colonnes, se trouvent ce que Bayle appelle des "Remarques", qui sont en réalité le cœur même du Dictionnaire, là où il y a le plus à lire. À gauche et à droite de chaque page se trouve deux petites colonnes marginales où se trouvent toutes les références bibliographiques de Bayle. Chaque page a donc quatre espaces graphiques différents : 1) Le texte principal, 2) Les remarques, 3) En marge et en haut, les notes du texte principal, 4) En marge et en bas, les notes des Remarques. Ce système tabulaire, lointain héritage des mises en page des Bibles glosées, fait partie intégrante du projet critique de Pierre Bayle… mais aucune réédition (totale ou partielle) de cet ouvrage n'existe depuis 1802 avec cette mise en page tabulaire. La réédition du Dictionnaire en 2014 avec sa forme graphique originelle constitue donc un événement. La préface d'Alexandre Laumonier porte sur la manière dont il a recréé la maquette et ensuite mis en page, algorithme à l'appui, le Dictionnaire.
↧
P. Bayle, Dictionnaire historique et critique (éd. A. Laumonier)
↧
Opéra-comique & politique dans l’Europe des Lumières
Opéra-comique et politique dans l’Europe des Lumières Appel à contributions Colloque pluridisciplinaire à Trondheim, au Musée National des Instruments de Musique, du 16 au 17 avril 2015. Organisé par Martin Wåhlberg et Pierre Frantz avec le soutien du Conseil norvégien de la recherche et du Département de musique de l’Université des sciences et techniques de Norvège, Trondheim. L’opéra-comique est né de la parodie et s’inscrit d’emblée dans une position ambigüe avec le pouvoir. Si l’histoire fascinante de la naissance de l’opéra-comique dans les foires à Paris au début du dix-huitième siècle a attiré depuis longtemps les approches qui mettent l’accent sur le rapport entre théâtre et société, il n’en va pas de même avec le second versant de l’opéra-comique, la comédie mêlée d’ariettes, qui marque la deuxième moitié du dix-huitième siècle et qui repose sur des situations tirées de la vie contemporaine sans pour autant hésiter à employer divers formes d’évasion comme le conte merveilleux ou historique pour jeter sur la société du temps un regard distancié. On sait combien ces types de relations entre l’œuvre artistique et les aspects religieux, politiques ou sociaux ont fait l’objet d’études dans tous les domaines artistiques, et notamment dans l’histoire littéraire, en ce qui concerne le dix-huitième siècle. La comédie mêlée d’ariettes n’a pas, elle, été abordée de façons systématique de ce point de vue. La richesse du répertoire, recensé dans le catalogue récent de David Charlton et Nicole Wild, donne un corpus important. De très nombreuses questions restent à éclaircir. Désormais accessibles dans plusieurs bases de données privées et publiques, et également dans des moteurs de recherche, une grande partie de ces pièces sont plus facilement accessibles aux chercheurs à présent. Le colloque sera consacré à une approche politique de l’opéra-comique (thématique, instrumentalisations diverses, censure) à partir de la naissance de la comédie mêlée d’ariettes jusqu’au début du dix-neuvième siècle. Seront donc bienvenues aussi bien les contributions qui concernent la période prérévolutionnaire en Europe que celles qui visent la situation du théâtre révolutionnaire. L’opéra-comique de la seconde moitié du dix-huitième siècle connut une grande expansion au niveau européen et les succès des œuvres françaises, en original ou en traduction, ainsi que les pièces inspirées du modèle français, en Angleterre, dans les pays de langue allemande, dans l’Europe de l’Est, en Russie, dans la Scandinavie et même en Italie sont connus. Les contributions, dans leur ensemble, replaceront la comédie mêlée d’ariettes dans son contexte européen. Le colloque couvrira tout type de relations entre la forme de la comédie mêlée d’ariettes et les questions politiques, y compris les problèmes soulevés par les théoriciens du dix-huitième siècle et les questions inhérentes à la pratique des auteurs et des compositeurs. Seront également étudiés les situations politiques de l’opéra-comique dans tel ou tel pays ainsi que les divers systèmes d’approbation et de censure vis-à-vis du répertoire. Seront abordés aussi les causes ou affaires politiques où les auteurs et les compositeurs s’impliquent de manière explicite ou implicite. Modalités de soumission Le colloque sera ouvert à toutes les approches méthodologiques et théoriques, de l’histoire littéraire, des études de théâtre et des études musicologiques. Les communications se feront en anglais ou en français selon le choix des contributeurs. Projets de communication à envoyer à martin.wahlberg@ntnu.no avant le 1er février 2015.
↧
↧
Voltaire, Œuvres complètes de Voltaire , t. 79B : Religious works of 1776
Œuvres complètes de Voltaire , tome 79B: Religious works of 1776 Ed.Graham Gargett, Antonio Gurrado et Laurence Macé ISBN978-0-7294-1020-5,xviii,564 pages, £115.00. Un chrétien contre six Juifs, éd . Graham Gargett Histoire de l’établissement du christianisme, éd . Antonio Gurrado et Laurence Macé Ces deux textes sont les derniers ouvrages que Voltaire ait écrit contre le christianisme et l’autorité de la Bible et en faveur du déisme et de la tolérance. Parution de la Voltaire Foundation, dans la collection des Œuvres complètes de Voltare .Pour des renseignements complémentaires sur ce volume: http://xserve.volt.ox.ac.uk/VFcatalogue/details.php?recid=6545 Pour tout autre renseignement, ou pour passer une commande: http://www.voltaire.ox.ac.uk/www_vf/books/orders.ssi Pour tout renseignement complémentaire merci de contacter email@voltaire.ox.ac.uk
↧
J. Meizoz, Saintes colères. Dix-sept travaux publics
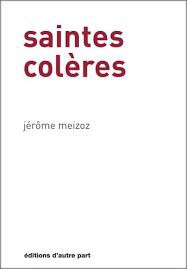 Jérôme Meizoz Saintes colères. Dix-sept travaux publics Genève: Editions d'Autre part, 2014 11,5x16,5 cm / 160 pages ISBN: 9782940518173 20 € / 26 CHF Présentation de l'éditeur: Il y a le romancier, le professeur de littérature. Il y a aussi le citoyen, l’intellectuel agissant et engagé: c’est ainsi que Jérôme Meizoz entrevoit son «être au monde». Il rassemble ici dix-sept plaidoyers pour la tolérance, l’ouverture au monde, contre les dérives identitaires et la morgue des nantis. Ces saintes colères sont une sorte d’ Indignez-vous à la sauce helvétique. Textes autour de Henry Roorda, Blaise Cendrars, Joël Dicker, Slobodan Despot, Richard Millet, Edouard Louis, etc. Jérôme Meizoz , né en Valais en 1967, est professeur à l'Université de Lausanne. Il a publié une dizaine de livres de fiction et tout autant d’ouvrages théoriques.
Jérôme Meizoz Saintes colères. Dix-sept travaux publics Genève: Editions d'Autre part, 2014 11,5x16,5 cm / 160 pages ISBN: 9782940518173 20 € / 26 CHF Présentation de l'éditeur: Il y a le romancier, le professeur de littérature. Il y a aussi le citoyen, l’intellectuel agissant et engagé: c’est ainsi que Jérôme Meizoz entrevoit son «être au monde». Il rassemble ici dix-sept plaidoyers pour la tolérance, l’ouverture au monde, contre les dérives identitaires et la morgue des nantis. Ces saintes colères sont une sorte d’ Indignez-vous à la sauce helvétique. Textes autour de Henry Roorda, Blaise Cendrars, Joël Dicker, Slobodan Despot, Richard Millet, Edouard Louis, etc. Jérôme Meizoz , né en Valais en 1967, est professeur à l'Université de Lausanne. Il a publié une dizaine de livres de fiction et tout autant d’ouvrages théoriques.
↧
Étude de lettres n°297, 2014: «Dans le labyrinthe de la pensée. Approches croisées du "Qu'est-ce que la philosophie?" de Gilles Deleuze et Félix Guattari» (H. Poltier, dir.)
 Étude de lettres n°297, 2014 / 4: «Dans le labyrinthe de la pensée. Approches croisées du "Qu'est-ce que la philosophie?" de Gilles Deleuze et Félix Guattari» Sous la direction de Hugues Poltier ISBN: 9782940331369 138 p. / 15,5 x 22,5 cm 22 CHF Présentation de l'éditeur: Ce volume propose une relecture du Qu’est-ce que la philosophie?, ultime opus (1991) écrit à quatre mains par Gilles Deleuze et Félix Guattari. Il veut donner accès à ce texte difficile en montrant comment les concepts qui y sont définis permettent de penser plus avant, entre autres la composition musicale et le geste même de prendre pour objet l’acte de philosopher. Il invite encore à confronter la pensée des deux philosophes à d’autres réflexions, amies ou ennemies. Mais il montre encore que, loin d’être une météorite, l’œuvre s’inscrit, jusque dans sa créativité la plus débridée, dans la tradition de la métaphysique occidentale. A ce titre, le volume n’est donc pas un simple essai de doxographie. Il se veut une tentative de penser dans le sillage ouvert par l’inventivité philosophique de Gilles Deleuze et Félix Guattari, en même temps qu’une invitation à déplier la créativité de sa propre pensée au contact d’une œuvre dont la fécondité est encore à venir. SOMMAIRE Hugues POLTIER - Présentation (p. 7-10) Table des abréviations (p. 11-12) Malika SAGER - Qu’est-ce que la philosophie? Affronter le chaos, tracer un plan sur la chaos (p. 13-24) Notre étude, partant de la question posée dans Qu’est-ce que la philosophie?, cherche à définir ce qui distingue cette discipline de deux autres formes de pensée que sont l’art et la science. Nous commencerons par relever l’importance, décisive pour la pensée et déterminante pour la forme qu’elle va prendre, du moment de l’instauration d’un plan. Nous poursuivrons par un examen des conditions de l’expérience réelle de la pensée, en considérant le mode qui permet à la philosophie de prendre forme en même temps que se détermine son plan. Nous terminerons en évoquant le problème de la création de l’image de la pensée, afin de voir en quoi la philosophie n’est que construction pure. Hugues POLTIER - L’immanence – ou l’opinion à la question autour de Qu’est-ce que la philosophie? (p. 25-40) Nous nous attachons, dans une lecture centrée sur Qu’est-ce que la philosophie?, à cerner la compréhension deleuzo-guattarienne du propre de la philosophie. Nous montrons la centralité de la nécessité de se distinguer d’avec l’opinion dans l’élaboration du concept de concept et l’importance du plan d’immanence en tant qu’il n’est pas un concept mais le tracé, toujours se faisant, en mouvement, des rapports de composition entre les concepts. Anne SAUVANARGUES - L’éthologie politique des signes (p. 41-60) J’envisage ici systématiquement les rapports de Deleuze et de Deleuze et Guattari avec les signes, problème qui oriente depuis le début mon travail sur ces deux auteurs, selon une conception cinétique du système qui joint à la cohérence systématique de la pensée la transformation de ses opérations. De Proust et les signes aux dernières œuvres, je propose de considérer cette pensée en devenir comme une nouvelle philosophie de l’expérience, une éthologie politique des signes. Cette expérience ne préexiste pas mais est à construire, d’où le rôle nouveau du rapport entre système (construction de concepts) et production de signes qui ne préexistent pas (empirisme transcendantal), n’ont pas à être interprétés mais doivent être expérimentés éthologiquement, ce qui donne à la pratique, à la politique, à l’art un rôle constructif. David PAGOTTO - La géophilosophie et l’ombre du spinozisme (p. 61-76) Dans le chapitre 4 de Qu’est-ce que la philosophie?, Deleuze et Guattari semblent vouloir ressaisir l’événement «philosophie» dans le concept de philosophie qu’ils viennent de construire dans les chapitres précédents. C’est dire qu’alors la problématique en jeu amène nos auteurs au plus proche d’une question métaphilosophique tout à fait impensable dans la logique de l’immanence pourtant largement préconisée par eux-mêmes. Tâchant d’expliciter cet enjeu, nous serons amenés à tisser un lien avec le concept d’expression construit par Deleuze lui-même afin de clarifier l’ontologie spinoziste. On découvrira alors que pour que la philosophie ne retombe pas dans la trop grande gourmandise qui caractérise l’hégélianisme, nos auteurs en redeviennent spinozistes – mais peut-être là où eux-mêmes n’auraient pas voulu aller. Arnaud VILLANI - Continuité et virtualité chez Deleuze (p. 77-94) Le fil qui joint la virtualité chez Bergson et chez Deleuze ne doit pas occulter le problème essentiel qui apparaît alors: le lien foncier entre la virtualité et la notion de continuité. Aussitôt, cette continuité se présente comme continuité de la pensée qui «fait bloc». Et, pour l’historien de la philosophie, ce problème nous ramène, de façon d’abord étrange, au lien entre la métaphysique, à condition de la penser comme immanente, et la continuité virtuelle. Ce qui veut dire, un pas plus loin, que l’une des plus lointaines pensées de la Philosophie, à savoir l'aphoristique héraclitéenne, s'invite dans le débat contemporain sur la possibilité d’une métaphysique immanente, autrement dit, qui «laisse couler les flux» et les mène jusqu’au plus haut point dont ils sont capables. Thibaud VAILLANCOURT - Deleuze et Wittgenstein: «comme» deux jumeaux assis dos à dos? (p. 95-114) Ce texte s’attache à lire Deleuze et Wittgenstein dans un éclairage mutuel. Avec pour point de départ le rejet strict et constant de ce dernier à l’intérieur de l’œuvre deleuzienne, notre intention est de désamorcer le dogmatisme qu’une telle posture permet, même virtuellement, à l’exégète complaisant. Aucun rachat n’est ici en question, mais une tentative diplomatique pour montrer qu’à l’apparence irréconciliable de deux enracinements antipodiques de la pensée résistent des inquiétudes communes et des gestes qui se font écho. Leur rapport particulier à l’art, ainsi qu’une tendance partagée à prendre pour objet de pensée la pensée elle-même orientent ce parcours, traits qui finalement nous poussent à constater d’étranges ressemblances et à admettre que la véhémence de Deleuze tient davantage à la synthèse, en un nom propre, des griefs adressés à une tradition dont l’individu Wittgenstein n’est pas le porte-étendard. Jamil ALIOUI - Composition musicale et philosophie (p. 115-128) La musique apparaît peu dans la philosophie de Deleuze et de Guattari, mais elle le fait de manière remarquable tant par l’efficacité expressive qui est l’un de ses propres que par le lien qu’elle entretient avec le concept philosophique. La confrontation que nous proposons entre les affects et les percepts de QPh et la ritournelle de MP nous amènera à différencier la musique et la composition musicale ainsi qu’à considérer cette dernière comme une forme de la pensée - au sens de QPh - au croisement de la philosophie et de l’art. Anthony BEKIROV - La métaphilosophie et le problème de l’expression. Différence et interdépendance du fond et de la forme dans Qu’est-ce que la philosophie? (p. 129-136) On entend volontiers que le dernier opus de Gilles Deleuze participe de la «métaphilosophie», entendu qu’il s’agit d’un livre de philosophie sur la philosophie. Mais bien trop souvent, on ressasse ce préfixe comme si ce à quoi il renvoyait était évident, et l’on n’interroge pas le rapport complexe et subtil qu’entretient le discours philosophique de Qu’est-ce que la philosophie? avec son sujet, relation forcément incestueuse voire schizophrène (la philosophie qui doit se séparer d’elle-même pour se prendre comme sujet). Cette tâche d’esquisser ce qui constituerait une explication du rapport entre le livre et le discours est celle à laquelle cet article s’enchaîne.
Étude de lettres n°297, 2014 / 4: «Dans le labyrinthe de la pensée. Approches croisées du "Qu'est-ce que la philosophie?" de Gilles Deleuze et Félix Guattari» Sous la direction de Hugues Poltier ISBN: 9782940331369 138 p. / 15,5 x 22,5 cm 22 CHF Présentation de l'éditeur: Ce volume propose une relecture du Qu’est-ce que la philosophie?, ultime opus (1991) écrit à quatre mains par Gilles Deleuze et Félix Guattari. Il veut donner accès à ce texte difficile en montrant comment les concepts qui y sont définis permettent de penser plus avant, entre autres la composition musicale et le geste même de prendre pour objet l’acte de philosopher. Il invite encore à confronter la pensée des deux philosophes à d’autres réflexions, amies ou ennemies. Mais il montre encore que, loin d’être une météorite, l’œuvre s’inscrit, jusque dans sa créativité la plus débridée, dans la tradition de la métaphysique occidentale. A ce titre, le volume n’est donc pas un simple essai de doxographie. Il se veut une tentative de penser dans le sillage ouvert par l’inventivité philosophique de Gilles Deleuze et Félix Guattari, en même temps qu’une invitation à déplier la créativité de sa propre pensée au contact d’une œuvre dont la fécondité est encore à venir. SOMMAIRE Hugues POLTIER - Présentation (p. 7-10) Table des abréviations (p. 11-12) Malika SAGER - Qu’est-ce que la philosophie? Affronter le chaos, tracer un plan sur la chaos (p. 13-24) Notre étude, partant de la question posée dans Qu’est-ce que la philosophie?, cherche à définir ce qui distingue cette discipline de deux autres formes de pensée que sont l’art et la science. Nous commencerons par relever l’importance, décisive pour la pensée et déterminante pour la forme qu’elle va prendre, du moment de l’instauration d’un plan. Nous poursuivrons par un examen des conditions de l’expérience réelle de la pensée, en considérant le mode qui permet à la philosophie de prendre forme en même temps que se détermine son plan. Nous terminerons en évoquant le problème de la création de l’image de la pensée, afin de voir en quoi la philosophie n’est que construction pure. Hugues POLTIER - L’immanence – ou l’opinion à la question autour de Qu’est-ce que la philosophie? (p. 25-40) Nous nous attachons, dans une lecture centrée sur Qu’est-ce que la philosophie?, à cerner la compréhension deleuzo-guattarienne du propre de la philosophie. Nous montrons la centralité de la nécessité de se distinguer d’avec l’opinion dans l’élaboration du concept de concept et l’importance du plan d’immanence en tant qu’il n’est pas un concept mais le tracé, toujours se faisant, en mouvement, des rapports de composition entre les concepts. Anne SAUVANARGUES - L’éthologie politique des signes (p. 41-60) J’envisage ici systématiquement les rapports de Deleuze et de Deleuze et Guattari avec les signes, problème qui oriente depuis le début mon travail sur ces deux auteurs, selon une conception cinétique du système qui joint à la cohérence systématique de la pensée la transformation de ses opérations. De Proust et les signes aux dernières œuvres, je propose de considérer cette pensée en devenir comme une nouvelle philosophie de l’expérience, une éthologie politique des signes. Cette expérience ne préexiste pas mais est à construire, d’où le rôle nouveau du rapport entre système (construction de concepts) et production de signes qui ne préexistent pas (empirisme transcendantal), n’ont pas à être interprétés mais doivent être expérimentés éthologiquement, ce qui donne à la pratique, à la politique, à l’art un rôle constructif. David PAGOTTO - La géophilosophie et l’ombre du spinozisme (p. 61-76) Dans le chapitre 4 de Qu’est-ce que la philosophie?, Deleuze et Guattari semblent vouloir ressaisir l’événement «philosophie» dans le concept de philosophie qu’ils viennent de construire dans les chapitres précédents. C’est dire qu’alors la problématique en jeu amène nos auteurs au plus proche d’une question métaphilosophique tout à fait impensable dans la logique de l’immanence pourtant largement préconisée par eux-mêmes. Tâchant d’expliciter cet enjeu, nous serons amenés à tisser un lien avec le concept d’expression construit par Deleuze lui-même afin de clarifier l’ontologie spinoziste. On découvrira alors que pour que la philosophie ne retombe pas dans la trop grande gourmandise qui caractérise l’hégélianisme, nos auteurs en redeviennent spinozistes – mais peut-être là où eux-mêmes n’auraient pas voulu aller. Arnaud VILLANI - Continuité et virtualité chez Deleuze (p. 77-94) Le fil qui joint la virtualité chez Bergson et chez Deleuze ne doit pas occulter le problème essentiel qui apparaît alors: le lien foncier entre la virtualité et la notion de continuité. Aussitôt, cette continuité se présente comme continuité de la pensée qui «fait bloc». Et, pour l’historien de la philosophie, ce problème nous ramène, de façon d’abord étrange, au lien entre la métaphysique, à condition de la penser comme immanente, et la continuité virtuelle. Ce qui veut dire, un pas plus loin, que l’une des plus lointaines pensées de la Philosophie, à savoir l'aphoristique héraclitéenne, s'invite dans le débat contemporain sur la possibilité d’une métaphysique immanente, autrement dit, qui «laisse couler les flux» et les mène jusqu’au plus haut point dont ils sont capables. Thibaud VAILLANCOURT - Deleuze et Wittgenstein: «comme» deux jumeaux assis dos à dos? (p. 95-114) Ce texte s’attache à lire Deleuze et Wittgenstein dans un éclairage mutuel. Avec pour point de départ le rejet strict et constant de ce dernier à l’intérieur de l’œuvre deleuzienne, notre intention est de désamorcer le dogmatisme qu’une telle posture permet, même virtuellement, à l’exégète complaisant. Aucun rachat n’est ici en question, mais une tentative diplomatique pour montrer qu’à l’apparence irréconciliable de deux enracinements antipodiques de la pensée résistent des inquiétudes communes et des gestes qui se font écho. Leur rapport particulier à l’art, ainsi qu’une tendance partagée à prendre pour objet de pensée la pensée elle-même orientent ce parcours, traits qui finalement nous poussent à constater d’étranges ressemblances et à admettre que la véhémence de Deleuze tient davantage à la synthèse, en un nom propre, des griefs adressés à une tradition dont l’individu Wittgenstein n’est pas le porte-étendard. Jamil ALIOUI - Composition musicale et philosophie (p. 115-128) La musique apparaît peu dans la philosophie de Deleuze et de Guattari, mais elle le fait de manière remarquable tant par l’efficacité expressive qui est l’un de ses propres que par le lien qu’elle entretient avec le concept philosophique. La confrontation que nous proposons entre les affects et les percepts de QPh et la ritournelle de MP nous amènera à différencier la musique et la composition musicale ainsi qu’à considérer cette dernière comme une forme de la pensée - au sens de QPh - au croisement de la philosophie et de l’art. Anthony BEKIROV - La métaphilosophie et le problème de l’expression. Différence et interdépendance du fond et de la forme dans Qu’est-ce que la philosophie? (p. 129-136) On entend volontiers que le dernier opus de Gilles Deleuze participe de la «métaphilosophie», entendu qu’il s’agit d’un livre de philosophie sur la philosophie. Mais bien trop souvent, on ressasse ce préfixe comme si ce à quoi il renvoyait était évident, et l’on n’interroge pas le rapport complexe et subtil qu’entretient le discours philosophique de Qu’est-ce que la philosophie? avec son sujet, relation forcément incestueuse voire schizophrène (la philosophie qui doit se séparer d’elle-même pour se prendre comme sujet). Cette tâche d’esquisser ce qui constituerait une explication du rapport entre le livre et le discours est celle à laquelle cet article s’enchaîne.
↧
↧
Voix plurielles , n°11, 2014: "L'inachevé dans la modernité : littérature, art et musique" (A. Balint-Babos & A. Viselli, dir.)
Voix plurielles / vol.11, n° 2 (2014) Revue de l'Association des Professeur-e-s de Français des Universités et Collèges Canadiens (APFUCC) "L'inachevé dans la modernité : littérature, art et musique" (Adina Balint-Babos & Antonio Viselli, dir.) http://brock.scholarsportal.info/journals/voixplurielles (ISSN 1925-0614). Sommaire: 1. Dossier (Dir. Adina Balint-Babos et Antonio Viselli) - L'inachevé dans la modernité : littérature, art et musique -L'inachevé dans la modernité : littérature, art et musique. Adina Balint-Babos, Antonio Viselli 3-8 -De trop - l'infini. A l'écoute de Raphaël Cendo avec Jean-Luc Nancy.Cosmin Toma 9-19 -Imaginer, monter : la mémoire inachevée d'Auschwitz selon Georges Didi-Huberman. Adina Balint-Babos 20-31 -Georges Perec et le deuil de l'achèvement. Daniele Carluccio 32-41 -André Gide en Egypte : l'inachèvement et la créativité. Elizabeth Geary Keohane 42-52 - Fuir la complétude ou le métarécit intermédial des Faux-monnayeurs . Antonio Viselli 53-63 2/ Prix de la meilleure communication par un/e étudiant/e -Des histoires de frontières : L'historien de rien de Daniel Poliquin. Ariane Brun del Re 64-81 -L'enfant-soldat : la puissance d'un témoin. Marie Bulté 82-91 3/ Varia -La France dans l'oeuvre de Magali Michelet. Sathya Rao 92-113 -L'invraisemblable de la narration omnisciente. Suzette Ali 114-122 -Ronsard et la verve licencieuse. Sangoul Ndong 123-132 -Construction du savoir langagier en français à la Légion étrangère : la double hybridation linguistique dans l'interlangue des légionnaires russes et polonais. Héléna Maniakis 133-145 -Français appliqué et culture (FAC) à l'Université de Thiès : un "bien nécessaire". Hadja Maïmouna NIANG 146-153 -Classe de langue et compétence évaluative des enseignants : entre pratiques évaluatives et politique éducative. Mina Sadiqui 154-162 -La question de la citation : entre la pratique littéraire et la pratique juridique. Laté Lawson-Hellu 163-179 4/ Création - Ah, le cinquiène enfin, plus qu'un étage ! Philippe Nieto 180-186 -Courriers froissés (1995-1997) / Dix poèmes de Raphaël Renucci (1987-1989). Frédéric Torterat, Raphaël Renucci 187-195 -Le testament de Jasmin Ledoux. Mona Mikaël 196-200 -De l'art à l'écriture : plusieurs mains. Carla Cattafi, Lauren Kafal, Megan Minuk, Vanna Mom, Anna Simiganoschi, Kerri-Lee Vogan 201-205 5/ Comptes rendus -Groult, Benoite. Ainsi soit Olympe de Gouges . Annick MacAskill 206-208 -Boehringer, Monika, dir. Anthologie de la poésie des femmes en Acadie . Catherine Parayre 209-210 -Dorais, Fernand. Le recueil de Dorias, vol. II. "Trois contes d'androgynie" suivi du "Conte d'amour" . David Vaillant 211-212 -Charlebois, Eric. Compost-partum . Pauline Brise 213-214 -Ellenwood, Ray. Egrégore : une histoire du mouvement automatiste de Montréal . Catherine Parayre 215-216 -Julien, Danielle et Denise Laperrière. Séductions . Catherine Parayre 217-218 -Henrie, Maurice. Aveux et confidences . Armand Falq 219-220 -Bessette, Ariane. Lieux provisoires . Karin Felix 221 -Boisjoli, Jean. Carnet de routes ourdies . Martin Linus 222-223 -Brossard, Nicole. Sie wäre der erste Satz meines nächsten Romans / Elle serait la première phrase de mon prochain roman / She would be the First Sentence of my Next Novel . Ed. Ursula Mathis-Moser. Brossard, Nicole. Catherine Parayre 224-225 -Jean, Guy. Fossiles qui gisent en mes rèves : poèmes archéologiques . Martin Linus 226-227 6/ Appel d'articles pour Alexandre Amprimoz
↧
Dinomaniaques!
Dinomaniaques! Vendredi 25 et samedi 26 septembre 2015 Université de Haute Alsace, Mulhouse Institut de Recherche en langues et littératures européennes (ILLE – E.A. 4363) Appel à communications «Big, fierce and extinct»: on connaît la réponse faite à Stephen Jay Gould par un collègue interrogé sur la fascination qu’exercent les dinosaures sur les enfants et, plus généralement, sur notre culture. Pourtant, rappelle Gould dans La Foire aux dinosaures , si les dinosaures ont toujours été gros, féroces et éteints, ils n’ont pas toujours suscité la même émotion que celle éveillée récemment par le trailer officiel de Jurassic World . Attendu pour le 10 juin 2015 et devenu, à quelques jours près, un nouveau D(inosaur)-Day, le film constitue aussitôt un horizon d’attente collectif. Serions-nous dinomaniaques? En tant qu’objet culturel, le dinosaure est paradoxalement récent: il nous appartient alors de découvrir ce qui a pu changer et, surtout, d’étudier les ressorts d’une figure devenue, en peu de temps, centrale dans notre culture. Que veulent dire les dinosaures? Qu’avons-nous besoin de dire à travers eux? Témoin d’un monde disparu, le dinosaure figure autant un renouveau possible de l’aventure (Arthur Conan Doyle, The Lost World ) qu’une plongée au cœur de forces primitives cataclysmiques (Jules Verne, Voyage au centre de la Terre ). Parce qu’il n’a jamais croisé la route de l’homme, il est l’inouï, l’extraordinaire, le lointain inexploré ou inexplorable, laissant bouchée bée Alan Grant et Ellie Sattler dans le Jurassic Park de Steven Spielberg. Le dinosaure, nature hors mémoire d’homme, ne peut faire l’objet que de reconstitutions, de représentations, faisant se rejoindre la méthode paléontologique et celle des études culturelles sous le signe de l’abduction, désignée par Umberto Eco comme un «mécanisme créateur de mondes». Son éloignement n’empêche pas le dinosaure de n’être parmi nous que depuis la moitié du xix e siècle: il ne peut, ce-faisant, qu’être culture, élaboration, fantasme érigé sur des connaissances lacunaires et elles-mêmes sujettes à caution. «C'est ainsi que nous humains voyons le monde, écrit Nancy Huston dans L’Espèce fabulatrice : en l'interprétant, c'est-à-dire, en l'inventant, car nous sommes fragiles, nettement plus fragiles que les autres primates. Notre imagination supplée à notre fragilité. Sans elle - sans l'imagination qui confère au réel un Sens qu'il ne possède pas en lui-même - nous aurions disparu, comme ont disparu les dinosaures ». Une association faite pour rappeler que la survivance des mondes (et celle des dinosaures) ne dépend plus que de notre aptitude – et de notre désir – à les mettre en fable, quitte à supporter l’anachronisme en faisant du dinosaure la figure – voire le héros – de nos fictions préhistoriques. Plus qu’un simple objet de découverte, de décor, ou plus qu’un éventuel musée animé ( Voyage dans la préhistoire , Karel Zeman, 1955), le dinosaure nous intéresse dans la mesure où il fait progressivement récit. Tragédie manifeste dans le Fantasia des studios Disney (1940) qui réécrit une mythologie cosmogonique laïcisée, le dinosaure nourrit un imaginaire de l’extinction qui ne tarde pas à fonctionner symboliquement comme un memento mori réitéré, une vanité éco/égo-logique qui trouve aujourd’hui un écho favorable. La tragédie est plus familiale dans Land before time de Don Bluth (1988), où un groupe de dinosaures anthropomorphisés reformule l’avènement du dinosaure comme fiction de jeunesse, en même temps que le dessin animé assume à travers le mutique tyrannosaure la réinterprétation de figures plus classiques: l’ogre, le géant, le loup, le croquemitaine…autant de monstres dévoreurs réinvestis. Puis, plus récemment, une tragédie scientifico-aventureuse via le blockbuster Jurassic Park qui remet l’image hollywoodienne au centre de nos sensations. Sans viser à l’exhaustivité, il est aisé de rappeler combien le dinosaure occupe aujourd’hui un large champ culturel, jusqu’à en constituer un pan spécifique. Jules Verne et Arthur Conan Doyle se prêtent à l’exploration de la dino-aventure, au même titre que les Dinosaur Tales de Ray Bradbury (écrits de 1951 à 1983) et que le Carnosaur de John Brosnan (1984). Par ailleurs, en 1912, Winsor McCay initie avec Gertie the dinosaur l’exploration cinématographique du dinosaure qui, eu égard à ses dimensions spectaculaires, ouvre le champ des innovations techniques : de la terreur à la fascination en passant par une forme de poétisation, le dinosaure fait image en même temps qu’il fait défi. Parallèlement s’engage, à travers cette même figure de Gertie, un siècle tourné vers l’élaboration d’une culture de jeunesse dans laquelle s’installe durablement le dinosaure: Casimir , inventé par Yves Brunier et Cristophe Izard, Denver, the last dinosaur , créé par Peter Keefe, mais aussi Barney ( Barney and friends , Sheryl Leach, à partir de 1987) seraient-ils autant de dinosaures-outils destinés à porter les discours que nous adressons aux enfants? Enfin, le dinosaure est aussi un marqueur de l’état et du fonctionnement de notre culture. Entre culture scientifique et devenir-jouet (le Rex de Toy Story , John Lasseter, 1995), les dinosaures génèrent autant de représentation relatives à ce que nous sommes capables de faire (l’anticipation de Crichton ou les techniques cinématographiques progressivement mises en œuvre pour ‘rendre visible’ le dinosaure) comme à notre manière d’appréhender le gigantesque, l’inaccessible: marchandisation, dévoration culturelle du géant devenu biscuit ou jouet, notre culture au sens large nous permet de domestiquer l’indomptable, et peut-être de réassurer notre position d’espèce dominante. De la dinoculture à la dinofiction en passant par le dinomarketing, le dinosaure interroge notre traitement de la peur (il est le terrible lézard, de même qu’il est celui dont la nature s’est séparée), de l’exceptionnel (il est une figure de la performance, du record), de la réification (la boutique de souvenir serait un lieu privilégié du dinosaure témoin d’un âge du marketing – dans Denver, The Last Dinosaur , Morton Fizzback ne traduit-il pas sa fascination par l’évocation des «dinodollars»?), du détournement, tout comme de la réécriture, de la performance, ou encore de «l’émerveillement salutaire devant le merveilleux de ce qui est et de ce qui nous dépasse, qui est certainement le commencement de la poésie» (Michael Edwards, De l’émerveillement, 2008). Autant de pistes que ces journées se proposent d’explorer. Modalités de soumission : Des propositions émanant de spécialistes en littérature, arts visuels (cinéma, théâtre, peinture, bande dessinée, albums), cultures matérielles, cultures de jeunesse, mais aussi de cultures scientifiques sont les bienvenues, le projet s’inscrivant dans une perspective méthodologique relative aux études culturelles. Les propositions, d’une quinzaine de lignes environ et suivies de quelques lignes de présentation de l’auteur, sont à envoyer pour le 01 avril 2015 à matthieu.freyheit@gmail.com et frederique.toudoire@free.fr Comité scientifique Vanessa Besand (Université de Bourgogne) Christian Chelebourg (Université de Lorraine) Antonio Dominguez-Leiva (Université du Québec à Montréal) Florence Fix (Université de Lorraine) Matthieu Freyheit (Université de Lorraine) Sébastien Hubier (Université de Reims) Frédérique Toudoire-Surlapierre (Université de Haute-Alsace) Organisation: ILLE – E.A. 4363, Matthieu Freyheit, Frédérique Toudoire-Surlapierre
↧
S. Bailly, Mises en crise - Essais littéraires sur Bernard Dadié, Ahmadou Kourouma, Ayi Kwei Armah, Josette Abondio...
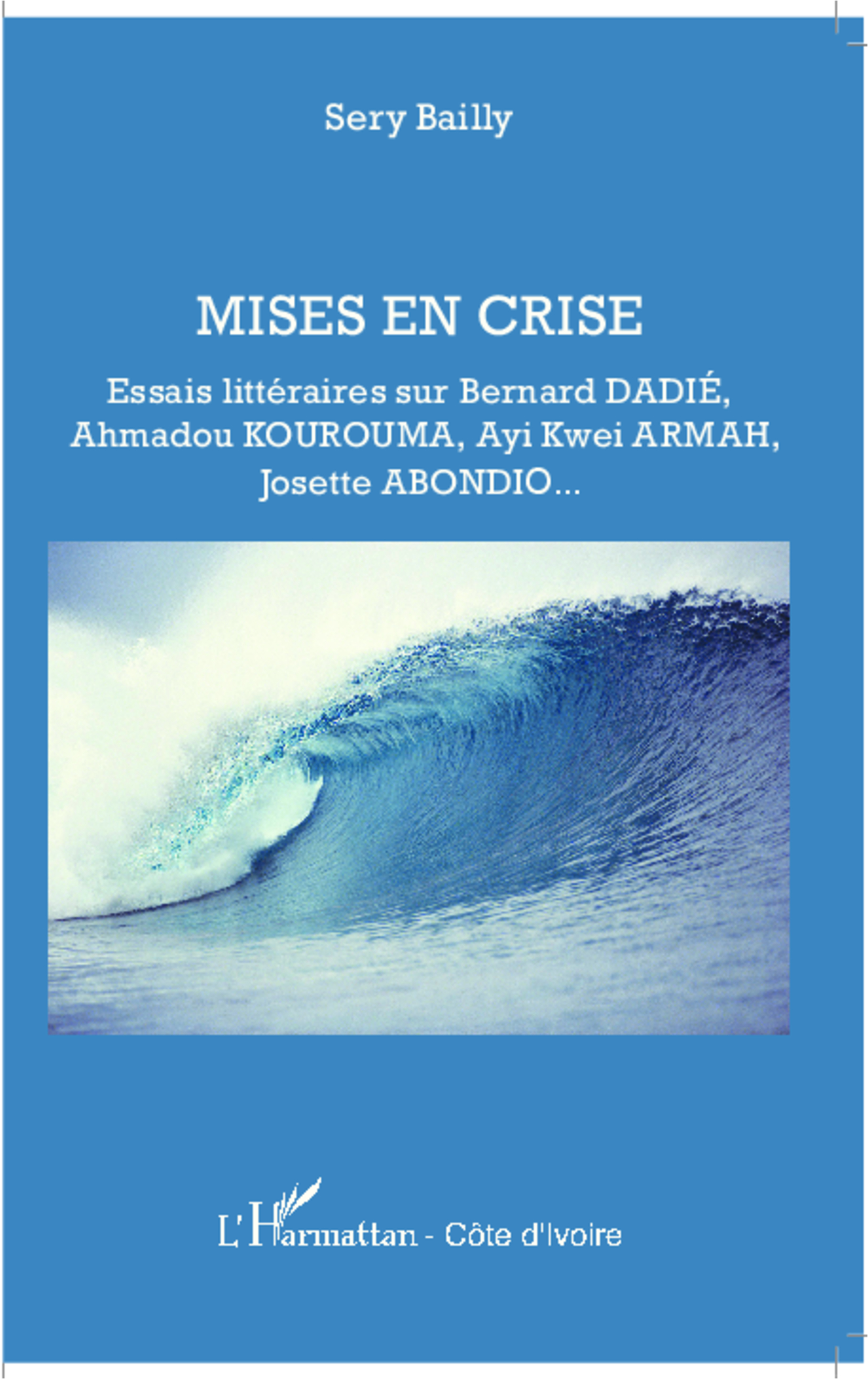 Sery Bailly, Mises en crise - Essais littéraires sur Bernard Dadié, Ahmadou Kourouma, Ayi Kwei Armah, Josette Abondio... Paris : L'Harmattan Côte d'Ivoire, 2014. 246 p. EAN 9782343029337 (EAN Ebook format Pdf : 9782336363400) 25,50 EUR (version numérique : 18,99 EUR) Présentation de l'éditeur : L'écriture de la mise en crise a suscité des malaises. Il n'y a cependant pas de difficulté à articuler la guérison désirée et l'intérêt porté à la crise. La mise en crise est une manière de continuer à désirer un autre destin. Le metteur en crise n'est pas un masochiste ni un sadique. Qui sont les auteurs que nous considérons comme tels ? L'objectif de cet ouvrage est de faire connaître les nouveaux et, pour les anciens, de proposer de nouvelles lectures. Séry Bailly est diplômé de l'université Paris III et homme politique ivoirien.
Sery Bailly, Mises en crise - Essais littéraires sur Bernard Dadié, Ahmadou Kourouma, Ayi Kwei Armah, Josette Abondio... Paris : L'Harmattan Côte d'Ivoire, 2014. 246 p. EAN 9782343029337 (EAN Ebook format Pdf : 9782336363400) 25,50 EUR (version numérique : 18,99 EUR) Présentation de l'éditeur : L'écriture de la mise en crise a suscité des malaises. Il n'y a cependant pas de difficulté à articuler la guérison désirée et l'intérêt porté à la crise. La mise en crise est une manière de continuer à désirer un autre destin. Le metteur en crise n'est pas un masochiste ni un sadique. Qui sont les auteurs que nous considérons comme tels ? L'objectif de cet ouvrage est de faire connaître les nouveaux et, pour les anciens, de proposer de nouvelles lectures. Séry Bailly est diplômé de l'université Paris III et homme politique ivoirien.
↧
Cours d'été 2015 de l'Institut d'histoire de la Réformation
Cours d'été intensif de l'Institut d'histoire de la Réformation (IHR), année 2015 Du 18 au 22 mai: Un intellectuel au coeur de la République des Lettres: Pierre Bayle entre critique, histoire et religion par Maria-Cristina Pitassi (Genève, IHR) Du 25 au 29 mai: Éducation morale et formation intellectuelle: acteurs, lieux et parcours de la pédagogie protestante dans l'espace francophone à l'époque de la Réforme par Karine Crousaz (Lausanne) et Daniela Solfaroli Camillocci (Genève, IHR) Présentation du cours et conditions d'inscription Inscription via le formulaire en ligne obligatoire, d’ici au 28 février 2015 Contact: Marlene.Jaouich@unige.ch
↧
↧
Summer Course, Institut d'histoire de la Réformation, 2015
Intensive Summer Course 2015, Institut d'histoire de la Réformation From 18 to 22 May An intellectual at the heart of the Republic of Letters : Pierre Bayle between criticism, history and religion by Maria-Cristina Pitassi (Geneva, IHR) From 25 to 29 May Teaching Protestants : moral training and intellectual education in Reformation French-speaking territories by Karine Crousaz (Lausanne) and Daniela Solfaroli Camillocci (Geneva, IHR) All details on our Web site Application by online form is required. Contact: Marlene.Jaouich@unige.ch
↧
T. Ainseba, L'Hommes est-il un animal politique ? - Physique de la misanthropie, entre littérature et philosophie
 Tayeb Ainseba, L'Hommes est-il un animal politique ? - Physique de la misanthropie, entre littérature et philosophie Paris : L'Harmattan, 2014. 298 p. EAN 9782343048703 (EAN Ebook format Pdf : 9782336363462) 30,00 EUR (version numérique : 23,99 EUR) Présentation de l'éditeur : Le compartimentage disciplinaire hérité du XIXe siècle pousse à opposer les intentions esthétiques de la littérature au chemin vers la vérité que serait la philosophie. Cette opposition nie la possibilité d'une philosophie littéraire tant que, réduite à un dogme, elle n'est pas critiquée. Ce livre, plutôt que d'opposer la littérature et la philosophie, raconte ce qui les rapproche en prenant un thème qui leur est commun, celui de la misanthropie. Tayeb Ainseba est docteur en littérature comparée, diplômé en philosophie et F.L.E.
Tayeb Ainseba, L'Hommes est-il un animal politique ? - Physique de la misanthropie, entre littérature et philosophie Paris : L'Harmattan, 2014. 298 p. EAN 9782343048703 (EAN Ebook format Pdf : 9782336363462) 30,00 EUR (version numérique : 23,99 EUR) Présentation de l'éditeur : Le compartimentage disciplinaire hérité du XIXe siècle pousse à opposer les intentions esthétiques de la littérature au chemin vers la vérité que serait la philosophie. Cette opposition nie la possibilité d'une philosophie littéraire tant que, réduite à un dogme, elle n'est pas critiquée. Ce livre, plutôt que d'opposer la littérature et la philosophie, raconte ce qui les rapproche en prenant un thème qui leur est commun, celui de la misanthropie. Tayeb Ainseba est docteur en littérature comparée, diplômé en philosophie et F.L.E.
↧
Dossier Neuvième Art 2.0 : Visions de rêve, visions du rêve
 Dossier Neuvième Art 2.0 : Visions de rêve, visions du rêve Paru sur le site neuvièmeart 2.0, décembre 2014. "Dans le prolongement de l’exposition Nocturnes , consacrée au rêve dans la bande dessinée, une journée d’étude avait été organisée au musée de la Bande dessinée le 20 mars 2014, en partenariat avec l’EESI et le FRAC Poitou-Charentes. On en retrouvera ici une partie du contenu, sous la forme soit d’articles soit de captations vidéo. La lecture de ce dossier peut être prolongée par celle des dossiers déjà consacrés à David B et à Marc-Antoine Mathieu." Philippe Kaenel, " Le Rêve romantique et comique après Füssli et Goya : caricatures et récits graphiques " (novembre 2014) Laurent Gerbier, " La Langue idiote des songes : notes sur David B ." (novembre 2014) Balthazar Kaplan et Thierry Smolderen, " Winsor Mccay, entre rêves vécus et rêves imaginés " (mars 2014) Table ronde : " Dessiner ses rêves " (mars 2014) Thierry Groensteen, " Rêve " (septembre 2013) (Image : un "dreamcatcher", détail d'une photo de Jorge Barrios)
Dossier Neuvième Art 2.0 : Visions de rêve, visions du rêve Paru sur le site neuvièmeart 2.0, décembre 2014. "Dans le prolongement de l’exposition Nocturnes , consacrée au rêve dans la bande dessinée, une journée d’étude avait été organisée au musée de la Bande dessinée le 20 mars 2014, en partenariat avec l’EESI et le FRAC Poitou-Charentes. On en retrouvera ici une partie du contenu, sous la forme soit d’articles soit de captations vidéo. La lecture de ce dossier peut être prolongée par celle des dossiers déjà consacrés à David B et à Marc-Antoine Mathieu." Philippe Kaenel, " Le Rêve romantique et comique après Füssli et Goya : caricatures et récits graphiques " (novembre 2014) Laurent Gerbier, " La Langue idiote des songes : notes sur David B ." (novembre 2014) Balthazar Kaplan et Thierry Smolderen, " Winsor Mccay, entre rêves vécus et rêves imaginés " (mars 2014) Table ronde : " Dessiner ses rêves " (mars 2014) Thierry Groensteen, " Rêve " (septembre 2013) (Image : un "dreamcatcher", détail d'une photo de Jorge Barrios)
↧
Chrétien de Troyes, Yvain ou le Chevalier au Lion. Lancelot ou le Chevalier de la Charette. Illustrés par la peinture préraphaélite
 Yvain ou le Chevalier au Lion ; Lancelot ou le Chevalier de la Charette - Illustrés par la peinture préraphaélite édition de luxe Chrétien de Troyes Philippe Walter (Traducteur), Daniel Poirion (Traducteur), Laurence Des Cars, Virginie Lérot Date de parution : 16/10/2014 Editeur : Diane de Selliers Collection : ISBN : 978-2-36437-045-6 EAN : 9782364370456 Nb. de pages : 446 p. Composés à la fin du XIIe siècle, Yvain et Lancelot sont les deux oeuvres emblématiques de Chrétien de Troyes. Au fil d'aventures inspirées de la légende arthurienne, les héros de la Table Ronde doivent maintenir le délicat équilibre entre amour courtois et prouesses chevaleresques. Les peintres préraphaélites, notamment Dante Gabriel Rossetti, Edward Burne-Jones ou William Morris, réalisent à la fin du XIXe siècle des oeuvres dont l'intensité, l'émotion et la grâce illustrent admirablement les scènes intimes et épiques des romans de Chrétien de Troyes. C'est l'occasion de redécouvrir au fil d'une promenade enchanteresse deux époques, deux univers unis dans une même quête de valeurs, de beauté et de spiritualité. La recherche de la pureté et de l'émotion, la prééminence du désir et du coeur, la création d'un imaginaire merveilleux et poétique unit Chrétien de Troyes et les préraphaélites au-delà des siècles. Une incarnation intense et poétique des héros mythiques de la légende arthurienne par les peintres préraphaélites. Une iconographie puissante, habitée par le souffle du mythe arthurien, restitue ici toute l'énergie des romans de Chrétien de Troyes, loin de l'inertie des enluminures médiévales. Deux romans d'amour et d'armes, présentés dans une nouvelle mise en page, plus aérée, pour un plus grand plaisir de lecture. Des personnages indémodables : la légende arthurienne inspire tous les arts et tous les âges : de Thomas Malory au XVe siècle au film Lancelot avec Sean Connery, la série télévisée Kaamelot, les Monty Python ou le Merlin de Walt Disney. Au-delà de leur beauté esthétique, le texte et les oeuvres picturales sont emplies de symboles et d'allégories. La contribution de spécialistes reconnus, Philippe Walter et Laurence des Cars, nous éclaire et nous guide pour une lecture multiple de ces chefs d'oeuvres.
Yvain ou le Chevalier au Lion ; Lancelot ou le Chevalier de la Charette - Illustrés par la peinture préraphaélite édition de luxe Chrétien de Troyes Philippe Walter (Traducteur), Daniel Poirion (Traducteur), Laurence Des Cars, Virginie Lérot Date de parution : 16/10/2014 Editeur : Diane de Selliers Collection : ISBN : 978-2-36437-045-6 EAN : 9782364370456 Nb. de pages : 446 p. Composés à la fin du XIIe siècle, Yvain et Lancelot sont les deux oeuvres emblématiques de Chrétien de Troyes. Au fil d'aventures inspirées de la légende arthurienne, les héros de la Table Ronde doivent maintenir le délicat équilibre entre amour courtois et prouesses chevaleresques. Les peintres préraphaélites, notamment Dante Gabriel Rossetti, Edward Burne-Jones ou William Morris, réalisent à la fin du XIXe siècle des oeuvres dont l'intensité, l'émotion et la grâce illustrent admirablement les scènes intimes et épiques des romans de Chrétien de Troyes. C'est l'occasion de redécouvrir au fil d'une promenade enchanteresse deux époques, deux univers unis dans une même quête de valeurs, de beauté et de spiritualité. La recherche de la pureté et de l'émotion, la prééminence du désir et du coeur, la création d'un imaginaire merveilleux et poétique unit Chrétien de Troyes et les préraphaélites au-delà des siècles. Une incarnation intense et poétique des héros mythiques de la légende arthurienne par les peintres préraphaélites. Une iconographie puissante, habitée par le souffle du mythe arthurien, restitue ici toute l'énergie des romans de Chrétien de Troyes, loin de l'inertie des enluminures médiévales. Deux romans d'amour et d'armes, présentés dans une nouvelle mise en page, plus aérée, pour un plus grand plaisir de lecture. Des personnages indémodables : la légende arthurienne inspire tous les arts et tous les âges : de Thomas Malory au XVe siècle au film Lancelot avec Sean Connery, la série télévisée Kaamelot, les Monty Python ou le Merlin de Walt Disney. Au-delà de leur beauté esthétique, le texte et les oeuvres picturales sont emplies de symboles et d'allégories. La contribution de spécialistes reconnus, Philippe Walter et Laurence des Cars, nous éclaire et nous guide pour une lecture multiple de ces chefs d'oeuvres.
↧
↧
Robert Challe et le commerce (Congrès 18 Rotterdam)
La Société des amis de Robert Challe se propose d'organiser une session "Robert Challe et le commerce" au prochain Congrès des dix-huitiémistes qui se tiendra à Rotterdam du 26 au 31 juillet 2015 : Robert Challe et le commerce Organisateur: Société des Amis de Robert Challe Responsables: Geneviève Artigas-Menant , professeur émérite, CELLF 16-18, UMR 8599 CNRS –Paris-Sorbonne. Jacques Cormier, professeur honoraire à l’Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles. Robert Challe (1659-1721), célèbre aujourd’hui pour son œuvre littéraire et philosophique, est un témoin passionnant du commerce parisien et aussi du commerce international, sur lequel il a développé tout un ensemble de réflexions et de propositions, et sur lequel il a fourni une quantité d’informations de première main concernant les procédures et les conditions matérielles. Il a commencé par faire l’expérience du commerce des fourrures au Canada, lors d’un séjour qui l’a marqué toute sa vie et dont l’influence se fait sentir à la fois dans ses Mémoires manuscrits (BnF, N.A.F. 13799) publiés chez Droz en 1996 et dans son traité philosophique manuscrit, les Difficultés sur la religion , dont les deux versions intégrales (Bibliothèque Mazarine, Ms 1163 et Bayerische Staatsbibliothek, cod. gall. 887), ont été publiées respectivement à la Voltaire Foundation en 1982 et chez Droz en 2000. Il a pris part personnellement à une expédition commerciale, en même temps que militaire, qui l’a conduit jusqu’en Extrême-Orient sur un vaisseau de la Compagnie des Indes orientales (1690-1691). Il présente son témoignage sur les promesses et les écueils du grand commerce international dans le Journal d’un voyage fait aux Indes orientales, publié en 1721, à La Haye [Abraham de Hondt] et à Rouen chez Jean-Baptiste Machuel (Mercure de France 2002, 2 vol.). Enfin, dans un grand roman publié en 1713 et réédité quatorze fois dans le siècle, Les Illustres Françaises (Classiques Garnier 2014), il donne une image précise, réaliste et détaillée du commerce parisien contemporain, qu’il connaît bien par les activités de son entourage. La session a pour but de mettre en valeur tous ces aspects en s’appuyant sur les travaux les plus récents de spécialistes internationaux. Les propositions de participations sont à envoyer à Geneviève Artigas-Menant avant le 15 janvier 2015 à l'adresse de la présidente de la Société des amis de Robert Challe : menant@u-pec.fr .
↧
"La narrativité du vivant" (littérature, bande dessinée, cinéma)
«La narrativité du vivant » (littérature, bande dessinée, cinéma) Journée d’étude – FoReLL Université de Poitiers. Vendredi 10 avril 2015. En présence de Pierre Senges (écrivain) et Dominique Lestel (philosophe-éthologue) pour Les aventure de Percival. Un conte phylogénétique. Organisée par Marie Cazaban-Mazerolles et Paula Klein « Le problème de la vie n’est plus un problème local, un problème parmi d’autres, [au contraire,] l’on pourrait bien assister aujourd’hui à l’extension du problème ou du modèle du vivant à tous les domaines du savoir et de la pratique .» (Worms, La philosophie en France au XXe siècle ,2009) Selon F. Worms, notre époque serait celle de la promotion du vivant dont le souci migrerait de ses territoires épistémiques spécifiques (biologie, zoologie, éthologie, écologie) vers de nouveaux espacespratiques et théoriques: philosophique, éthique, mais aussi politique, économique, juridique, etc. Le domaine esthétique n’est pas en reste de cette tendance générale, comme en témoignent le développement depuis une quarantaine d’années du «bio-art» ou encore l’affirmation croissante de champs critiques concernés par les rapports entre le vivant et la littérature [1] . Souhaitant contribuer à l’examen de la participation des pratiques artistiques à ce «moment du vivant», cette journée d’étude invite plus particulièrement chercheurs et praticiens issus de différentes disciplines à se pencher sur la question de sa mise en récit, problématique à plus d’un titre. En effet, si l’on connait depuis les analyses de Ricoeur le rôle essentiel joué par le récit dans l’ordonnance de l’expérience du temps vécu, l’instantanéité supposée par la formule même de «vivant» semble immédiatement peu compatible avec la substance temporelle de toute narration. Par ailleurs, et si l’on admet avec Dilthey que le vivant ( das leben ) renvoie à une forme de vie inconsciente, organique et animale quand le vécu ( das erleben ) sert au contraire de nom à l’expérience réfléchie d’un sujet singulier, l’idée d’un récit du vivant apparait comme une contradiction en soi. Pourtant, des récits vitalistes de Lawrence au récent Journal d’un corps de Pennac illustré par Larcenet, en passant par Calvino ( Cosmicomics ) ou encore les écrits de Clarice Lispector, le XX è siècle s’est montré à même de produire avec une formidable diversité des histoires du vivant, de la vitalité biologique, physique, contre une tradition psychologique mais aussi historique ou sociologique du récit de vie. En ce sens, l’analyse des stratégies par lesquelles les arts narratifs déjouent la résistance du vivant à être mis en forme par le récit permet de repenser les modalités à travers lesquelles la vie est « mise en jeu » dans l’écriture (G. Agamben, Profanations , 2005), et d’explorer l’émergence d’un geste «zoégraphique» susceptible de requalifier les «écritures de vie» aujourd’hui encore si souvent assimilées au récit de soi. Les contributions pourront prendre pour objet toute production narrative des XXe et XXIe siècles (littérature, cinéma, bande-dessinée…) des domaines français ou étrangers. Les pistes de réflexion suivantes sont données à titre indicatif. 1. Axes poétiques: transformation de la poétique narrative par la focalisation sur le vivant. - le corps narratif. «Pourquoi ne ferait-on pas le journal de son corps?» demandait Valéry dans Monsieur Teste. Depuis le dernier roman de Daniel Pennac, c’est chose faite. Traditionnellement considéré comme l’autre de la narration, le corps n’est plus aujourd’hui ce continent muet dont les récits traditionnels, centrés sur la psyché, l’âme ou les sentiments de ses personnages ont longtemps fait l’économie. -les poétiques de l’impersonnel. Si la notion de vécu renvoie toujours explicitement à l’histoire personnelle d’un sujet, pouvant être singulier ou collectif, le vivant outrepasse au contraire les configurations particularisées. Selon la formule de Thierry Hoquet résumant la pensée de Schopenhauer, il s’agit de «la vie venant de plus loin que les individus et les transcendant». L’on pourra donc se demander quelles conséquences cette déclinaison impersonnelle de la vie a sur la construction du personnage de fiction ou sur l’édification de l’identité narrative d’individus réels. -la fin de l’exception humaine. Le vivant étant par nature un concept opposé à l’anthropocentrisme, l’examen de récits participant par leur mise en scène de vies non humaines à ce que Jean-Marie Schaeffer a appelé «la fin de l’exception humaine» constitue une piste de recherches privilégiée dans la tentative de définir et cerner une poétique narrative du vivant. -rythmes et temporalités du vivant. L’on pourra examiner enfin les modifications induites sur la temporalité de la narration par une focalisation sur le concept de vivant. De l’influence en tant que modèle narratif de la théorie darwinienne à l’élargissement scalaire de narrations prenant pour objet l’histoire non plus seulement d’individus mais de l’espèce ou même de la Vie sur Terre (voir par exemple les innovations proposées par The Tree of Life de Terence Malick ): un vaste champ d’investigations s’offre ici encore aux futurs participants. 2. Axe épistémocritique: transferts et migrations critiques et dynamiques entre les sciences du vivant et les arts. L’on pourra se demander quels contenus, mais aussi quelles méthodologies ou quelles images issues des sciences du vivant au sens large (biologie, médecine, éthologie, zoologie, écologie) font l’objet de représentation et d’intégration dans les formes narratives des XX e et XXI e siècles. 3. Axe théorique: accointances et résistances de la narrativité et du vivant. Il sera enfin possible de revenir sur les problèmes théoriques supposés par l’idée d’une narrativité du vivant dont nous avons donné plus haut quelques exemples; mais aussi à l'inverse sur la narrativité propre au discours biologique (notamment par opposition à la langue de la physique ou des mathématiques). Les propositions de communication, rédigées en français et d’une longueur de 250 à 300 mots, sont à envoyées conjointement à marie.cazaban.mazerolles@univ-poitiers.fr et maria.paula.klein@univ-poitiers.fr avant le 31 janvier. Le résumé sera assorti de 3 à 5 mots-clés et d’une courte notice bio-bibliographique. Rencontre: La journée d'étude se déroulera en présence dePierre Senges (écrivain) et Dominique Lestel (philosophe-éthologue) qui viendront parler des Aventures de Percival. Un conte phylogénétique (éditions DisVoir, collection "Contes illustrés pour adultes", 2009). Comité scientifique: Christine Baron, Denis Mellier, Raphaëlle Guidée, Luc Vigier, Frédérik Detue Martin Rass. Calendrier: Date limite remise des propositions: 31 janvier. Notification de la décision du comité organisateur: 10 février. Journée d’étude: 10 avril. [1] Voir par exemple en France le programme de recherche «Littérature et Savoirs du vivant», coordonné par G. Segingerou le réseau InterMSH VIVANLIT; et dans le monde anglo-saxon les champs de la biopoetics, de l’ écocriticism ou encore dans une certaine mesure des animal studies.
↧
A. Le Brun, Sade. Attaquer le soleil (Exposition du Musée d'Orsay, Paris)
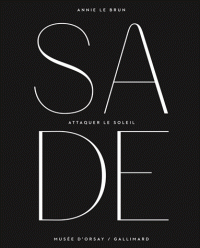 Sade. Attaquer le soleil - Exposition, Paris, Musée d'Orsay, du 14 octobre 2014 au 25 janvier 2015 Annie Le Brun Guy Cogeval (Préfacier) Date de parution : 25/10/2014 Editeur : Gallimard (Editions) ISBN : 978-2-07-014682-6 EAN : 9782070146826 Présentation : Broché Nb. de pages : 332 p. « Le propos de cet ouvrage est de montrer comment, avant d'avoir une importance majeure dans la pensée du XXe siècle, l'oeuvre du Marquis de Sade a induit une part de la sensibilité du XIXe siècle, quand bien même le personnage et ses idées y auront été tenus pour maudits. Car, si Baudelaire, Flaubert, Huysmans, Swinburne, Mirbeau. sans parler d'Apollinaire, s'y sont référés à titres divers, tout porte à croire que la force de cette pensée est aussi d'avoir rencontré, révélé, voire provoqué, ce qui agite alors en profondeur l'expression plastique, concernant autant l'inscription du désir que son pouvoir de métamorphose. C'est l'image du corps en train d'être bouleversée de l'intérieur, annonçant une révolution de la représentation. Que ce soit évident chez Delacroix, Moreau, Böcklin., ce qui est en jeu n'est pas sans inquiéter aussi Ingres, Degas ou Cézanne et bien sûr Picasso. Et cela tandis que Félicien Rops, Odilon Redon, Alfred Kubin se rapprochent d'une expression restée jusqu'alors marginale (curiosa ou folie), avant que le surréalisme, se réclamant de Sade, ne reconnaisse le désir comme grand inventeur de forme. À retrouver ce cheminement, il sera possible de mesurer combien à dire ce qu'on ne veut pas voir, Sade aura incité à montrer ce qu'on ne peut pas dire. Ou comment le XIXe siècle s'est fait le conducteur d'une pensée qui, incitant à découvrir l'imaginaire du corps, va amener à la première conscience physique de l'infini."— Annie Le Brun.
Sade. Attaquer le soleil - Exposition, Paris, Musée d'Orsay, du 14 octobre 2014 au 25 janvier 2015 Annie Le Brun Guy Cogeval (Préfacier) Date de parution : 25/10/2014 Editeur : Gallimard (Editions) ISBN : 978-2-07-014682-6 EAN : 9782070146826 Présentation : Broché Nb. de pages : 332 p. « Le propos de cet ouvrage est de montrer comment, avant d'avoir une importance majeure dans la pensée du XXe siècle, l'oeuvre du Marquis de Sade a induit une part de la sensibilité du XIXe siècle, quand bien même le personnage et ses idées y auront été tenus pour maudits. Car, si Baudelaire, Flaubert, Huysmans, Swinburne, Mirbeau. sans parler d'Apollinaire, s'y sont référés à titres divers, tout porte à croire que la force de cette pensée est aussi d'avoir rencontré, révélé, voire provoqué, ce qui agite alors en profondeur l'expression plastique, concernant autant l'inscription du désir que son pouvoir de métamorphose. C'est l'image du corps en train d'être bouleversée de l'intérieur, annonçant une révolution de la représentation. Que ce soit évident chez Delacroix, Moreau, Böcklin., ce qui est en jeu n'est pas sans inquiéter aussi Ingres, Degas ou Cézanne et bien sûr Picasso. Et cela tandis que Félicien Rops, Odilon Redon, Alfred Kubin se rapprochent d'une expression restée jusqu'alors marginale (curiosa ou folie), avant que le surréalisme, se réclamant de Sade, ne reconnaisse le désir comme grand inventeur de forme. À retrouver ce cheminement, il sera possible de mesurer combien à dire ce qu'on ne veut pas voir, Sade aura incité à montrer ce qu'on ne peut pas dire. Ou comment le XIXe siècle s'est fait le conducteur d'une pensée qui, incitant à découvrir l'imaginaire du corps, va amener à la première conscience physique de l'infini."— Annie Le Brun.
↧
M. Delon (dir.), Sade. Un athée en amour (Exposition de la Fondation Bodmer, Genève)
 Sade. Un athée en amour Michel Delon Collectif Date de parution : 13/11/2014 Editeur : Albin Michel (Editions) ISBN : 978-2-226-25905-9 EAN : 9782226259059 Nb. de pages : 335 p. Grâce à la collaboration des meilleurs spécialistes, Michel Delon propose un regard nouveau sur un auteur majeur qu'il est urgent de débarrasser des préjugés et des lieux communs pour le lire dans ses oeuvres et dans ses écrits les plus intimes : un auteur qui résume son siècle et sa passion du plaisir, mais aussi ses abîmes, ses gouffres, tout ce qui fait de Sade l'inventeur de la modernité en littérature, le précurseur d'une science de l'inconscient, l'analyste implacable des passions les moins avouables. UNE ICONOGRAPHIE EXCEPTIONNELLE : des autographes jamais vus, des lettres et des textes littéraires oubliés, les gravures des éditions originales, les photographies des lieux d’enfermement et plus de 140 objets rares tirés, souvent pour la première fois, de collections publiques et privées.
Sade. Un athée en amour Michel Delon Collectif Date de parution : 13/11/2014 Editeur : Albin Michel (Editions) ISBN : 978-2-226-25905-9 EAN : 9782226259059 Nb. de pages : 335 p. Grâce à la collaboration des meilleurs spécialistes, Michel Delon propose un regard nouveau sur un auteur majeur qu'il est urgent de débarrasser des préjugés et des lieux communs pour le lire dans ses oeuvres et dans ses écrits les plus intimes : un auteur qui résume son siècle et sa passion du plaisir, mais aussi ses abîmes, ses gouffres, tout ce qui fait de Sade l'inventeur de la modernité en littérature, le précurseur d'une science de l'inconscient, l'analyste implacable des passions les moins avouables. UNE ICONOGRAPHIE EXCEPTIONNELLE : des autographes jamais vus, des lettres et des textes littéraires oubliés, les gravures des éditions originales, les photographies des lieux d’enfermement et plus de 140 objets rares tirés, souvent pour la première fois, de collections publiques et privées.
↧
↧
Voltaire, Œuvres complètes, t. 57A: Writings of 1763-1764
Œuvres complètes de Voltaire , t.57A: Writings of 1763-1764 Ed. Simon Davies, Graham Gargett, et al. ISBN978-0-7294-1059-5, xxii, 388 pages, £105.00. 1763-1764 shows a relentlessly satirical Voltaire, whether he is goading the Le Franc de Pompignan brothers, or mocking Omer de Fleury for his stance on inoculation. In Voltaire and the tithes of Ferney , there is further evidence of his continued involvement with local and national politics on the subject of taxes, while simultaneously penning one of his key texts on the Bible, his Catéchisme de l’honnête homme . The shorter verses show us a Voltaire at turns flattering to his friends, and keen to summarise Louis XV’s legacy in verse. The volume ends with a text misattributed to Voltaire celebrating two actresses as they retire from the stage. Parution de la Voltaire Foundation. Pour des renseignements complémentaires sur ce volume:http://xserve.volt.ox.ac.uk/VFcatalogue/details.php?recid=6563 Pour tout autre renseignement, ou pour passer une commande: http://www.voltaire.ox.ac.uk/www_vf/books/orders.ssi Pour tout renseignement complémentaire merci de contacter email@voltaire.ox.ac.uk
↧
Point de vue et point d’écoute au cinéma: approches techniques
Appel à communications: Point de vue et point d’écoute au cinéma: approches techniques Colloque international organisé par l’équipe d’accueil (EA 3208)Arts : pratiques et poétiques de l’Université Rennes 2, les 8, 9 et 10 octobre 2015 Coordonné par Antony Fiant, Roxane Hamery et Jean-Baptiste Massuet Depuis quelques années sont apparus sur les écrans de cinéma des films tournés à l’aide de dispositifs pour le moins étonnants, permettant de numériser la performance d’un acteur par le biais de capteurs photosensibles afin d’obtenir une prestation intégralement «enregistrée» sous tous les angles, en trois dimensions. Si cette approche est à ce point étonnante, c’est qu’en séparant la direction d’acteurs de la partie strictement technique de la mise en scène, ces procédés de motion et de performance capture permettent de concevoir, au moins un temps, un objet virtuel intégralement dénué de point de vue [1] , au sein duquel le réalisateur est libre de choisir, dans un second temps, ses angles de prise de vues, ses éclairages, ses focales ou encore ses mouvements de caméra parmi l’infinité des possibles. À partir d’une performance d’acteurs, une infinité de points de vue s’offre ainsi au metteur en scène, laquelle ne dépend plus d’aucun point d’ancrage matériel (caméras, micros, sources d’éclairage, etc.), et s’accorde ainsi à ses moindres désirs. Un tel procédé, loin d’annihiler la notion de point de vue, tend plutôt à l’éclairer sous un jour nouveau, ou tout du moins d’une manière singulière. Si le point de vue recouvre plusieurs significations, trois principales pour suivre Jacques Aumont et Michel Marie [2] – «l’emplacement réel et imaginaire depuis lequel une représentation est produite»; «le filtrage de l’information et son assignation aux diverses instances de la narration – auteur, narrateur, personnages»; «l’opinion, le sentiment à propos d’un objet, d’un phénomène ou d’un événement»– il s’avère sans doute possible, au cinéma, d’aborder ces différentes acceptions par le biais de considérations techniques. Parmi les multiples approches permettant d’analyser la manière dont un énoncé est produit (les théories de l’énonciation en donnent plusieurs exemples) la technique peut, dans ce cadre spécifique, se voir octroyer une place de choix. Souvent invoquée en analyse filmique, la notion de point de vue permet en effet de cerner le discours d’un film, quel que soit le sens que l’on donne au terme – narratologique, idéologique, textuel, esthétique, etc. – et donc de penser et de caractériser la mise en scène d’une séquence ou parfois plus globalement le style d’un cinéaste ou d’une «école» particulière. Ce sont alors la plupart du temps des «moyens expressifs» qui sont invoqués, qu’il s’agisse du cadrage, des mouvements de caméra, de la focale, de l’échelle de plan, des éléments de la bande-son [3] , du montage, etc., termes privilégiés dans le cadre de l’exercice de l’analyse de film, et qui désignent en réalité assez explicitement des données techniques à partir desquelles, entre autres, le réalisateur détermine un point de vue et un point d’écoute. Curieusement, les liens entre ces moyens expressifs au service du point de vue/point d’écoute, et les techniques, appareils ou dispositifs choisis par les techniciens en collaboration avec les cinéastes n’ont que rarement été pensés dans le cadre de la recherche en cinéma. Pourtant, d’un film à l’autre, les procédés auxquels fait appel le metteur en scène – aussi génériquement désignés soient-ils – ne reposent pas forcément sur les mêmes types de machines, les mêmes types de caméras, les mêmes types de micros, etc. Et, partant, leur appréhension peut s’en trouver modifiée, non seulement en termes esthétiques – que le choix de tel ou tel dispositif soit inscrit dans le projet de mise en scène [4] , ou qu’il entre en jeu incidemment dans le cadre d’une interprétation de l’analyste – mais également en termes de fabrication des œuvres, car certains choix techniques ayant une incidence sur le point de vue/point d’écoute sont le fait de techniciens et non des cinéastes. C’est tout l’objet de ce colloque, s’inscrivant au sein du programme de recherche TECHNÈS (du grec technè , qui désignait ensemble le faire technique et la production artistique ) visant à repenser le cinéma et ses techniques dans son histoire et à l’heure du numérique, que de proposer cette approche liant la technique à la question du point de vue/point d’écoute au cinéma. L’approche sera plurielle, la réflexion concernant à la fois la question des formats, du son, des caméras, de la couleur, du montage, de la 3D relief, des objectifs, etc., c’est-à-dire de tout ce qui a trait à la dimension technique de la création cinématographique, en abordant ses divers dispositifs sous des angles esthétique, historique, théorique ou encore sociologique. Pourront ainsi être abordées des questions liées à l’analyse (adoption du point de vue d’un personnage particulier, discours porté par un narrateur ou par le cinéaste, retranscription ou réinvention géographique d’un espace donné, appréhension sonore d’un environnement spécifique, relations et rapports de force entre personnages, adaptation d’un médium artistique singulier à la forme cinématographique, etc.), à l’histoire et à l’historiographie des techniques (transformations de certains dispositifs selon les époques, réception théorique ou critique de telle ou telle innovation technologique et de ses apports à la question du point de vue/point d’écoute, etc.), mais également à la sociologie des métiers du cinéma (question de la collaboration ou encore des relations entre techniciens et cinéastes dans le cadre de certains procédés de mise en scène, apparition de nouveaux métiers liés à une approche technique originale pensée en termes de point de vue/point d’écoute, etc.) Nous nous proposons d’établir, dans le cadre de ce colloque, une réflexion sur ces problèmes à partir de divers angles d’approche dont nous proposons ici quelques exemples (sans pour autant que la liste soit exhaustive) :Analyse d’un film ou d’une séquence en particulier reposant sur de forts partis-pris techniques liés à la question du point de vue et/ou du point d’écoute.Réflexion transversale sur l’œuvre d’un cinéaste en interrogeant la récurrence de certains procédés techniques au sein du travail d’élaboration du point de vue et/ou du point d’écoute.Analyse transversale d’une technique singulière et de la manière dont elle a pu être mise au service du point de vue/point d’écoute par des cinéastes d’origine ou d’époques différentes.Analyse de la réception de certains films, en se fondant sur l’impact de la technique et sur l’effet recherché sur le point de vue du spectateur.Commentaire historiographique sur des textes ou des ouvrages témoignant de la manière dont le point de vue et/ou point d’écoute a pu être pensé à telle ou telle époque en s’appuyant sur des considérations techniques.Approche de la notion de point de vue/point d’écoute sous l’angle de l’histoire des techniques.Interrogations historiques et/ou esthétiques d’un genre ou d’un courant à travers les questions techniques liées à l’élaboration du point de vue et/ou du point d’écoute.Réflexion sur la collaboration entre cinéastes et techniciens, ainsi que sur la manière dont certains aspects de la mise en scène ont pu être pensés sous un angle technique avant d’être pensés sous un angle esthétique.Etude de l’implication des techniciens dans l’élaboration du point de vue ou d’écoute – qui peut aller dans certains cas jusqu’à l’autonomie – en considérant diverses pratiques sociales, culturelles et purement techniques. Les communications, d’une durée de 30 minutes, pourront porter sur toutes formes de cinéma (commercial, éducatif, scientifique, documentaire, d’animation, amateur, expérimental...), argentique ou numérique, à partir du moment où les considérations de point de vue et/ou de point d’écoute se trouvent fondées sur une réflexion d’ordre technique. Les propositions de communication d’environ 300-400 mots accompagnées d’un titre provisoire, d’une bio-bibliographie de 5-6 lignes sont à nous faire parvenir avant le 6 avril 2015 aux adresses suivantes: antony.fiant@univ-rennes2.fr; roxane.hamery@univ-rennes2.fr; jbmassuet@wanadoo.fr. Le comité scientifique procédera à une évaluation de ces propositions en double aveugle et informera les auteurs des décisions le 4 mai 2015. Comité scientifique Antony Fiant (Université Rennes 2) Roxane Hamery (Université Rennes 2) Jean-Baptiste Massuet (Université Rennes 2) Benoît Turquety (Université de Lausanne) Barbara Turquier (école de la Femis) Vincent Amiel (Université de Caen) Richard Bégin (Université de Montréal) Olivier Asselin (Université de Montréal) [1] Au moins en termes «d’ocularisation» pour reprendre le terme de François Jost (Cf L’Œil-caméra. Entre film et roman , Lyon, PUL, 1987), puisque la direction d’acteurs permet évidemment de développer un «point de vue» singulier pour le metteur en scène. [2] Jacques Aumont et Michel Marie, Dictionnaire théorique et critique du cinéma , Paris, Armand Colin, 2008, pp.193-194. [3] Renvoyant pour leur part, non plus au principe «d’ocularisation» précédemment décrit, mais plutôt à celui «d’auricularisation» également décrit par François Jost ( op. cit. ). [4] Pour ne donner qu’un exemple, nous pourrions évoquer la volonté de Godard d’avoir accès dans les années 1970 à une caméra légère et compacte (la 8-35 qui deviendra en réalité l’Aaton 35 conçue par Beauviala) qui lui aurait permis d’adopter, plus qu’une nouvelle manière de filmer, une nouvelle relation esthétique au monde.
↧
G. Mazzoni, Sur la poésie moderne
 Guido Mazzoni, Sur la poésie moderne Paris : Classiques Garnier, coll. "Etudes romantiques et dix-neuviemistes", 2014 EAN 9782812431197. 258 p. Prix : 32EUR Présentation de l'éditeur : Entre la deuxième moitié du XVIII e siècle et la première moitié du XIXe siècle, la poésie occidentale se transforme. Guido Mazzoni reconstruit les étapes de cette métamorphose et les interprète comme les symptômes de mutations historiques profondes. Table des matières
Guido Mazzoni, Sur la poésie moderne Paris : Classiques Garnier, coll. "Etudes romantiques et dix-neuviemistes", 2014 EAN 9782812431197. 258 p. Prix : 32EUR Présentation de l'éditeur : Entre la deuxième moitié du XVIII e siècle et la première moitié du XIXe siècle, la poésie occidentale se transforme. Guido Mazzoni reconstruit les étapes de cette métamorphose et les interprète comme les symptômes de mutations historiques profondes. Table des matières
↧